Alain Peyrefitte : confiance, liberté et développement humain pour une vision constructive de nos sociétés.
“Sous la malice : seul celui qui fait confiance triomphe”
Entretien avec ALAIN PEYREFITTE par OLAVO DE CARVALHO – Version complète.
NB – Cet entretien a été publié dans la revue “Republicada” de juillet 1998, mais quelque peu amputé pour tenir dans l’espace disponible.
C’est pourquoi j’ai décidé de reproduire ici, dans son intégralité, les enseignements de l’un des hommes les plus intelligents du monde.
« Il n’existe qu’une seule et unique formule
pour faire d’un homme un homme authentique :
la formule qui prescrit l’absence de toute formule.
Nos ancêtres avaient un beau mot, qui résumait tout : la confiance. »
Franz ROSENZWEIG.
Introduction:
L’affection des Français pour les révolutions et les coups d’État n’a pas empêché que, de ce peuple si mal à l’aise dans l’ordre démocratique, naissent, peut-être en compensation, certaines des intelligences les plus aptes à saisir l’essence de la démocratie et à diagnostiquer les dangers qui la menacent.
Il n’est pas surprenant que ces hommes aient si peu été prophètes dans leur propre pays.
Parmi ces prédicateurs dans le désert, le plus connu est Alexis de Tocqueville, le premier à observer, au sein même de la démocratie américaine naissante, la contradiction – encore irrésolue à ce jour et de plus en plus aiguë – entre égalité et liberté.
Juste après lui vient Frédéric Bastiat, pionnier dans le diagnostic de la nature vorace et tyrannique de l’État moderne.
Moins connu, mais hautement respecté par ceux qui le connaissent, Bertrand de Jouvenel, intelligence implacablement réaliste, a démoli le mythe des libertés croissantes, en démontrant au contraire l’expansion illimitée du pouvoir et l’écart toujours plus grand entre gouvernants et gouvernés.
Ces trois penseurs partagent un pessimisme historique, l’appréhension de démocrates sincères qui voient la liberté s’éteindre et, regardant autour d’eux, ne trouvent aucun moyen de la défendre face à la marche écrasante du pouvoir.
Mais celui que je vais vous présenter maintenant, s’il partage avec eux la crainte des dangers, se distingue, de manière surprenante, par l’optimisme avec lequel il envisage l’avenir.
Alain Peyrefitte n’est cependant pas un rêveur.
Il suffit de voir ses yeux pour remarquer que, sous son sourire affable, se cache un observateur redoutable, que seul un fou tenterait de tromper.
L’optimisme de Peyrefitte, bien équilibré par une dose de scepticisme, est d’un type différent de l’habituel.
Il ne repose pas uniquement sur l’espoir, mais sur la simple constatation d’un fait : la liberté de décision humaine, qu’aucun déterminisme n’a jamais réussi à abolir, que ce soit pour instaurer la nécessité du mal ou la fatalité d’un bien croissant.
Peyrefitte est optimiste pour la simple raison que le pessimisme est une illusion déprimante fondée sur la présomption de connaître déjà l’avenir.
L’avenir appartient à Dieu, et Dieu serait un véritable idiot s’il créait des êtres capables de décider sans leur laisser au moins une part de responsabilité dans cet avenir.
Peyrefitte est optimiste parce qu’il comprend que, plus ou moins, il est toujours possible d’agir. Et qui pourrait prouver le contraire ?
Mais je vais trop vite en besogne. Permettez-moi d’abord de dire qui est Alain Peyrefitte. Membre de l’Académie française, diplomate de carrière, homme d’État, historien, politologue, journaliste, il fut collaborateur, ami et homme de confiance du général Charles de Gaulle pendant trois décennies, député dans toutes les législatures de la Ve République et plusieurs fois ministre : de l’Éducation, de la Justice, de l’Intérieur, du Plan, de la Culture, de la Recherche scientifique.
Il préside aujourd’hui le conseil éditorial du “Figaro”, encore le quotidien français le plus influent. Sa pensée sociale et politique a fait l’objet de nombreuses thèses, articles et colloques, y compris à l’Institut de France, dont aucune nouvelle n’est parvenue jusqu’à nos contrées.
Le premier signe que nous ayons perçu de l’existence de cet esprit extraordinaire fut donné l’année dernière par la maison d’édition Jorge Editorial, qui a publié “L’Empire immobile ou le choc des mondes”, traduit par Cylene Bittencourt.
Mais, aussi fascinant soit-il, ce récit de l’expédition de George Macartney en Chine en 1792, s’il nous révèle tout sur le mal chronique d’un empire paralysé par la suspicion généralisée, ne nous dit pas grand-chose sur sa propre articulation avec les conceptions plus générales de son auteur sur la nature et le fonctionnement de la société humaine, dont il constitue une exemplification fondée sur l’étude méticuleuse d’un cas particulier. C’est pourquoi, ou à cause de la léthargie proverbiale qui frappe notre presse culturelle depuis quatre décennies, elle n’a même pas signalé la publication de cette œuvre maîtresse de la science historique, où la rigueur de la méthode, loin de s’afficher dans le jargon pesant du pédantisme universitaire, se dissimule élégamment sous un style narratif vivant, vibrant et cinématographique.
Coïncidence ou non, l’auteur lui-même n’a pas commencé par exposer ses conceptions, mais par les illustrer à travers un cas concret, celui de son propre pays, dans “Le Mal français”, publié en 1976.
Devenu un classique, ce livre dresse le portrait d’une nation rongée par la suspicion, toujours en quête d’un gouvernement fort pour se protéger d’elle-même et d’un leader autoritaire ou révolutionnaire pour se protéger de ce gouvernement fort.
“Les Chevaux du lac Ladoga”, en 1981, montrait les racines idéologiques et culturelles de la criminalité juvénile, que ceux qui les avaient semées cherchaient à dissimuler sous un discours conventionnel contre le système économique (ce film, nous l’avons déjà vu, n’est-ce pas ?).
Dans ces travaux et d’autres, partant tantôt de l’exemple français, tantôt de l’exemple chinois (qu’il a connu de près en 1971, en tant que chef de la première mission officielle occidentale admise en Chine pendant les années de la Révolution culturelle), Peyrefitte a tracé le profil historique, sociologique, politique et administratif de la «société de défiance», ce Léviathan paralysé par la panique et les doutes paranoïaques à l’égard de lui-même.
Cette différence apparaît d’abord dans les idées, l’imaginaire, la culture.
Ensuite, elle se consolide dans les lois et les coutumes.
Enfin, elle porte ses fruits dans l’économie : richesse, progrès, développement.
Le protestantisme a contribué, certes, à ce résultat, mais moins par ses conceptions théologiques et morales explicites soulignées par Weber – prédestination, éthique de l’épargne – que par le simple fait de stimuler la liberté et la variété, libéré du poids excessif d’une vieille bureaucratie contrôlante.
Et si, pendant ce temps, le catholicisme a retardé le développement économique dans d’autres parties du monde, ce n’était pas non plus à cause du contenu de sa foi, économiquement neutre en soi, mais simplement parce que la hiérarchie, effrayée, au lieu de surmonter créativement les oppositions, s’est raidie dans une attitude paranoïaque et défensive, ne pensant qu’à davantage de contrôle, de centralisme, de bureaucratie.
Dans certains pays, le développement économique a été favorisé par l’absence de contrôles.
Dans d’autres, il n’a pas seulement été défavorisé : il a été arrêté, interdit, étouffé dans l’œuf par des autorités qui l’ont tragiquement confondu avec les démons qu’il servait.
En Espagne, au Portugal, en Italie et partiellement en France, le développement n’a jamais été un ennemi de l’Église : il a été le bouc émissaire des culpabilités catholiques et anticatholiques.
En le condamnant, le catholicisme s’est fait un tort immense, dont il cherche aujourd’hui à se racheter.
Mais en exagérant l’expiation, il tombe dans l’extrême opposé, l’adhésion aux progressismes de gauche qui, comme toujours avec les opposés, le ramène à l’erreur originelle : le culte du centralisme inhibiteur, désormais en version socialiste.
La thèse est si évidente, si patente, que l’auditeur ne peut s’empêcher de se demander : «Pourquoi n’y ai-je pas pensé plus tôt ?»
La thèse elle-même répond : nous n’y avons pas pensé parce que nous étions infectés par le matérialisme historique, qui nous mettait sur une fausse piste.
Nous cherchons d’abord les causes économiques et refusons obstinément d’explorer d’autres hypothèses, même lorsque la persévérance dans le dogme nous obligeait à adopter des explications mutuellement contradictoires : l’Angleterre s’est développée parce qu’elle avait du charbon, le Japon, parce qu’il n’en avait pas.
Comme ensorcelés, nous projetions sur des causes externes la responsabilité de nos actions, et nous ne voyons nulle part la cause la plus évidente de tout ce qui nous arrive : les décisions humaines, fondées sur des croyances et des valeurs.
Le cadeau que l’œuvre de Peyrefitte offre à l’humanité est multiple et d’une richesse incalculable.
Elle lui enseigne les conditions du développement économique, réunit les matériaux historiques qui les démontrent, lui dévoile le seul obstacle réel, qui réside dans son âme même, lui montre les moyens de le surmonter, apaise les antagonismes religieux qui la paralysent et, de surcroît, la libère de l’obsession la plus oppressante et sclérosante de toutes : le matérialisme historique, le déterminisme économique.
Dans les milieux intellectuels européens, rares sont ceux qui, même à contrecœur, n’éprouvent pas une certaine gratitude envers ce défricheur de la forêt des idées.
Seuls quelques Américains restent quelque peu dédaigneux, peut-être mécontents qu’un Latin ait mieux compris le capitalisme qu’eux-mêmes.
Si le Brésil est malin, il ne fera pas la fine bouche, en se croyant supérieur, mais ira s’asseoir humblement pour écouter une leçon qui est pour le bien de tous et le bonheur général des nations.
Texte complet de l’entretien :
CONFIANCE :
C’EST UN BEAU MOT,
PEUT-ÊTRE LE PLUS BEAU,
JUSTEMENT PARCE QU’IL N’EST PAS SEULEMENT UN MOT.
Un de vos premiers essais portait déjà le titre “Le Sentiment de confiance”. Il a été publié en 1947. Avez-vous eu des expériences personnelles, dans votre enfance ou votre jeunesse, qui ont attiré votre attention sur l’importance décisive de la confiance dans les relations humaines ?
L’idée que la confiance est la condition première de tout développement humain n’est pas une hypothèse scolaire. Elle n’est donc pas sortie de mon cerveau comme Athéna est née toute armée du cerveau de Zeus.
Et il ne s’agit pas d’une expérience privilégiée, réservée à quelques-uns. L’importance de la confiance dans les relations humaines est telle que, d’une manière ou d’une autre, tout le monde y est confronté dès la petite enfance.
Dès qu’il vient au monde, le petit homme est confié à ses parents, à des éducateurs, à des médecins.
La confiance qu’on lui donne ou qu’on lui refuse, celle qu’il acquiert en lui-même, celle qu’il accorde aux autres, en somme le climat de défiance ou de confiance dans lequel il évolue, constitue l’élément vital de son développement.
L’apprentissage de l’autonomie et de la responsabilité est la découverte parallèle de la confiance en soi et de la fiabilité de l’autre.
Cette découverte, bien sûr, n’est pas nécessairement explicite.
Quelqu’un est-il conscient de l’air qu’il respire ?
La confiance, comme l’air, est si vitale qu’on ne remarque son importance que lorsqu’elle vient à manquer.
La défiance avait empoisonné la fin de la IIIe République.
La France trahissait la confiance de ses compatriotes, mais aussi celle de ses alliés.
Ce fut peut-être l’échec de mon pays, sourd à l’appel tchécoslovaque, et la fausse confiance inspirée par les accords de Munich qui m’ont révélé l’importance capitale de la confiance.
Sans doute, mes parents, professeurs passionnés par leur métier et leurs élèves, avaient éveillé en moi la confiance dans les vertus du travail, de la loyauté, de la constance.
Mais je crois vraiment que ce furent les drames de notre nation qui m’ont servi de réveil. Et puis, il y eut de Gaulle : celui qui a forcé le destin par une confiance surhumaine en la France et en la liberté, celui qui, au pire moment du désastre, a cru en l’inversion de la défaite en victoire.
Je me demande si Franz Rosenzweig, que vous citez, n’a pas trouvé sa conception de la confiance précisément dans l’enfer des tranchées, par une sorte de sursaut salutaire, en voyant que l’humain, sous la pluie des bombes, était réduit à une matricule obéissant à des ordres sans appel et à des formules inauthentiques.
Or, la confiance n’est pas une formule vide : c’est un geste uni à la parole, un point d’appui et de départ, à la fois stable et dynamique.
Confiance : c’est un beau mot, peut-être le plus beau, justement parce qu’il n’est pas seulement un mot.
TOUTE POLITIQUE DIGNE DE CE NOM
EXIGE LA CONFIANCE
EN CEUX QUI LA DIRIGENT
Carl Schmitt définissait la politique comme la confrontation ami-ennemi, au-dessus de toutes les valeurs qui lui servaient de prétexte.
Sous cette perspective, une « politique de confiance » ne serait-elle pas une contradiction dans les termes ? Comment définissez-vous la politique ?
Carl Schmitt a exalté la confrontation ami-ennemi à un point qui me semble inacceptable.
Voyez-le citer Saint-Just : « Entre le peuple et ses ennemis, rien n’est commun, sauf la gloire. »
Pour Carl Schmitt, le mal est irrémédiable, la confrontation armée est à la fois une raison et un moyen de vivre.
Il a même écrit, en 1947, alors qu’il était en prison, attendant un éventuel jugement à Nuremberg : « Malheur à celui qui n’a pas d’ennemi. »
Schmitt a fait de la guerre une fatalité, non pas au sens malthusien où « une bonne guerre nous ferait du bien », mais dans un sens presque providentiel, quasi théologique. C’est dans “Théologie politique” qu’il a écrit : « On ne pourrait éliminer du monde l’inimitié entre les hommes en interdisant les guerres à l’ancienne entre États, en propageant une révolution mondiale et en essayant de transformer la politique mondiale en politique du monde. »
Sans doute avait-il en tête l’échec de la Société des Nations et de son pacifisme irresponsable. Mais il me semble totalement pervers de penser la politique internationale en termes nécessairement conflictuels.
Je définis la politique comme la mobilisation des énergies individuelles autour d’un objectif commun.
Toute politique digne de ce nom suppose une confiance en ceux qui la dirigent.
Une politique internationale ne mérite pas le nom de politique si elle ne vise pas une forme de coopération en vue d’un objectif commun et bénéfique pour tous – ce qui n’exclut nullement une saine concurrence dans la gestion des moyens pour y parvenir. Sinon, la politique n’est qu’une guerre larvée, et la guerre, selon la formule de Clausewitz, est la continuation de la politique par d’autres moyens – une continuation inévitable et même, en soi, nécessaire du point de vue de Schmitt.
LE VÉRITABLE LIEN POLITIQUE
EST CELUI DE LA CONFIANCE-ESPÉRANCE,
LA CONSTRUCTION D’UNE ŒUVRE COMMUNE
Toujours sous cet angle, Hobbes disait que l’État était né de la peur, ou, ce qui revient au même, de la défiance.
Hobbes s’est-il trompé, ou l’avènement de ce phénomène nouveau appelé « développement » entraîne-t-il un changement dans la nature même de l’État ?
Carl Schmitt n’a jamais caché son admiration pour Hobbes.
Dans “La Notion du politique”, il le qualifie de « grand esprit politique » et proclame son adhésion à la conception hobbesienne de l’ état de nature qui conduit à la guerre de tous contre tous : “bellum omnium contra omnes”.
Le raisonnement de Hobbes repose sur deux principes, dont Schmitt admire le développement :
- 1° chacun a un droit illimité sur tout ce qu’il désire ;
- 2° les hommes ont une inclination naturelle à se nuire les uns les autres.
Il en résulte « des soupçons et des défiances continuelles » (“De Cive”, I:XII), d’où la guerre perpétuelle.
Seule la peur de mourir (“timor mortis”), la crainte pour son propre corps, pousse les hommes au désarmement et à la conclusion d’un pacte.
Hobbes prétend que de ce pacte peut naître une confiance mutuelle.
Mais il méconnaît sa précarité.
La confiance, pour lui, n’est qu’une défiance désarmée, une confiance par défaut, parce qu’il n’y a plus rien à craindre.
Le véritable lien politique est celui de la confiance-espérance, la construction d’une œuvre commune, le développement d’une entreprise concertée, dans laquelle les acteurs ont le sentiment de gagner, et non seulement de sauver leur peau.
Le présupposé de la doctrine de Hobbes est sans doute l’idée d’une pénurie relative, qui oblige les hommes à pactiser s’ils ne veulent pas s’entretuer.
Mais le véritable moteur de l’association humaine doit être, comme vous le suggérez, l’espoir d’un développement, d’une augmentation des ressources et des services, grâce à une coopération contractuelle d’initiatives libres, innovantes et responsables.
C’est davantage du côté de Locke que de Hobbes qu’on trouvera les fondements d’une politique de confiance.
C’EST TOUJOURS DES INDIVIDUS
QU’ON FAIT ABSTRACTION, POUR LES NOYER
DANS UNE STATISTIQUE GÉNÉRALE
Celui qui a eu le courage de souligner l’action de l’individu dans la production de l’Histoire ne peut que considérer les « causes » et les « lois » de l’Histoire comme une sorte d’idole à laquelle les hommes attribuent magiquement l’autorité de leurs propres actions. Êtes-vous d’accord avec Eric Voegelin lorsqu’il dit que l’hégélianisme et le marxisme sont des formes de « magie noire », une auto-aliénation des pouvoirs de l’homme aux puissances abstraites ?
De tous les cultes destructeurs, le plus pervers est le culte de l’abstraction.
Et c’est toujours des individus qu’on fait abstraction, pour les noyer dans une statistique générale, une configuration d’ensemble, une analyse structurelle.
Je ne nie pas les services rendus par l’histoire sérielle, l’histoire quantitative, l’évaluation statistique.
Toutes ces techniques permettent d’affiner la description des phénomènes sociaux et économiques.
Mais elles n’en fournissent pas l’explication.
Ni l’avènement de l’Esprit absolu, ni le mouvement du concept, ni la lutte des classes, ni la loi de la baisse tendancielle du taux de profit n’expliquent quoi que ce soit.
Marx prétendait avoir remis sur ses pieds la dialectique hégélienne, débarrassée de sa gangue mystique.
Et pourtant, la superstition théorique n’est pas moindre chez Marx que chez Hegel. Souvenez-vous, par exemple, que l’expropriation de la bourgeoisie, qui a exploité le travailleur indépendant, est conçue comme une « négation de la négation » et se produit, selon Marx, « avec la même nécessité qui préside aux métamorphoses de la nature ».
Je ne suis pas sûr que Hegel aurait autant investi dans ce nécessitarisme que Marx. N’oublions pas que Hegel était un grand lecteur d’Adam Smith, et ses “Leçons sur la philosophie de l’Histoire” dévoilent, au milieu des ruses interminables de la raison, l’audacieuse initiative de l’individu humain.
Dans La Société de confiance, vous avez dit que l’encyclique Mater et Magistra reconnaissait l’initiative individuelle dans la promotion du développement.
Pourquoi alors le pontificat de Jean XXIII et le Concile Vatican II ont-ils fini par favoriser à ce point les courants gauchistes et socialistes de l’Église ?
Dans “Mater et Magistra”, on affirme principalement que tout dans le monde économique résulte de l’initiative personnelle des particuliers, qu’ils agissent individuellement ou en association pour la poursuite d’intérêts communs.
Son exaltation du « génie créateur des individus » contrastait évidemment avec le modèle structuraliste alors à son apogée.
Mais, comme le magistère mentionnait le principe de la destination universelle des biens et condamnait l’injuste répartition des moyens de production, la revendication de «l’initiative personnelle et autonome en matière économique» a fini par être éclipsée au profit d’une théologie de la libération qui consiste, de fait, à se libérer de toute théologie.
L’Église a jugé inutile de réitérer sa condamnation du matérialisme historique.
Mais il ne s’agissait pas d’un silence d’approbation.
Évidemment, les apôtres du marxisme chrétien l’ont compris autrement : « Qui ne dit mot consent. » Et la “pourpre cardinalice” a été enrôlée de force sous la bannière rouge.
LE MATÉRIALISME DES NEUROSCIENCES
INDIQUE QUE LES SCIENTIFIQUES
ONT PEUR DE L’INITIATIVE INDIVIDUELLE
Le matérialisme historique, discrédité en tant que théorie, reste très fort en tant que présupposé inconscient chez les intellectuels.
À votre avis, cela va-t-il durer encore longtemps ?
Il est étonnant de voir le matérialisme survivre aux démentis sanglants que lui inflige l’histoire et à la ruine matérielle des sociétés qu’il a construites, c’est-à-dire détruites. Mais le prestige du matérialisme reste intact parmi les intellectuels.
Son pouvoir simplificateur continue de fasciner les esprits : il est séduisant parce qu’il est réducteur.
Certes, plus personne n’ose parler ouvertement des forces productives, des rapports de production, des contradictions dialectiques du capital ou de la lutte des classes.
Mais, dans la construction du marché mondial, on ne parle que de structures, d’institutions, d’uniformisation.
De même, le développement des neurosciences dans une direction strictement matérialiste indique la peur qu’ont les scientifiques de la capacité d’initiative de l’individu.
Qu’on le veuille ou non, ce sont les hommes qui font l’histoire, et non l’histoire qui les fait. Mais une mode intellectuelle, courante dans les sciences humaines, considère cette assertion comme une hérésie.
Si nous nous abandonnons à cette mode, ces sciences ne seraient humaines que de nom. Il faudrait les appeler sciences de la matière humaine.
Il me semble que Bergson a très bien expliqué cette tendance de l’intelligence humaine à la raideur géométrique, cette prédilection pour les organigrammes impersonnels, cette rechute de l’énergie spirituelle dans l’inertie matérielle.
LE MANICHÉISME
A ENCORE
DE BEAUX JOURS DEVANT LUI.
La force persuasive du matérialisme historique étant en grande partie due à l’imprégnation de l’imaginaire collectif par les arts et les spectacles, ne pensez-vous pas qu’une nouvelle vision des choses restera inefficace tant qu’elle n’influence pas la mentalité des artistes ?
Croyez-vous vraiment que “Le Cuirassé Potemkine” ou les Chœurs de l’Armée rouge ont contribué à imprégner les esprits des thèses du matérialisme historique ?
La dernière scène de “Potemkine” exalte la contingence de l’adhésion fraternelle libre à la Révolution.
Quant aux Chœurs de l’Armée rouge, ils chantent les exploits de Tchapaïev en traversant l’Oural ou ceux de Koutouzov face aux armées de Napoléon.
Ils se produisent dans le monde entier : ce sont l’une des rares institutions à avoir survécu au régime communiste.
Ce sont de belles voix de basse en uniforme, mais ce ne sont pas des arguments en faveur de la dialectique du marxisme-léninisme.
Je crois plutôt que la force persuasive du matérialisme historique est latente dans tous les esprits.
Elle exprime la sécurité d’un schéma immuable, le culte d’une science prétendument «pure», le mythe de l’infaillibilité, la peur de l’innovation et, en fin de compte, la tendance à la défiance.
Je ne nie pas que les cinéastes et les romanciers se délectent des intrigues de la lutte des classes. Mais est-ce leur faute si le public les apprécie encore ?
Le manichéisme a encore de beaux jours devant lui.
NOUS SOMMES TOUS
DES MATÉRIALISTES HISTORIQUES
INCONSCIENTS.
Le libéralisme, vainqueur dans le domaine économique, ne risque-t-il pas de sombrer si la culture reste sous l’hégémonie socialiste ?
Le libéralisme ne serait-il pas victime d’un matérialisme historique inconscient ?
Votre suggestion est pertinente, et je la souscris volontiers.
Nous sommes tous, à divers degrés, des matérialistes historiques inconscients.
Même lorsque nous sommes persuadés du contraire, nous adhérons à la thèse du primat de l’infrastructure économique et matérielle sur la superstructure culturelle et spirituelle.
Cette tendance innée offre une sécurité intellectuelle et un alibi contre l’exigence de responsabilité et le défi de l’adaptation continue.
Encore une fois, l’hégémonie culturelle socialiste n’est pas, en soi, une fatalité. Il faut croire que le public des démocraties trouve une certaine satisfaction dans cette hégémonie et y soulage, par ce moyen, un fort sentiment de culpabilité face aux responsabilités qu’il n’a pas assumées.
Privée de son ennemi héréditaire (le communisme), l’économie de marché doit gérer seule la création et le partage des richesses.
Elle doit relever le défi d’un développement humain et équitable, fondé sur des initiatives libres et compétitives.
LE LIBÉRALISME ÉCONOMIQUE
NE PEUT SURVIVRE
SANS UN LIBÉRALISME CULTUREL.
Dans la même ligne de pensée : n’est-ce pas une erreur tragique de supposer que la libéralisation de l’économie est la condition nécessaire et suffisante de toutes les autres libertés ?
N’est-il pas concevable qu’un État puisse être libéral en économie et dictatorial en tout le reste ?
Par exemple, aux États-Unis, le libéralisme est hégémonique en économie, l’étatisme recule, mais l’intervention de l’État dans la vie privée des citoyens croît.
Le structuralisme d’inspiration marxiste, dans la lignée d’Ernest Labrousse, a formulé une nouvelle « loi des trois états » : l’économique commande le social, et le social commande le mental.
S’il en était ainsi, il suffirait de libéraliser l’économie pour libéraliser la société et la culture.
Vous citez, à juste titre, l’exemple des États-Unis.
On peut dire que les États-Unis sont «libertariens» sur le plan économique, mais «communautariens» sur le plan social.
Tout se passe comme si l’extrême déréglementation de l’emploi, des prix, des salaires était compensée par un surcroît de contrôle social.
La prophétie de Tocqueville se confirme donc avec une précision stupéfiante.
En tant qu’acteurs de la vie économique, les Américains « tournent sans relâche autour d’eux-mêmes pour obtenir de petits plaisirs vulgaires.
Chacun d’eux, retiré dans son coin, est comme étranger au destin de tous les autres : ses enfants et ses amis particuliers forment, pour lui, toute l’espèce humaine.
Quant aux privations que subissent ses concitoyens, il est à côté d’eux, mais il ne les voit pas. En revanche, en tant que citoyens des États-Unis, ils sont soumis à un pouvoir immense et tutélaire, qui se charge seul d’assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort, ne cherchant qu’à les fixer irrévocablement dans l’enfance » (“De la Démocratie en Amérique”, T. II, partie 4, chap. 6).
En Chine, nous avons un autre cas du slogan « l’économie d’abord » pour éviter que l’expression culturelle et psychologique des frustrations matérielles accumulées pendant quarante ans de communisme ne compromette une transition progressive et prudente vers une libéralisation culturelle.
Les « Cent Fleurs » ont rendu les Chinois prudents.
Mais, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, le contrôle social rigoureux s’assouplit progressivement, alors qu’aux États-Unis, nous assistons à une régression presque infantile.
Dans tous les cas, le libéralisme économique ne peut s’étendre et survivre sans un libéralisme culturel et psychologique, c’est-à-dire sans une culture et un climat de confiance : confiance dans la compétition des initiatives responsables, confiance dans la mobilité intellectuelle, géographique, professionnelle, pari sur l’adaptation, l’innovation, les échanges.
L’IDÉOLOGIE GAY
EXPRIME UNE DÉFIANCE
ENVERS L’AUTRE SEXE.
Les nouveaux courants d’opinion nés après la dernière guerre mondiale (féminisme, négritude, idéologie gay, etc.) ne sont-ils pas de nature à favoriser davantage la défiance que la confiance ?
Ces nouveaux courants d’opinion sont nés du choc des deux guerres mondiales. L’émancipation des femmes, par exemple, a commencé au lendemain de la Première Guerre : les infirmières et les ouvrières de l’armement ne voulaient pas rentrer chez elles comme si rien ne s’était passé.
De même, les colonies africaines, sollicitées par l’effort de guerre, ont pris conscience que leurs « devoirs » impliquent la reconnaissance de « droits ».
La décolonisation est le produit des deux guerres.
Mais, à côté de ces justes revendications, ou au sein même de celles-ci, s’expriment des tendances au repli, à la volonté de chacun d’être lui-même sans l’autre, de rester « entre les siens », sans mélange, sans capacité d’intégration, sans effort d’adaptation.
C’est une réaction comparable à la régression endogamique qui affecte certaines sociétés « primitives ».
On peut se demander si l’idéologie gay, qui se dit tolérante, ouverte, etc., n’exprime pas, dans bien des cas, une défiance envers l’autre sexe, une peur de la différence sexuelle. La véritable confiance, en revanche, n’est ni un enfermement en soi ni une fusion et une perte de soi.
PEU IMPORTE DE TUER DES INNOCENTS
AU NOM DU PROLÉTARIAT
OU DE LA RACE SUPÉRIEURE.
Une chose qui m’a beaucoup frappé depuis mon arrivée en France la semaine dernière, c’est que tout le monde semble associer très facilement le Front National de M. Le Pen à l’histoire des crimes nazis, tout en s’obstinant à ne faire aucune association analogue entre l’extrême gauche et les crimes incomparablement plus grands du régime communiste en URSS, en Chine, etc.
Pourquoi est-il si facile d’être gauchiste sans jamais être tenu responsable des maux du stalinisme, alors que l’homme de droite est toujours menacé d’être associé au néofascisme ?
Pourquoi est-il si facile de diriger la défiance contre les hommes de droite ?
La fascination des intellectuels pour l’idéologie marxiste a introduit deux poids et deux mesures dans l’évaluation des crimes contre l’humanité.
On dirait que les millions d’homicides perpétrés par l’Union soviétique ne sont pas de même nature que ceux commis par l’Allemagne nazie.
Torturer et tuer un innocent au nom du prolétariat ou de la race supérieure ne devrait faire aucune différence.
Parodiant une formule célèbre, on pourrait dire qu’il vaut mieux se tromper avec Staline qu’avec Hitler.
Pourtant, la biologie aryenne et la biologie soviétique sont des impostures du même niveau.
Et même en supposant que le marxisme-léninisme soit « scientifiquement supérieur », aucun savoir, aucun programme ne justifie l’élimination physique ou morale d’un seul individu.
Il est temps, comme l’a dit Hannah Arendt, de comprendre que les extrémistes de droite et de gauche sont solidaires dans le crime.
En revenant aux soubresauts de la politique française, il faut souligner l’évidente mauvaise foi d’une gauche qui se fait passer pour une vierge effarouchée par les « voix du Front National », alors que personne ne s’émeut des voix du Parti communiste, sans parler de l’extrême gauche encore plus dure.
Reconnaissons, toutefois, que les déclarations troubles, peut-être perverses, du président du FN sur les inégalités des races, sur le « détail » des crématoires, et la position fluctuante qu’il maintient entre le contrôle légitime de l’immigration et un déchaînement de pulsions xénophobes, tout cela facilite l’association du FN à l’histoire des crimes nazis.
De manière plus générale : si la droite accepte de renoncer à toute alliance avec l’extrême droite, tandis que la gauche conserve son droit de s’allier avec qui elle veut (même avec l’extrême droite), la droite ne risque-t-elle pas de se suicider ?
Que sera la politique française demain, selon vous ?
Les élections régionales et cantonales de 1998 se sont déroulées dans une atmosphère de pièges et de chantage.
La gauche est parvenue à intimider la droite et à lui dicter son comportement face aux électeurs.
Elle a prétendu donner des leçons de républicanisme en brandissant le FN comme un épouvantail (elle, qui a toujours traficoté le mode de scrutin pour diviser la droite, favorisant le FN).
Il est urgent de sortir de cette logique des alliances et des mariages d’occasion, de ces anathèmes républicains et de ces excommunications.
Les droites peuvent et doivent se rassembler. Elles sont majoritaires dans le pays.
Elles doivent reconquérir, pour un programme de droite, toute leur base électorale, y compris les électeurs du FN, qui n’appartiennent ni à la gauche qui s’en sert pour discréditer la droite, ni à la droite classique qui a besoin de leurs voix.
Les électeurs qui ont voté pour le FN n’appartiennent qu’à eux-mêmes.
S’ils succombent aux sirènes du racisme et de la xénophobie, nous ne voulons pas de leur soutien. S’ils acceptent une politique de droite respectueuse des droits humains, nous devons la leur proposer.
Leur exaspération est aussi respectable que la colère des partisans de la Ligue communiste révolutionnaire.
La seule issue pour la politique française est de lever l’anathème qui pèse sur les électeurs du FN et de leur proposer une véritable politique de droite, sans haine ni vengeance, une politique d’exigence, de respect, de solidarité et d’entreprise, en somme : une société de confiance.
LE COMMUNISME ET LE NAZISME
ONT EXPLOITÉ LE RESSENTIMENT
DES MINORITÉS ETHNIQUES.
La confiance n’a-t-elle pas, parmi ses présupposés indispensables, l’unité ou la cohérence de la culture, c’est-à-dire des sentiments et des valeurs ?
Comment envisagez-vous une politique de confiance dans les conditions du « multiculturalisme » ?
La confiance est à la fois cause et effet de la cohésion culturelle.
Sans langue commune, sans valeurs partagées, sans points de référence collectifs, pas de confiance.
Mais, sans confiance, les points de référence s’effondrent, les valeurs divergent en fonction d’intérêts particuliers.
La langue elle-même cesse d’être un instrument de transmission et de cohésion pour devenir un critère de ségrégation, voire d’exclusion.
Elle était une voie de communication : elle devient une barrière.
Nos sociologues ont décrit ce phénomène de sclérose, auquel ils ont eux-mêmes cédé. Dans “Ce que parler veut dire” ou “La Reproduction”, Pierre Bourdieu a mis en évidence le rôle discriminatoire des usages linguistiques, mais il l’a fait dans une langue qui, elle-même, est rarement accessible au commun des mortels.
Il aurait dû en tirer la conclusion qui s’impose : la perte, chez un peuple, de son identité nationale constitue une menace pour la confiance sociale indispensable.
Les expériences de bilinguisme officiel ont montré qu’on ne change pas de culture comme on change de chemise.
Goethe disait que celui qui ne connaît pas de langue étrangère ne connaît pas vraiment sa langue maternelle. Je le crois aussi.
Mais le contact et l’échange avec l’autre n’impliquent ni fusion, ni interchangeabilité, ni indifférenciation.
D’ailleurs, l’universalisme forcé prépare le lit des séparatismes, des revendications agressives, comme l’ont montré les ex-fédérations des Républiques socialistes.
N’oublions pas que Staline a commencé sa funeste carrière comme commissaire aux nationalités, ni que le régime nazi a exploité systématiquement les frustrations des minorités ethniques.
Les ethnies sont comme l’Etna. Elles semblent avoir perdu tout caractère vital, et leur activité semble se réduire à quelques numéros folkloriques, survivances d’un lointain passé d’éruptions et de conflits. Mais si l’on tente d’éteindre ces manifestations de surface, elles reviennent avec force, vomissant des laves ardentes.
Le cosmopolitisme, lorsqu’il perd le respect de l’âme des peuples, ressemble à un édifice construit au-dessus de la bouche d’un volcan.
Le concert des nations doit rester une polyphonie, où de nombreuses voix, aux timbres variés, se joignent et se superposent dans des rythmes différents mais harmonisés, où les refrains et les couplets se répondent d’un côté à l’autre.
Une monotonie forcée engendrerait la dissonance et la discorde.
L’unisson forcé produit la désunion.
Il faut donc prendre le multiculturalisme au sérieux.
Loin d’être un obstacle à pulvériser, il pourrait bien constituer un point d’appui nécessaire à l’Organisation des Nations Unies, comme l’a pressenti Claude Lévi-Strauss.
Unies ne veut pas dire uniformes, ni réduites à l’identique.
Le mythe d’une identité universelle se révèle aussi dangereux que la culture systématique des particularismes locaux.
Personne ne détient le monopole de l’humain, et surtout pas une institution qui prétend représenter les aspirations de tous les hommes sans demander leur avis.
LE NOUVELLE ORDRE MONDIAL :
UNE BUREAUCRATIE EN HAUT,
LE CHAOS ET LE BANDITISME EN BAS.
Dans un monde où les organisations criminelles, comme la mafia russe, répandent partout une atmosphère de secret et de conspiration, tandis que, d’un autre côté, se constitue quelque chose comme un État mondial, ou du moins une police globale pour les affronter, les facteurs de défiance ne tendent-ils pas à devenir incomparablement plus forts que les facteurs de confiance ?
Comment envisagez-vous une société de confiance à l’échelle mondiale ?
Le nouvel ordre mondial risque fort de ressembler à un édifice très instable.
À la surface et en hauteur, une bureaucratie universaliste sûre de l’exactitude de ses plans.
Mais, dans les sous-sols de l’édifice, un réseau souterrain de luttes d’influences, de marchés clandestins.
La seule alternative au développement du banditisme est l’application vigilante du principe de subsidiarité, le refus de concentrer l’organisation de la société, des échanges, des prix agricoles, à un niveau trop élevé.
La confiance se vit dans la relation bilatérale d’échange de biens et de services, dans le respect des spécificités locales.
Elle ne se décrète pas d’en haut, car la confiance ne s’ordonne pas.
C’est elle qui ordonne tout.
C’est à partir de micro-sociétés de confiance – entreprises, associations culturelles, groupements d’intérêts économiques – que se construit une société de confiance à l’échelle mondiale, et non l’inverse.



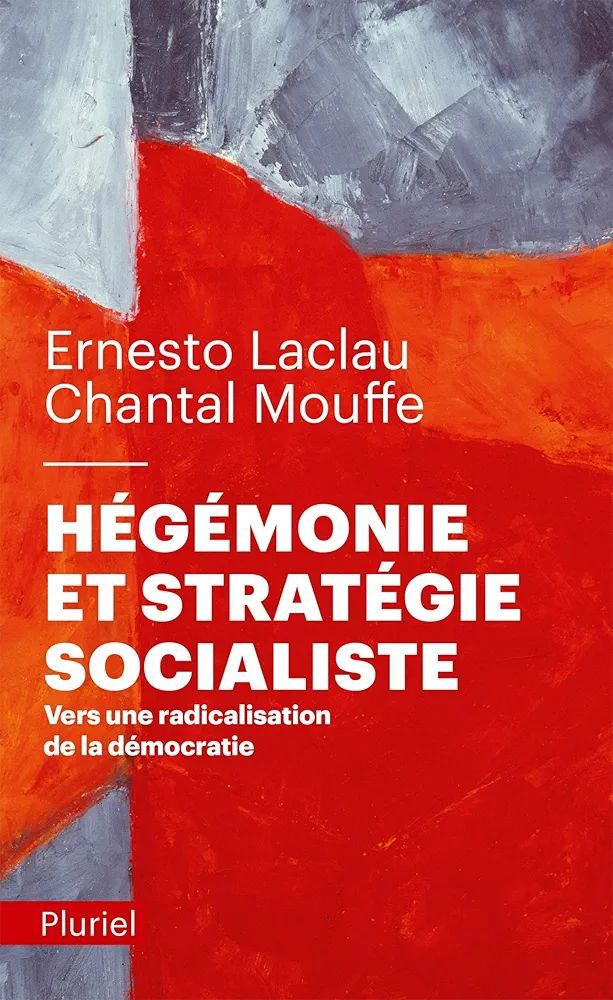
















































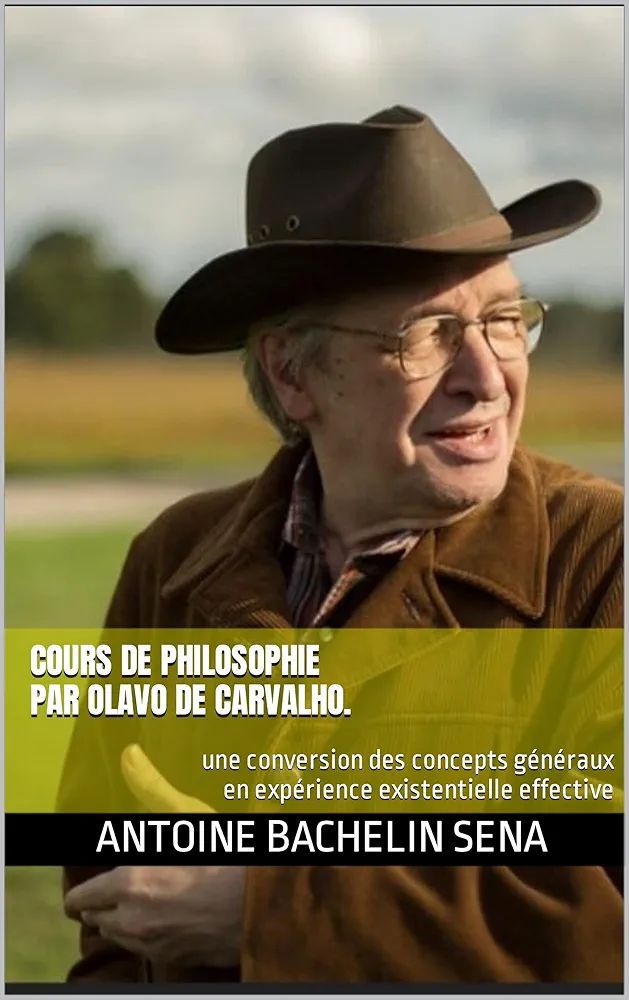



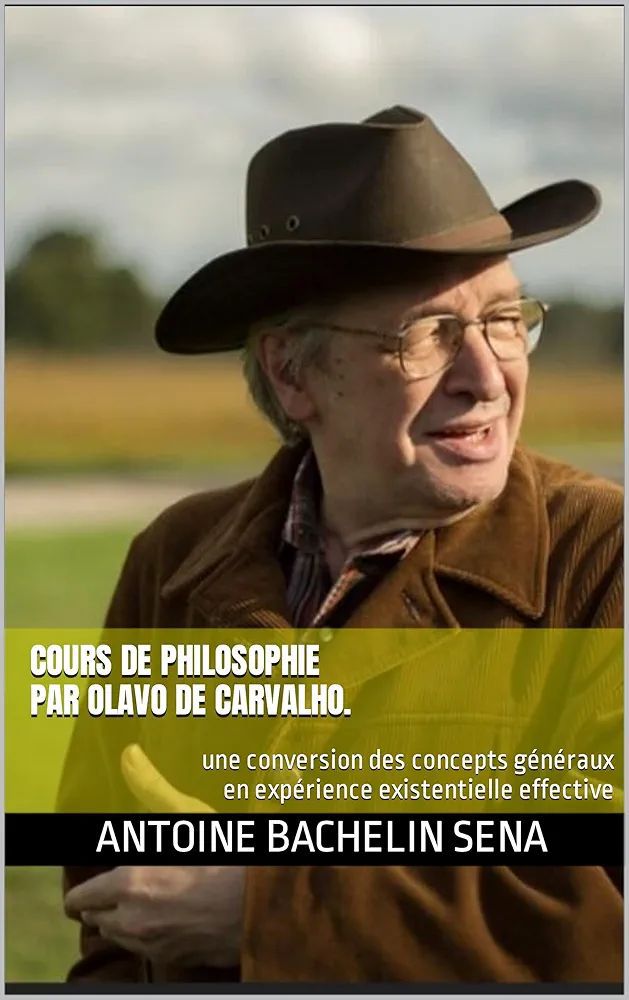


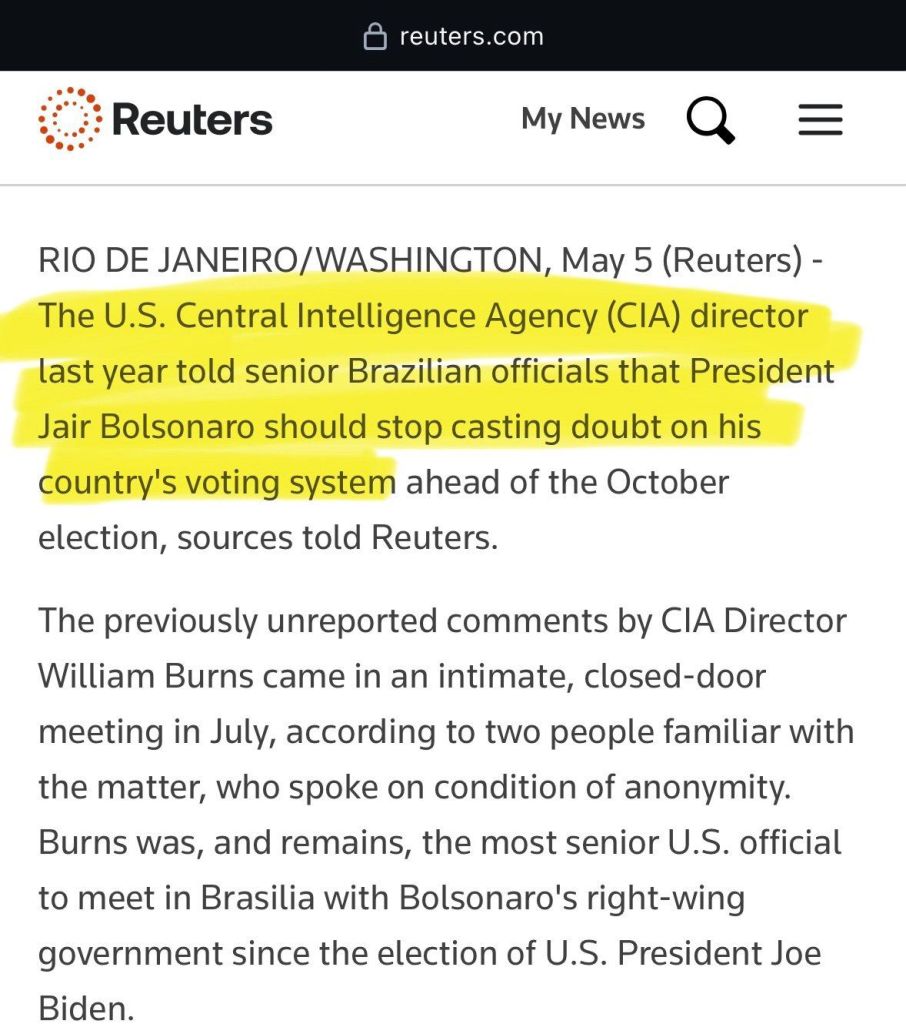
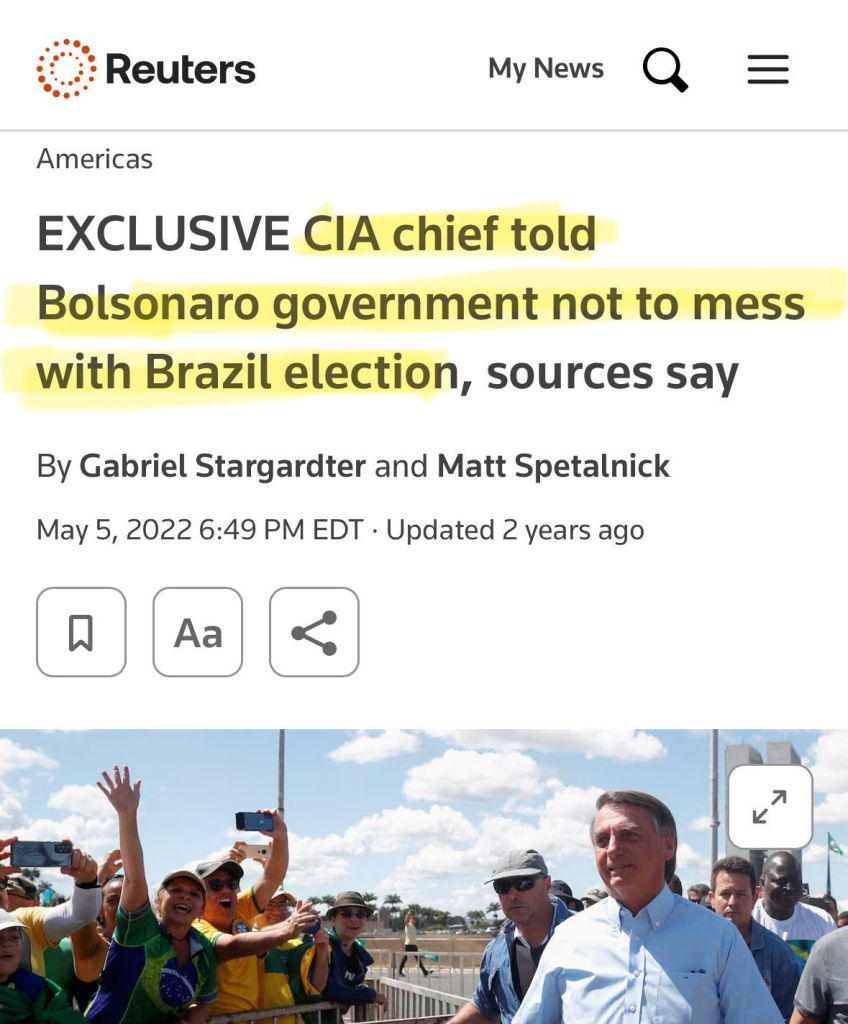













Vous devez être connecté pour poster un commentaire.