Étiquette : Dictature
Pourquoi Gaza OUI et Venezuela NON ? Quelles sont les œillères à retirer ?

Les médias alternatifs dénoncent ce qu’il se passe à Gaza mais un silence entoure les crises au Venezuela, à Cuba et au Nicaragua marquées par l’exode, la répression et la misère économique.
Pourquoi ce contraste ?
- Il s’explique tout d’abord par un raccourci, une vision binaire anti-occidentale : il s’agit d’une caricature qui ignore les abus et idéalise les régimes socialistes latino-américains comme des bastions de résistance contre “l’occident opresseur impérialiste”.
- Dans le même temps, cette caricature ignore les dynamiques complexes de pouvoir pour préserver une cohérence idéologique.
- De plus, les alliances géopolitiques en place avec ces pays biaisent les analyses de certains médias alternatifs, les poussant à taire les échecs des régimes socialistes latino-américains tout en amplifiant la crise à Gaza.
- Daniel Di Martino démontre par les faits historiques comment le socialisme (via la nationalisation massive, le contrôle des devises et des prix et enfin l’expansion irresponsable des programmes sociaux) est la principale cause de ces crises.
- Finalement, ce silence révèle la présence forte du marxisme culturel comme œillère idéologique que nous détaillerons ci-dessous.
- Il existe aussi une fascination pour la propagande Eurasiste d’Aleksandr Dugin qui est pourtant incohérente dans ses concepts comme nous le montrerons ci-dessous.
Les erreurs philosophiques du marxisme révolutionnaire.
Olavo de Carvalho, dans son analyse philosophique du mouvement révolutionnaire marxiste, offre un éclairage crucial. Il décrit la révolution comme un processus d’auto-transformation sans fin et il identifie trois inversions fondamentales :
- 1) l’inversion du sens du temps, où le futur utopique prime sur le présent ;
- 2) l’inversion sujet/objet, où l’individu est subordonné au collectif ;
- 3) l’inversion de la responsabilité morale, où les moyens justifient la fin.
Ces inversions expliquent pourquoi les médias alternatifs idéalisent des régimes socialistes comme le Venezuela, le Nicaragua et Cuba malgré leurs échecs.
Le socialisme comme source des crises latino-américaines.
Trois mesures ont précipité l’effondrement :
- 1) la nationalisation massive, qui a détruit la production agricole (en chute de 75 % en deux décennies) et pétrolière ;
- 2) le contrôle des devises et des prix, qui a engendré un marché noir, une corruption massive et des pénuries ;
- 3) l’expansion irresponsable des programmes sociaux, financée par l’impression monétaire, qui a alimenté une hyperinflation.
Ces politiques ont ruiné l’économie et poussé 7 millions de Vénézuéliens à l’exil.
Des dynamiques similaires s’observent au Nicaragua et à Cuba et ces échecs socialistes, documentés par des organisations comme Human Rights Watch, devraient attirer l’attention des médias alternatifs.
Pourtant, ils restent muets, préférant idéaliser par un raccourci caricatural ces régimes comme des symboles de résistance anti-occidentale.
L’œillère idéologique d’un marxisme culturel non compris.
Le silence des médias s’explique aussi en partie par un marxisme culturel non compris.
Certains médias réduisent la géopolitique à une lutte binaire entre un “Occident impérialiste” et des “forces de résistance”.
Cette vision simpliste néglige les dynamiques complexes de pouvoir et n’a pas connaissance des analyses nuancées de penseurs comme Louis Althusser, Ernesto Laclau et Chantal Mouffe.
Althusser, avec sa théorie des appareils idéologiques d’État, montre comment les institutions culturelles façonnent les consciences, tandis que Laclau et Mouffe, dans Hégémonie et stratégie socialiste, insistent sur la construction de récits collectifs pour fédérer des luttes diverses.
Pourtant, les médias alternatifs adoptent une approche manichéenne et échouent à appliquer ces outils pour critiquer équitablement les régimes socialistes et l’Occident.
L’Eurasisme de Dugin : une vision simpliste et biaisée.
L’influence de l’Eurasisme d’Aleksandr Dugin joue un rôle central dans le silence des médias.
Dugin oppose des “puissances terrestres” (Russie, Chine) autoritaires et traditionnelles à des “puissances maritimes” (États-Unis, Royaume-Uni) libérales et mercantiles, prétendant également que les premières incarnent une transcendance spirituelle face à l’individualisme matérialiste des secondes.
Cette dichotomie, inspirée de penseurs comme Mackinder et Haushofer, repose sur une vision géopolitique caricaturale qui divise le monde en blocs opposés.
Dugin soutient que les puissances terrestres, comme la Russie, privilégient le politique et le spirituel sur l’économique, tandis que les puissances maritimes, menées par les Anglo-Saxons, incarnent un libéralisme économique destructeur.
Il trace cette opposition jusqu’à l’Antiquité, comparant Rome (terrestre) à Carthage (maritime), et dans la modernité, la Russie et l’Allemagne face à l’Angleterre et les États-Unis.
Mais avec une rigueur philosophique il est possible de démonter cette construction car les États, nations ou empires ne sont pas des agents historiques primaires.
Ce sont des résultats de processus complexes impliquant des forces plus durables comme les religions, les dynasties familiales, les sociétés ésotériques ou les mouvements révolutionnaires.
Par exemple, l’influence de l’Église orthodoxe russe a survécu à l’Empire de Kiev, à l’Empire tsariste et à la Révolution bolchevique.
Cette Église, et non l’“empire eurasien” imaginaire de Dugin, est un des véritables agents historiques, car elle maintient une continuité d’action à travers les siècles.
L’“empire eurasien” n’est qu’une métaphore élastique, incapable d’unifier des idéologies contradictoires comme le socialisme vénézuélien, le conservatisme orthodoxe russe, ou l’islamisme radical.
Dugin confond également le collectif (les structures autoritaires des puissances terrestres) avec le supra-individuel (le spirituel), assimilant à tort l’autoritarisme à une transcendance.
En réalité, le collectif et l’individuel sont deux faces d’une même réalité, et la véritable transcendance réside dans la liberté de l’âme humaine.
Dugin commet une autre erreur en ignorant les faits historiques.
Par exemple, l’Union soviétique, une prétendue “puissance terrestre”, exerçait une influence mondiale, y compris en Amérique latine, défiant la notion d’un clivage strict entre puissances terrestres et maritimes.
De plus, la liberté économique, que Dugin associe aux puissances maritimes, trouve ses racines dans la tradition catholique ibérique, bien avant les Lumières.
En effet on peut noter que les premières puissances maritimes modernes, l’Espagne et le Portugal, ont été marginalisées par les Anglo-Saxons, contredisant le schéma simpliste de Dugin.
Enfin, Dugin ne reconnaît pas que son projet eurasien est subordonné à l’Église orthodoxe, qui lie son expansion à celle de l’empire russe, contrairement à l’Église catholique (avant Vatican II) qui est capable de s’étendre indépendamment des empires.
Cette confusion entre agents historiques et entités géopolitiques rend la vision de Dugin incohérente.
Les médias alternatifs, séduits par l’Eurasisme, adoptent cette grille de lecture pour percevoir le Venezuela, le Nicaragua et Cuba comme des alliés anti-occidentaux.
Cette idéologie leur permet de justifier leur silence sur les abus de ces régimes, qu’ils considèrent comme des remparts ou des résistants contre l’hégémonie de l’impérialisme américain.
En réalité, l’Eurasisme de Dugin sacrifie la vérité des souffrances individuelles à une vision holiste qui glorifie des structures autoritaires.
Cette fascination explique pourquoi ces médias focalisent leur indignation sur Gaza, où l’Occident est facilement blâmable, tout en ignorant les crises latino-américaines, où des régimes alignés sur l’axe Russie-Chine reproduisent des abus similaires.
Confusion entre État profond et Amérique.
Les médias alternatifs confondent souvent l’État profond (deep state) – un réseau d’élites non élues influençant la politique – avec l’Amérique dans son ensemble.
Cette erreur les empêche de saisir les dynamiques complexes des États-Unis où des forces divergentes coexistent.
En dénonçant Gaza comme un symptôme de l’impérialisme américain, ils négligent les crises latino-américaines, où des régimes socialistes, alliés à l’axe Russie-Chine, reproduisent des abus similaires.
Intérêts géopolitiques.
Le silence des médias alternatifs sur les crises au Venezuela, au Nicaragua et à Cuba s’explique également par des intérêts géopolitiques qui les alignent avec ces régimes et leurs alliés dans l’axe Russie-Chine.
Ils servent de relais pour les récits anti-impérialistes qui séduisent les médias.
Les médias alternatifs, en relayant ou en s’inspirant de ces narratifs, évitent de critiquer les régimes latino-américains pour ne pas contrarier leurs partenaires idéologiques ou financiers.
Sur le plan géostratégique, les régimes du Venezuela, du Nicaragua et de Cuba sont des alliés clés de l’axe Russie-Chine dans l’hémisphère occidental.
La Russie, par exemple, a investi des milliards de dollars dans l’industrie pétrolière vénézuélienne via Rosneft, tandis que la Chine a fourni des prêts massifs à Caracas en échange de pétrole.
Cuba, de son côté, reste un partenaire stratégique de longue date de la Russie, avec des accords économiques et militaires remontant à l’époque soviétique.
Ces alliances créent un réseau géopolitique où les médias, alignés sur l’axe anti-occidental, évitent de critiquer ces régimes pour ne pas affaiblir leurs partenaires stratégiques.
En se concentrant sur Gaza, où les abus israéliens et le soutien américain sont facilement dénonçables, ces médias maintiennent leur crédibilité auprès d’une audience anti-impérialiste tout en évitant de froisser leurs alliés.
Ce parti pris n’est pas uniquement financier ou stratégique ; il est aussi idéologique.
Les régimes latino-américains, en se présentant comme des victimes de l’impérialisme américain, s’inscrivent dans le récit eurasien de Dugin, qui glorifie les “puissances terrestres” comme des remparts contre l’hégémonie occidentale.
En adoptant ce cadre, les médias deviennent des relais de cette propagande, sacrifiant la vérité des crises humanitaires au Venezuela, au Nicaragua et à Cuba pour préserver leurs alliances où les intérêts financiers et géopolitiques priment sur l’objectivité.
Une analyse sociologique éclaire aussi ce phénomène :
Les médias s’appuient sur des récits et des images des victimes pour mobiliser leur audience et Gaza, perçue comme une victime de l’impérialisme occidental, s’inscrit dans ce cadre, tandis que les crises latino-américaines, causées par des régimes dépeints comme soit disant des “résistants”, sont difficiles à intégrer comme des victimes sans fragiliser le récit révolutionnaire.
Cette sélectivité reflète une stratégie narrative où la cohérence idéologique prime sur la réalité.
La dialectique de l’illusion et de la vérité.
Un dernier élément philosophique est intéressant : la dialectique entre l’illusion et la vérité.
Le marxisme révolutionnaire et l’Eurasisme de Dugin privilégient le collectif en sacrifiant l’individu à des illusions géopolitiques ou eschatologiques.
Cette perspective explique pourquoi les médias négligent les souffrances individuelles au Venezuela, au Nicaragua et à Cuba : en glorifiant des régimes “révolutionnaires”, ils sacrifient la vérité à une vision holiste.
Conclusion : vers une critique cohérente.
Le silence des médias alternatifs sur les crises au Venezuela, au Nicaragua et à Cuba révèlent en plus des influences géostratégiques de l’axe Russie-Chine, l’existence d’œillères idéologiques.
Celles-ci sont ancrées dans un marxisme culturel non compris, dans une fascination pour l’Eurasisme et dans la propagande des récits révolutionnaires gnostiques sur l’imaginaire collectif.
Pour regagner en crédibilité, les médias doivent dépasser les biais géopolitiques ainsi que les œillères idéologiques afin de pouvoir critiquer tous les abus de pouvoir, qu’ils viennent de l’Occident ou de ses adversaires.
Ce n’est qu’en embrassant la complexité de la réalité qu’ils pourront prétendre à une véritable quête de vérité.
Jean 8:32 : « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. »
L’esclavage moderne : une servitude masquée, plus cruelle encore.

Introduction:
Trompés par l’éclat d’un monde où le mot « liberté » est chanté joyeusement, un mensonge effroyable s’étend, redoutable et silencieux, sur les âmes et les corps. L’esclavage, loin d’être relégué aux pages poussiéreuses de l’histoire, s’est réinventé, paré des oripeaux de la modernité.
Ses chaînes, désormais invisibles, sont tissées de dettes, d’impôts et d’illusions.
La véritable oppression est celle qui se fait passer pour une nécessité naturelle.
Sous le vernis d’un progrès célébré, l’esclavage moderne prospère, plus sournois, plus économique pour ceux qui en tirent les ficelles.
L’esclavage moderne : l’esclave finance sa propre servitude.
Dans cette ère qui glorifie la liberté, les esclaves modernes ne sont pas arrachés à leurs terres ni vendus sur des marchés.
Ils se présentent d’eux-mêmes, poussés par la nécessité, et assument seuls les frais de leur existence : logement, nourriture, vêtements, transport.
Ce sont eux qui, par leur labeur, huilent les rouages de leur propre asservissement.
Le génie maquiavélique de cet esclavage réside dans sa mutualisation : les coûts, autrefois portés par un maître, sont aujourd’hui dispersés à travers un système fiscal oppressant.
L’impôt, cette saignée universelle, prélève sur chaque salaire pour financer les infrastructures, les services publics, et des dettes nationales qui enchaînent les générations à venir.
Ainsi, l’esclave moderne paie pour forger ses propres chaînes, croyant œuvrer pour une société équitable.
L’esclavagiste contemporain n’a plus besoin de brandir le fouet.
Il s’appuie sur un réseau d’intermédiaires : gouvernements, multinationales, banques, médias.
Chaque achat, chaque facture, chaque taxe sur la consommation ou taxe foncière est une goutte de sueur versée pour engraisser un système bâti sur l’exploitation.
L’inflation, ce voleur furtif, érode le pouvoir d’achat, tandis que des prélèvements indirects, tapis dans les méandres de la bureaucratie, amputent le fruit du travail.
Pour chaque euro gagné, combien reste-t-il vraiment ?
Un dixième, peut-être, après le passage des collecteurs invisibles.
La plantation moderne : une liberté en trompe-l’œil.
On nous vante la liberté de choisir son employeur, son métier, sa « plantation ». Mais ce choix n’est qu’une illusion.
Quelle que soit la plantation, le maître demeure le même : un système économique qui siphonne la richesse produite par les travailleurs pour l’entonnoir d’une élite.
Les grandes fortunes, ces nouveaux barons, n’ont aucun intérêt à voir cet ordre s’effondrer.
La liberté véritable est celle qui nous affranchit de l’esclavage intérieur.
Mais comment s’affranchir quand l’éducation façonne des esprits dociles, quand les médias détournent les regards vers de fausses causes, de faux ennemis ?
Les âmes, engourdies par des slogans et des distractions, s’inclinent devant des idoles vides, oubliant la quête de leur souveraineté.
Le corporatisme : un fascisme déguisé.
Le corporatisme, cette fusion entre grandes entreprises et pouvoir politique, a enfanté un système où l’employé est sommé de se considérer comme un privilégié.
Travailler devient un honneur, une gloire, un acte héroïque.
Cette rhétorique fait écho à l’inscription cynique ornant l’entrée des goulags soviétiques : « Le travail en URSS est une question d’honneur, de gloire, d’orgueil et d’héroïsme. »

Entrée d’un goulag soviétique avec l’inscription : « Le travail en URSS est une question d’honneur, de gloire, d’orgueil et d’héroïsme. »
Cette image, relique d’une propagande totalitaire, résonne avec les discours modernes qui sanctifient le travail.
Dans les entreprises d’aujourd’hui, rater un objectif ou manquer de performance est perçu comme une faute morale, une honte pour soi et ses proches.
Le salarié, réduit à un rouage d’une machinerie inhumaine, est contraint de s’autodiscipliner, de s’autocensurer, de s’épuiser pour la sacro-sainte productivité.
Ce système, qui monopolise les marchés et étouffe la concurrence, est un fascisme économique où la liberté individuelle est immolée sur l’autel du profit.
Qu’est-ce que l’esclavage ?
L’esclavage, au fond, est la captation du travail d’un individu par un autre, l’aliénation de son temps, de son énergie, de sa vie.
Jadis marqué par l’ethnicité et la brutalité physique, il est aujourd’hui universel, aveugle, insidieux.
Il ne discrimine plus par la couleur de peau, mais par la classe sociale. L’économie mondiale repose sur cette exploitation.
Les grandes fortunes, les multinationales, les élites politiques prospèrent sur le labeur d’une humanité maintenue dans l’ignorance de sa servitude.
La vraie liberté, celle qui briserait ces chaînes, serait de transcender les classes sociales, de reconquérir son travail, sa dignité, son destin.
Un appel à l’éveil.
Ne nous laissons pas séduire par des chimères utopiques.
La réalité est sombre, mais la vérité est une torche.
Reconnaître l’esclavage moderne, c’est déjà faire tomber une chaîne.
Comprendre que notre travail, notre sueur, notre vie sont détournés par un système vorace, c’est poser la première pierre d’une révolte intérieure.
La liberté commence par le refus de l’illusion.
Levons les yeux.
Interrogeons.
Redéfinissons ce que signifie être libre.
Car tant que nous continuerons à payer pour nos propres chaînes, l’esclavage, sous ses formes les plus perfides, régnera en maître.
Le citoyen-spectateur & la démocratie télévisée.

Comment le socialisme a détruit le Vénezuela et non les sanctions US ni les prix du pétrole, par Daniel Di Martino.

De nombreux médias ont imputé l’aggravation de la crise humanitaire au Venezuela aux sanctions américaines, aux prix du pétrole, à la corruption – tout sauf à la montée du socialisme dans ce qui était autrefois le pays le plus riche d’Amérique du Sud !
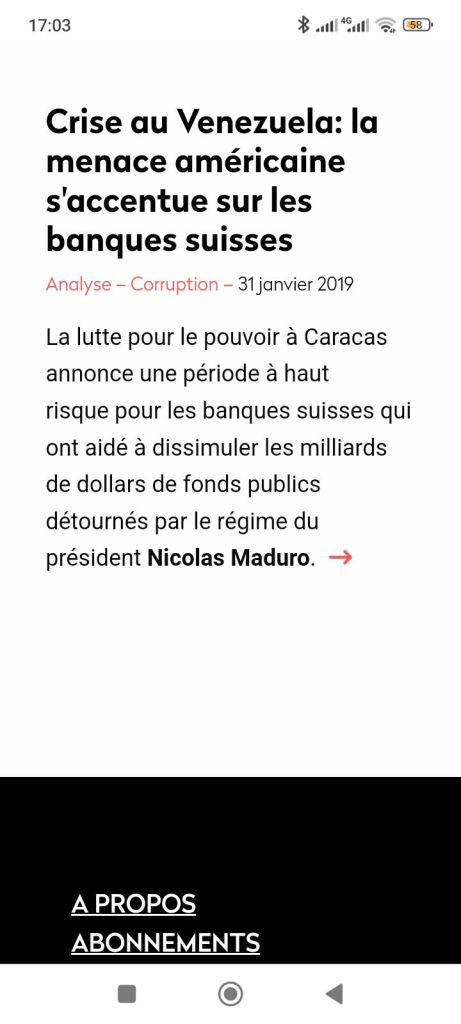
Mais la corruption et la mauvaise gestion sont le résultat direct du contrôle accru de l’économie par le gouvernement – le socialisme – et en réalité, la baisse des prix du pétrole et les sanctions américaines n’ont pas grand-chose à voir avec la crise.
Au contraire, la famine et l’exode massifs auxquels sont confrontés les Vénézuéliens sont la conséquence naturelle des politiques socialistes mises en œuvre par les dictateurs Hugo Chavez et Nicolas Maduro.
Trois principales politiques mises en œuvre par Chavez depuis 1999 ont produit la crise actuelle :
- 1) la nationalisation généralisée de l’industrie privée,
- 2) le contrôle des devises et des prix,
- 3) l’expansion fiscalement irresponsable des programmes de protection sociale.
1) L’une des premières mesures de Chavez a été de commencer à nationaliser le secteur agricole, censé réduire la pauvreté et les inégalités en prenant aux riches propriétaires fonciers pour les donner aux travailleurs pauvres.
Entre 1999 et 2016, son régime a volé plus de 6 millions d’hectares de terres à leurs propriétaires légitimes.
La nationalisation a détruit la production dans les industries concernées, car aucun gouvernement n’a la capacité de gérer des milliers d’entreprises ni de générer des profit et d’innover pour les gérer efficacement. Au lieu de cela, les responsables gouvernementaux sont incités à plaire aux électeurs en vendant des produits à bas prix et en embauchant plus d’employés que nécessaire, même lorsque c’est la mauvaise décision industrielle.
Comme le prévoyait la théorie économique, à mesure que le contrôle de l’État sur l’industrie agricole s’est accru, la production alimentaire du Venezuela a chuté de 75 % en deux décennies, tandis que la population du pays a augmenté de 33 %. C’était la recette pour des pénuries et un désastre économique.
Après l’agriculture, le régime a nationalisé l’électricité, l’eau, le pétrole, les banques, les supermarchés, la construction et d’autres secteurs cruciaux. Dans tous ces secteurs, le gouvernement a augmenté les salaires et distribué des produits à bas prix, ce qui a entraîné des coupures de courant de plusieurs jours dans tout le pays, des interruptions fréquentes du service d’eau, une chute de la production pétrolière et la faillite des entreprises devenues publiques.
Mais prendre le contrôle des secteurs les plus importants de l’économie n’a pas suffi au régime socialiste.
2) En 2003, Chávez a mis en place un système de contrôle des devises étrangères dans lequel le gouvernement a fixé un taux de change surévalué entre la monnaie vénézuélienne et le dollar américain.
L’un des objectifs de ce système était de réduire l’inflation en surévaluant la monnaie et en subventionnant les produits importés. Mais le contrôle des devises a obligé le régime à rationner les dollars américains disponibles pour les importateurs, car, à un taux de change surévalué (bon marché), la demande de dollars américains était supérieure à l’offre.
Naturellement, un marché noir des devises étrangères a émergé et les membres corrompus du régime se sont vu attribuer des dollars américains bon marché et ont obtenu de gros profits.
Pire encore, ce système a en fait accru l’inflation, car la surévaluation de la monnaie a réduit les revenus pétroliers du gouvernement en monnaie vénézuélienne, ce qui a conduit le régime à imprimer de la monnaie pour couvrir le déficit budgétaire qui en a résulté.
Le régime socialiste a également imposé des prix plafonds sur des centaines de produits de base tels que le bœuf, le lait et le papier hygiénique. Avec des prix artificiellement bas, davantage de personnes étaient prêtes à acheter ces produits, mais les quelques usines privées restantes – non nationalisées – ne pouvaient pas tirer profit du prix plafonné par le gouvernement, alors elles ont réduit ou arrêté leur production.
Au lieu de bénéficier aux pauvres, les prix plafonds ont entraîné, comme on pouvait s’y attendre, des pénuries qui les ont obligés à faire la queue pendant des heures, tandis que les employés des supermarchés et les personnes bien connectées obtenaient les produits dont ils avaient besoin.
3) Mais l’aspect le plus néfaste du projet socialiste vénézuélien est peut-être celui que les médias internationaux et les personnalités de gauche ont le plus souvent vanté : les programmes d’aide sociale. Le régime socialiste a créé des « missions » sociales visant à lutter contre la pauvreté, l’analphabétisme, les soins de santé, etc. Mais malgré les revenus pétroliers plus élevés du gouvernement en raison d’une multiplication par dix du prix du baril de pétrole, de 10 dollars en 1999 à plus de 100 dollars en 2008, le régime a financé un déficit croissant en imprimant davantage de monnaie.
Les programmes d’aide sociale et les projets de travaux publics massifs ont ouvert la voie à une corruption toujours plus grande.
Et l’impression de monnaie pour financer des programmes publics sans fin a sans surprise entraîné des taux d’inflation élevés.
C’est ainsi que c’est le socialisme qui a crée la misère au Venezuela et non les prix du pétrole ou les sanctions américaines.
- Les programmes sociaux censés aider les pauvres ont en fait augmenté le coût de la vie.
- Le contrôle des devises étrangères qui visait à réduire l’inflation n’a fait qu’augmenter cette dernière et a permis une corruption massive.
- Et les nationalisations qui auraient dû donner du « pouvoir » aux travailleurs n’ont fait que les laisser au chômage et affamés.
Le socialisme a ainsi entraîné l’hyperinflation et les pénuries généralisées.
De plus, même avec les prix bas actuels du pétrole, le pétrole vénézuélien se vend deux à trois fois plus cher qu’en 1999, en tenant compte de l’inflation. Et la seule sanction américaine susceptible d’affecter les Vénézuéliens ordinaires, l’interdiction des importations de pétrole, n’est en vigueur que depuis deux mois, alors que l’inflation et les pénuries affligent le pays depuis des années.
Alors ne cherchez pas d’excuses.
Comme les Vénézuéliens l’ont appris au cours des 20 dernières années de socialisme, les « choses gratuites » ont un prix élevé.
Source de Daniel Di Martino (@DanielDiMartino) : https://manhattan.institute/article/how-socialism-destroyed-venezuela
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.