«La Haute Culture est l’autoconscience d’une société.
Elle embrasse les œuvres d’art, la littérature, l’érudition et la philosophie qui tracent le cadre de référence commun aux esprits éclairés.»
Telle est la définition ciselée par Roger Scruton.
À peine l’eût-on énoncée qu’elle révèle, en France, un vide abyssal : cette essence s’est évanouie de nos rivages intellectuels bien avant l’aube du XXIe siècle.
Le seul socle partagé qui subsiste, précaire et érodé, n’est plus que celui des médias de masse – ces temples du prêt-à-penser, bruissants de formules éculées, de solécismes assumés et de rengaines cognitives ressassées par une cohorte de commentateurs à peine lettrés.
Au-delà, ne pullulent que des archipels subculturels, ignorants les uns des autres, unis non par un substrat de convictions ou de valeurs, mais par les contingences d’intérêts corporatistes, financiers ou politicards du moment.
Une culture des capitaines d’industrie et des thuriféraires de l’économie libérale ; une autre des catholiques intégristes, ressuscitant des rituels oubliés ; une troisième des activistes arc-en-ciel, brandissant les bannières de l’identité fluide ; une quatrième des robes noires du palais, ourdissant des plaidoiries byzantines.
Mais par-dessus tout, plane la culture des militants de la gauche postmoderne – ces insoumis éternels, écolos radicaux et intersectionnels zélés –, qui déploient, avec une ardeur machiavélique, l’arsenal du chantage moral, de l’intimidation numérique et des subventions occultes pour imposer leur hégémonie.
Ainsi transforment-ils leur bulle idéologique en un ersatz monstrueux de haute culture, le rempart le plus sournois contre toute culture authentiquement élevée.
Scruton lui-même en sonde les fragilités : «La Haute Culture est une conquête fragile, qui ne survit que portée par le souffle d’une tradition vivante et l’assentiment des normes sociales environnantes.
Quand ces soutiens s’évaporent, elle cède la place à une culture de faux-semblants. La contrefaçon repose sur une connivence perverse entre l’imposteur et sa proie : ils ourdissent ensemble le mensonge d’une croyance feinte, le simulacre d’un sentiment qu’ils ne sauraient éprouver.»
Ce constat, qui évoque irrésistiblement les pages glaçantes de la “Ponerologie” du Dr Andrew Łobaczewski – ce traité impitoyable sur l’hystérie collective qui gangrène une société dès lors que les psychopathes s’emparent des leviers du pouvoir –, trouve en France une illustration d’une acuité chirurgicale, emblématique de notre époque.
Nul n’ignore que Michel Foucault reste l’un des phares – ou plutôt des ombres– les plus rayonnants dans les amphithéâtres des universités.
Ce pionnier d’un marxisme muté en hydre post-structuraliste imprègne les campus comme une doxa officielle, que l’élite académique française n’a pas seulement ingurgitée, mais remodelée en une variante si singulièrement gauloise qu’elle en devient presque folklorique.
Pourtant, comme le souligne un critique récent (https://www.researchgate.net/publication/364144219_How_Foucault_Got_Rid_of_Bossy_Marxism), Foucault, bien qu’évoluant dans le creuset de la théorie de gauche des années 1960 et 1970, où le marxisme régnait en maître, s’en est distancié, diluant l’analyse des classes en un jeu subtil de pouvoirs.
Karl Marx, on le sait, forgea l’idéologie selon laquelle les idées qui circulent ne seraient que les reflets déformés des intérêts objectifs des classes sociales. Certes, certaines le sont ; mais Marx postule que toutes le sont, que nul recoin de l’esprit n’échappe à cette partition binaire du champ mental entre «idéologie prolétarienne» et «idéologie bourgeoise».
Pourtant, une faille béante mine cette édifice dès sa genèse : ou bien les idées et croyances d’un individu sont rivées à sa condition de classe, ou bien, appartenant à une caste, il peut, par un saut du raisonnement, embrasser l’idéologie adverse – comme le fit, précisément, le bourgeois prussien Karl Marx lui-même. Pour que cette transmutation ne soit pas un caprice irrationnel, une extase irraisonnée, il requiert un espace neutre, un no man’s land intellectuel d’où l’âme en péril scrute les idéologies belligérantes et élit son camp par pure souveraineté.
Mais si tel saut est possible – et Marx en fut la preuve vivante –, alors l’idéologie personnelle s’affranchit de la dictature de classe, et l’expression «idéologie de classe» n’est plus qu’une métaphore creuse, un ornement rhétorique.
il est donc logique d’user de cette théorie avec une once de scepticisme, ou l’archiver au panthéon des utopies hasardeuses.
Michel Foucault, loin de ce recul, opta pour l’exacerbation.
Poussée à l’extrême, sa radicalisation aboutit à ce verdict impitoyable : face à une idée ou une assertion, sa vérité ou son mensonge importe peu ; sa fidélité aux faits est vaine.
Seul prime le «schéma de pouvoir» qu’elle sert, et ces schémas se réduisent à deux : celui des «oppresseurs» et celui des «opprimés» – échos à peine voilés des «bourgeois» et «prolétaires» marxistes.
La simple aspiration à arbitrer les idées par leur conformité à la réalité n’est déjà qu’un «schéma» au service des tyrans.
La vérité ? Une illusion obsolète.
Le “philosophe”, libéré de ces chaînes, doit n’élire que ce qui gonfle les voiles du pouvoir opprimé.
Dans un récent débat sur l’influence foucaldienne, un analyste souligne que «Foucault est souvent présenté comme le penseur des micropouvoirs et le théoricien des dispositifs, ces perspectives permettant de discréditer l’étude des macropouvoirs traditionnels».
(https://journals.openedition.org/rsa/1755)
Évidemment, cette négation de la vérité se pare elle-même du manteau de la vérité absolute, sombrant dans un cercle vicieux qui, au bout du compte, ne profère que le vide.
Pourtant, un aveu s’impose : Foucault, qui proclamait la vérité abolie, la traquait avec une ferveur quasi mystique dans sa propre doctrine.
Ses vastes fresques sur le panoptique carcéral, les manicomes du XIXe siècle ou l’archéologie de la sexualité déploient un labeur titanesque pour ancrer, via faits et archives – hélas trop souvent romancés –, le lien entre idées et intérêts qu’il imputait aux foules.
C’est ici que surgit le phénomène de notre époque, et tellement français, que j’évoquais.
Dans les séminaires sorbonnards, les tribunes politiques ou les colonnes des journaux en ligne, l’intellectuel gauchiste typique – disons un fervent lieutenant de La France insoumise comme François Ruffin, qui, bien qu’ayant rompu avec le parti en 2024, incarne encore cette doxa, ou une idéologue comme Sophia Chikirou, affirmant récemment que «la liberté d’expression en Chine est aussi menacée que celle qu’on a en France» pour minimiser les oppressions ailleurs tout en exagérant celles ici – applique la leçon foucaldienne avec une créativité qui eût sidéré son maître : accuser un auteur ou un polémiste de cautionner tel «schéma de pouvoir», c’est-à-dire de relayer les intérêts d’un groupe social occulte, dispense d’enquêter sur deux points triviaux :
– (a) l’existence réelle de ce groupe ;
– (b) l’appartenance effective de l’accusé à ses rangs, ou même sa connivence avec ses desseins.
(https://www.marianne.net/politique/melenchon/promis-la-chine-n-est-pas-une-dictature-c-est-sophia-chikirou-qui-le-dit)
La réduction des idées à de simples masques d’un «schéma de pouvoir» s’érige en preuve souveraine de leur poison, sans exiger la moindre assisse sociologique tangible.
Si vos mots heurtent l’oreille complaisante de ces gardiens de la doxa, ils vous rattachent d’un trait de plume à une tribu fantôme, ou à une cabale sans lien avec le débat, et l’affaire est réglée.
La validité de votre propos s’évapore non par son ancrage dans votre propre milieu social, mais par son exil forcé vers une faction qui vous est étrangère, ou qui n’a jamais vu le jour.
Ruffin lui-même, dans sa critique de la stratégie de LFI, dénonce une «conception stalinienne de la classe», accusant le parti de racialiser le conflit de classe sans voir que ce conflit est déjà mythifié.
(https://www.politis.fr/articles/2024/10/intersections-francois-ruffin-la-classe-sociale-mythifiee/)
C’est précisément ainsi qu’opéra, en écho à une myriade de plumes progressistes n’ayant pas lésiné sur leurs diagnostics des tumultes récents, le texte d’orientation stratégique de La France insoumise pour son congrès de 2024.
Confronté aux flots humains des manifestations anti-Bayrou et anti-blocages économiques – ces marées de Français de tous horizons, âges et origines, sans chef charismatique ni appui des chaînes publiques, des syndicats ou des lobbies patronaux –, il diagnostiqua une machination ourdie par la «classe dominante», affirmant que « dans les médias dominants, la déontologie est aux abonnés absents et les accusations sans fondement et les mensonges sont légion. Cette stratégie de diabolisation de la France insoumise vise à limiter sa progression électorale et cherche à l’isoler pour maintenir la domination des partisans du système capitaliste, impérialiste et écocidaire« .
(https://lafranceinsoumise.fr/wp-content/uploads/2024/12/ORIENTATION-STRATEGIQUE-VDEF.pdf)
Pilotée, par tous les saints du ciel !, par le tandem BFM-TV et l’immonde Le Monde, qui s’acharnaient pourtant à rapetisser ces soulèvements et à les moquer sous cape.
Dépouillée de ses atours sociologiques, fussent-ils les plus ténus, la théorie foucaldienne s’est muée en une arme paresseuse : accuser quiconque de n’importe quel chef d’accusation, puis regagner son alcôve l’âme en paix, certain d’avoir éventé un «schéma de pouvoir» monstrueux.
De la simulation hystérique, la gauche tricolore a glissé vers la mythomanie délirante.
Foucault sans Foucault : du panoptique à la paranoïa collective.



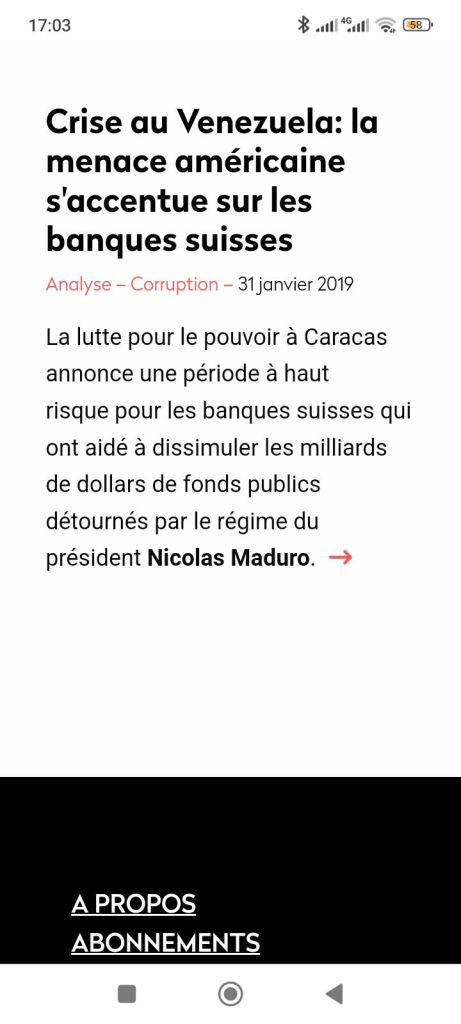
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.