Étiquette : Philosophie
2 vidéos avec Jean Robin.
Duper l’Humanité avec une histoire de nains et d’arrogance.

«Les hommes éveillés partagent un même monde. Mais endormi, chaque homme s’égare dans le sien.» Héraclite définissait ainsi avec précision chirurgicale la règle suprême de la méthode philosophique.
Abraham Lincoln en offrit une paraphrase impitoyable : “on peut duper bien des gens pour un temps, ou quelques-uns pour longtemps, mais jamais tous, éternellement”.
Réaliser que nous arpentons le même sol que les sages de Chine et d’Égypte, les prophètes d’Israël, les mystiques hindous, les prêtres africains et amérindiens, les philosophes grecs et médiévaux européens – devrait éveiller l’intellectuel d’aujourd’hui : si ses thèses ploient sous le poids de l’unanimité séculaire, elles ne pèsent guère plus que de vaines fumées.
Durant des siècles, les philosophes ont vénéré cette unanimité, fussent-ils limités à une vue partielle. Aujourd’hui, les textes fondateurs de toutes les traditions sont acessibles comme jamais auparavant sur le web. L’anthologie monumentale compilée par Whitall N. Perry dans “A Treasury of Traditional Wisdom” s’impose comme un arsenal incontournable.
Il reste stupéfiant, pourtant, que tant de penseurs des deux derniers siècles, dans une ingénuité frisant la démence, aient affirmé que l’humanité s’était globalement trompée sur son essence jusqu’à leur venue – eux seuls déchirant le voile de la réalité authentique.
Des millénaires durant, les générations ont dormi dans des songes collectifs, jusqu’à l’irruption salvatrice de Marx, Freud, Nietzsche ou Heidegger, venus les secouer pour leur révéler – enfin ! – leur vraie place.
Des générations ont recherché profondément Dieu ou la sagesse et Marx les ramène à une idéologie de classe, inconsciemment brandie.
Des générations ont recherché la perfection morale et Freud y voit le masque d’un désir charnel étouffé.
Des générations ont invoqué des idéaux sublimes et Nietzsche y décèle une pulsion vorace de domination.
Des générations se sont centrées sur la présence de l’être et Heidegger les accuse d’avoir tout recouvert de voiles.
Puis surgit le déconstructionniste pour parachever l’humiliation : ces générations n’étaient rien de plus que de simples signes errants dans un récit illusoire.
Même lorsqu’on démasque – les fraudes, les biais, les distorsions, les supercheries, les oeillères, les raccourcis et les dissonances effarantes – les censeurs modernes continuent d’éclipser tout l’héritage ancestral et Socrate ou Lao-Tseu y perdent leur voix propre et sont relégués au rôle de marionnettes.
Conséquence : chaque «nouvelle vérité» n’enrichit pas le fonds du savoir ; elle l’ampute, le voile aux yeux des héritiers.
L’expérience humaine chez eux s’atrophie dans un simulacre rétréci, effaçant des continents entiers de l’héritage universel.
Pour décrocher un billet dans le cénacle intellectuel chic, il faut découper son âme et suivre les contours de ces consciences mutilées, bannissant tout ce qui excède leur champ myope.
L’«autorité de l’ignorance», comme l’appelle Eric Voegelin, règne en maître sur les débats.
Fini le temps où nous étions des nains juchés sur les épaules de géants : nous forçons les colosses à s’incliner afin que les nabots dictent la mesure de l’humain.
Platon et Aristote le savaient : manipuler des notions générales exige d’en décortiquer les strates sémantiques.
Vingt siècles plus tard, les zélites gobent des slogans grossiers, des totems et des formules – «matérialisme dialectique», «libido», «volonté de puissance» – comme autant de vérités objectives, sans daigner les soumettre à la moindre analyse.
Il n’est pas possible de raisonner ces adeptes des fétiches et des incantations.
Persuadés d’occuper le zénith du savoir, les zintellectuels modernes se vautrent en fait dans l’auto-tromperie juvénile.
La maladie des idéologies modernes.

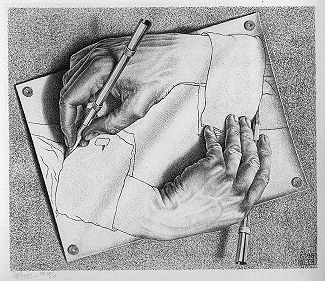
Les idéologies modernes reposent sur une distorsion profonde de la perception du temps : hégélianisme, marxisme, positivisme, nietzschéisme, pensée teilhardienne, transhumanisme, holisme, écologisme, multiculturalisme, théologie de la libération, progressisme globaliste de l’ONU, et autres.
Ce sont des messianismes modernes, dans le sens où ces idéologies imaginent un futur hypothétique comme forme de paradis merveilleux qu’elles érigent en vérité absolue pour réinterpréter le passé. Et c’est ce procédé même qui les empêchent de faire la distinction logique entre ce qui est nécessaire et ce qui est contingent.
– Nécessaire : Ce qui doit être, inéluctable et universel (ex. : lois logiques, 2+2=4).
– Contingent : Ce qui peut être ou ne pas être, dépendant des circonstances (ex. : un choix, un événement).
👉 Les messianismes confondent les deux, traitant des futurs hypothétiques (contingents) comme s’ils étaient inévitables (nécessaires), faussant ainsi la perception du temps.
De plus, lorsque ce futur tant attendu arrive sans que la promesse divine — qu’il s’agisse du Prince de Machiavel, de la société sans classes, du «Surhomme» ou du règne de Gaïa — ne se réalise, des «révisions» surgissent. Et ces révisions transforment l’échec en carburant pour de nouvelles prophéties messianiques, alimentant un cycle sans fin, aussi inépuisable que l’aveuglement humain.
Dans mes recherches sur ce sujet, et parmi les éléments rassemblés, ce qui frappe le plus est la manière dont des esprits, même brillants, perdent leur acuité lorsqu’ils sont emportés par ces courants messianiques. Ils sombrent dans une inaptitude surprenante, incapables de raisonner avec clarté sur des questions élémentaires.
Cette forme contemporaine de bêtise découle d’une fuite hors de la réalité vécue pour s’installer dans une «seconde réalité», un monde illusoire qui n’existe que dans l’esprit des pseudos intellectuels séduits par ces idéologies.
Dans cette seconde réalité, la bêtise passe malheureusement pour de la sagesse chez ceux qui ne voient que cette seconde réalité. Car ce n’est qu’en confrontant les idées aux exigences du réel que l’absurdité devient évidente, révélant l’insensibilité grotesque des adeptes de cette seconde réalité face à la vie concrète.
Prenons l’exemple de Thomas Piketty, le soir disant économiste qui vilipende l’État pour des inégalités galopantes mais qui, dans un numéro d’acrobate, prône un impôt mondial géré par un super-État bureaucratique ! Un salto idéologique à faire pâlir un contorsionniste !
Cette incohérence illustre parfaitement le piège logique des raisonnements messianiques.
Ces errements ne sont pas de simples fautes de logique, car leurs auteurs sont souvent des esprits brillants. Le problème réside dans leur perception. S’ils observaient le monde tel qu’il est, ils verraient qu’il ne correspond pas à leurs projections.
Mais ils le regardent à travers le prisme prophétique d’un futur idéalisé, ce qui le transforme en une image digne des toiles d’Escher, où une main se dessine elle-même ou une échelle en spirale revient à son point de départ. Qu’on appelle cela « dialectique », « holisme », « approche systémique » ou « déconstructionnisme », le constat reste le même : c’est une affliction sérieuse.
Il ne s’agit pas d’une psychose au sens clinique, comme l’ont noté des penseurs tels qu’Henri de Lubac, Albert Camus, Norman Cohn ou Eric Voegelin. Cette maladie est d’ordre spirituel et peut affecter des individus par ailleurs parfaitement fonctionnels dans leur vie quotidienne. Mais ceux qui en sont atteints n’ont aucune conscience de leur trouble. Ils ressentent un profond mécontentement face à une réalité qui ne se plie jamais à leurs attentes, les amenant à rejeter le présent et le passé comme de simples préludes imparfaits à un futur utopique.
Ce mécanisme d’auto-alimentation exacerbe leur déconnexion du réel.
Sur un registre similaire, Karl Kraus observait que certaines époques sont si absurdes qu’elles défient la satire, la réalité se confondant avec la caricature.
Quelques mois après le scandale retentissant du « Penelopegate », François Fillon a défendu l’idée que le népotisme, lorsqu’il concerne son épouse, serait profondément éthique : l’emploi de son épouse comme assistante parlementaire était profondément légitime et éthique, affirmant qu’elle avait travaillé dur pour mériter son salaire.
Et, fait remarquable, de nombreux commentateurs et soutiens politiques se sont empressés de le soutenir.
Hégélianisme.
L’hégélianisme, inspiré de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, envisage l’Histoire comme un processus dialectique menant à l’absolu, où l’Esprit du monde se réalise pleinement dans un futur rationnel et harmonieux. Ce futur hypothétique est érigé en vérité absolue, réinterprétant le passé comme une série de contradictions nécessaires vers cette fin inévitable.
Ainsi, il efface la distinction entre le nécessaire (la progression dialectique) et le contingent (les événements aléatoires), en les subordonnant à une téléologie historique. Lorsque ce futur d’harmonie absolue ne se matérialise pas, des révisions comme le néo-hégélianisme ajustent la doctrine pour promettre une réalisation plus lointaine.
👉 Ce cycle perpétue une foi messianique en un progrès inéluctable, alimenté par l’aveuglement à la complexité réelle du temps.
Marxisme.
Le marxisme, fondé par Karl Marx, prédit un futur communiste sans classes, où le prolétariat triomphe après la révolution, abolissant l’exploitation capitaliste. Ce paradis hypothétique sert de prémisse pour analyser l’Histoire comme une lutte des classes déterminée par les forces productives.
Il confond le nécessaire (le matérialisme historique) avec le contingent (les variations culturelles ou individuelles), en les intégrant dans un schéma linéaire vers le communisme. Face à l’échec des sociétés sans classes, des révisions comme le léninisme ou le maoïsme transforment les déceptions en étapes vers de nouvelles promesses.
👉 Cette boucle infinie repose sur une distorsion temporelle, où l’avenir utopique justifie l’ignorance des réalités présentes.
Positivisme.
Le positivisme, développé par Auguste Comte, imagine un avenir scientifique où l’humanité atteint un stade positif, guidé par la raison empirique et débarrassé des superstitions théologiques et métaphysiques. Ce futur hypothétique est posé comme vérité catégorique pour réinterpréter le passé en trois stades évolutifs inévitables.
Il abolit la frontière entre nécessaire (le progrès scientifique) et contingent (les facteurs irrationnels ou culturels), en les forçant dans une loi des trois états. Quand ce règne de la science pure n’arrive pas, des révisions comme le néo-positivisme adaptent la doctrine pour de nouvelles utopies rationalistes.
👉 Ce mécanisme nourrit un messianisme laïque, inépuisable comme la quête humaine de certitudes absolues.
Nietzschéisme.
Le nietzschéisme, basé sur Friedrich Nietzsche, prophétise un futur dominé par le Surhomme, transcendant les valeurs morales décadentes pour affirmer la volonté de puissance éternelle. Ce futur hypothétique réinterprète le passé comme un cycle de ressentiment et de déclin, menant à une réévaluation de toutes les valeurs.
Il brouille le nécessaire (l’éternel retour) et le contingent (les choix individuels), en les subordonnant à une vision élitiste et créative. Lorsque le Surhomme ne surgit pas, des révisions postmodernes ou existentialistes recyclent l’idée en nouvelles promesses de libération.
👉 Cette perpétuation messianique exploite l’aveuglement à la finitude humaine, générant un cycle d’illusions vitalistes.
Pensée teilhardienne.
La pensée teilhardienne, de Pierre Teilhard de Chardin, envisage un futur cosmique où l’humanité converge vers le Point Oméga, unifiant matière et esprit en une noosphère évoluée. Ce paradis hypothétique sert de base pour relire le passé comme une évolution dirigée vers cette unification divine.
Elle efface la distinction entre nécessaire (le processus évolutif) et contingent (les aléas biologiques), en les intégrant dans une téléologie spirituelle. Face à l’absence de ce règne oméga, des révisions théologiques ou transhumanistes transforment l’échec en étapes vers de nouvelles convergences.
👉 Ce cycle messianique, mêlant science et une sorte de foi un peu mystique, est alimenté par une distorsion temporelle inépuisable.
Holisme.
L’holisme postule un futur où tout est interconnecté en un tout harmonieux, surpassant les visions réductionnistes pour une unité systémique globale. Ce futur hypothétique réinterprète le passé comme des fragments inachevés d’une totalité émergente.
Il confond le nécessaire (les relations systémiques) avec le contingent (les éléments isolés), en les fondant dans une vision unitaire. Lorsque cette harmonie ne se réalise pas, des révisions comme l’holisme écologique ou quantique ajustent la doctrine pour de nouvelles promesses d’intégration.
👉 Cette boucle messianique perpétue une illusion d’unité, nourrie par l’aveuglement aux divisions réelles du monde.
Écologisme.
L’écologisme imagine un avenir où l’humanité vit en symbiose avec la nature, rétablissant l’équilibre planétaire sous le règne de Gaïa, la Terre vivante ou Terre Mère. Ce paradis hypothétique réanalyse le passé comme une ère d’exploitation destructrice menant à une crise inévitable.
Il abolit la frontière entre nécessaire (les cycles naturels) et contingent (les innovations humaines), en les subordonnant à une urgence environnementale. Quand le règne de Gaïa tarde, des révisions comme l’écologie profonde ou le greenwashing transforment les échecs en appels à de nouvelles actions salvatrices.
👉 Ce messianisme vert alimente un cycle infini, exploitant la peur et l’espoir pour ignorer les complexités temporelles.
Multiculturalisme.
Le multiculturalisme prophétise un futur harmonieux où les cultures coexistent en une mosaïque égalitaire, transcendant les conflits identitaires. Ce futur hypothétique réinterprète le passé comme une histoire d’oppressions coloniales menant à une diversité libérée.
Il brouille le nécessaire (l’intégration culturelle) et le contingent (les tensions locales), en les forçant dans un idéal pluraliste. Face à l’absence de cette harmonie, des révisions comme le post-multiculturalisme ajustent pour promettre une inclusion plus radicale.
👉 Cette boucle messianique repose sur une distorsion du temps, perpétuant l’aveuglement aux fractures réelles des sociétés.
Théologie de la libération.
La théologie de la libération envisage un futur où les opprimés, inspirés par une version marxiste de l’Évangile, construisent un royaume de justice sociale sur Terre, libéré des structures capitalistes. Ce paradis hypothétique réinterprète le passé biblique comme une lutte des pauvres contre les puissants.
Elle efface la distinction entre nécessaire (l’option pour les pauvres) et contingent (les contextes politiques), en les alignant sur une eschatologie terrestre. Lorsque ce royaume ne s’établit pas, des révisions syncrétiques avec l’écologie ou le féminisme recyclent l’échec en nouvelles prophéties.
👉 Ce messianisme théologique nourrit un cycle inépuisable, ancré dans une inversion temporelle de la foi.
Progressisme globaliste de l’ONU.
Le progressisme globaliste de l’ONU prédit un avenir unifié sous des objectifs durables, où les nations coopèrent pour éradiquer pauvreté, inégalités et crises climatiques via des agendas mondiaux. Ce futur hypothétique réanalyse le passé comme une ère de divisions nationales menant à une gouvernance globale inévitable.
Il confond le nécessaire (les accords internationaux) avec le contingent (les souverainetés locales), en les subordonnant à une vision universaliste. Quand ces objectifs échouent, des révisions comme les nouveaux ODD transforment les déceptions en appels à une coopération accrue.
👉 Cette boucle messianique onusienne exploite l’aveuglement collectif, perpétuant une distorsion temporelle au nom du progrès.
Foucault sans Foucault : du panoptique à la paranoïa collective.

«La Haute Culture est l’autoconscience d’une société.
Elle embrasse les œuvres d’art, la littérature, l’érudition et la philosophie qui tracent le cadre de référence commun aux esprits éclairés.»
Telle est la définition ciselée par Roger Scruton.
À peine l’eût-on énoncée qu’elle révèle, en France, un vide abyssal : cette essence s’est évanouie de nos rivages intellectuels bien avant l’aube du XXIe siècle.
Le seul socle partagé qui subsiste, précaire et érodé, n’est plus que celui des médias de masse – ces temples du prêt-à-penser, bruissants de formules éculées, de solécismes assumés et de rengaines cognitives ressassées par une cohorte de commentateurs à peine lettrés.
Au-delà, ne pullulent que des archipels subculturels, ignorants les uns des autres, unis non par un substrat de convictions ou de valeurs, mais par les contingences d’intérêts corporatistes, financiers ou politicards du moment.
Une culture des capitaines d’industrie et des thuriféraires de l’économie libérale ; une autre des catholiques intégristes, ressuscitant des rituels oubliés ; une troisième des activistes arc-en-ciel, brandissant les bannières de l’identité fluide ; une quatrième des robes noires du palais, ourdissant des plaidoiries byzantines.
Mais par-dessus tout, plane la culture des militants de la gauche postmoderne – ces insoumis éternels, écolos radicaux et intersectionnels zélés –, qui déploient, avec une ardeur machiavélique, l’arsenal du chantage moral, de l’intimidation numérique et des subventions occultes pour imposer leur hégémonie.
Ainsi transforment-ils leur bulle idéologique en un ersatz monstrueux de haute culture, le rempart le plus sournois contre toute culture authentiquement élevée.
Scruton lui-même en sonde les fragilités : «La Haute Culture est une conquête fragile, qui ne survit que portée par le souffle d’une tradition vivante et l’assentiment des normes sociales environnantes.
Quand ces soutiens s’évaporent, elle cède la place à une culture de faux-semblants. La contrefaçon repose sur une connivence perverse entre l’imposteur et sa proie : ils ourdissent ensemble le mensonge d’une croyance feinte, le simulacre d’un sentiment qu’ils ne sauraient éprouver.»
Ce constat, qui évoque irrésistiblement les pages glaçantes de la “Ponerologie” du Dr Andrew Łobaczewski – ce traité impitoyable sur l’hystérie collective qui gangrène une société dès lors que les psychopathes s’emparent des leviers du pouvoir –, trouve en France une illustration d’une acuité chirurgicale, emblématique de notre époque.
Nul n’ignore que Michel Foucault reste l’un des phares – ou plutôt des ombres– les plus rayonnants dans les amphithéâtres des universités.
Ce pionnier d’un marxisme muté en hydre post-structuraliste imprègne les campus comme une doxa officielle, que l’élite académique française n’a pas seulement ingurgitée, mais remodelée en une variante si singulièrement gauloise qu’elle en devient presque folklorique.
Pourtant, comme le souligne un critique récent (https://www.researchgate.net/publication/364144219_How_Foucault_Got_Rid_of_Bossy_Marxism), Foucault, bien qu’évoluant dans le creuset de la théorie de gauche des années 1960 et 1970, où le marxisme régnait en maître, s’en est distancié, diluant l’analyse des classes en un jeu subtil de pouvoirs.
Karl Marx, on le sait, forgea l’idéologie selon laquelle les idées qui circulent ne seraient que les reflets déformés des intérêts objectifs des classes sociales. Certes, certaines le sont ; mais Marx postule que toutes le sont, que nul recoin de l’esprit n’échappe à cette partition binaire du champ mental entre «idéologie prolétarienne» et «idéologie bourgeoise».
Pourtant, une faille béante mine cette édifice dès sa genèse : ou bien les idées et croyances d’un individu sont rivées à sa condition de classe, ou bien, appartenant à une caste, il peut, par un saut du raisonnement, embrasser l’idéologie adverse – comme le fit, précisément, le bourgeois prussien Karl Marx lui-même. Pour que cette transmutation ne soit pas un caprice irrationnel, une extase irraisonnée, il requiert un espace neutre, un no man’s land intellectuel d’où l’âme en péril scrute les idéologies belligérantes et élit son camp par pure souveraineté.
Mais si tel saut est possible – et Marx en fut la preuve vivante –, alors l’idéologie personnelle s’affranchit de la dictature de classe, et l’expression «idéologie de classe» n’est plus qu’une métaphore creuse, un ornement rhétorique.
il est donc logique d’user de cette théorie avec une once de scepticisme, ou l’archiver au panthéon des utopies hasardeuses.
Michel Foucault, loin de ce recul, opta pour l’exacerbation.
Poussée à l’extrême, sa radicalisation aboutit à ce verdict impitoyable : face à une idée ou une assertion, sa vérité ou son mensonge importe peu ; sa fidélité aux faits est vaine.
Seul prime le «schéma de pouvoir» qu’elle sert, et ces schémas se réduisent à deux : celui des «oppresseurs» et celui des «opprimés» – échos à peine voilés des «bourgeois» et «prolétaires» marxistes.
La simple aspiration à arbitrer les idées par leur conformité à la réalité n’est déjà qu’un «schéma» au service des tyrans.
La vérité ? Une illusion obsolète.
Le “philosophe”, libéré de ces chaînes, doit n’élire que ce qui gonfle les voiles du pouvoir opprimé.
Dans un récent débat sur l’influence foucaldienne, un analyste souligne que «Foucault est souvent présenté comme le penseur des micropouvoirs et le théoricien des dispositifs, ces perspectives permettant de discréditer l’étude des macropouvoirs traditionnels».
(https://journals.openedition.org/rsa/1755)
Évidemment, cette négation de la vérité se pare elle-même du manteau de la vérité absolute, sombrant dans un cercle vicieux qui, au bout du compte, ne profère que le vide.
Pourtant, un aveu s’impose : Foucault, qui proclamait la vérité abolie, la traquait avec une ferveur quasi mystique dans sa propre doctrine.
Ses vastes fresques sur le panoptique carcéral, les manicomes du XIXe siècle ou l’archéologie de la sexualité déploient un labeur titanesque pour ancrer, via faits et archives – hélas trop souvent romancés –, le lien entre idées et intérêts qu’il imputait aux foules.
C’est ici que surgit le phénomène de notre époque, et tellement français, que j’évoquais.
Dans les séminaires sorbonnards, les tribunes politiques ou les colonnes des journaux en ligne, l’intellectuel gauchiste typique – disons un fervent lieutenant de La France insoumise comme François Ruffin, qui, bien qu’ayant rompu avec le parti en 2024, incarne encore cette doxa, ou une idéologue comme Sophia Chikirou, affirmant récemment que «la liberté d’expression en Chine est aussi menacée que celle qu’on a en France» pour minimiser les oppressions ailleurs tout en exagérant celles ici – applique la leçon foucaldienne avec une créativité qui eût sidéré son maître : accuser un auteur ou un polémiste de cautionner tel «schéma de pouvoir», c’est-à-dire de relayer les intérêts d’un groupe social occulte, dispense d’enquêter sur deux points triviaux :
– (a) l’existence réelle de ce groupe ;
– (b) l’appartenance effective de l’accusé à ses rangs, ou même sa connivence avec ses desseins.
(https://www.marianne.net/politique/melenchon/promis-la-chine-n-est-pas-une-dictature-c-est-sophia-chikirou-qui-le-dit)
La réduction des idées à de simples masques d’un «schéma de pouvoir» s’érige en preuve souveraine de leur poison, sans exiger la moindre assisse sociologique tangible.
Si vos mots heurtent l’oreille complaisante de ces gardiens de la doxa, ils vous rattachent d’un trait de plume à une tribu fantôme, ou à une cabale sans lien avec le débat, et l’affaire est réglée.
La validité de votre propos s’évapore non par son ancrage dans votre propre milieu social, mais par son exil forcé vers une faction qui vous est étrangère, ou qui n’a jamais vu le jour.
Ruffin lui-même, dans sa critique de la stratégie de LFI, dénonce une «conception stalinienne de la classe», accusant le parti de racialiser le conflit de classe sans voir que ce conflit est déjà mythifié.
(https://www.politis.fr/articles/2024/10/intersections-francois-ruffin-la-classe-sociale-mythifiee/)
C’est précisément ainsi qu’opéra, en écho à une myriade de plumes progressistes n’ayant pas lésiné sur leurs diagnostics des tumultes récents, le texte d’orientation stratégique de La France insoumise pour son congrès de 2024.
Confronté aux flots humains des manifestations anti-Bayrou et anti-blocages économiques – ces marées de Français de tous horizons, âges et origines, sans chef charismatique ni appui des chaînes publiques, des syndicats ou des lobbies patronaux –, il diagnostiqua une machination ourdie par la «classe dominante», affirmant que « dans les médias dominants, la déontologie est aux abonnés absents et les accusations sans fondement et les mensonges sont légion. Cette stratégie de diabolisation de la France insoumise vise à limiter sa progression électorale et cherche à l’isoler pour maintenir la domination des partisans du système capitaliste, impérialiste et écocidaire« .
(https://lafranceinsoumise.fr/wp-content/uploads/2024/12/ORIENTATION-STRATEGIQUE-VDEF.pdf)
Pilotée, par tous les saints du ciel !, par le tandem BFM-TV et l’immonde Le Monde, qui s’acharnaient pourtant à rapetisser ces soulèvements et à les moquer sous cape.
Dépouillée de ses atours sociologiques, fussent-ils les plus ténus, la théorie foucaldienne s’est muée en une arme paresseuse : accuser quiconque de n’importe quel chef d’accusation, puis regagner son alcôve l’âme en paix, certain d’avoir éventé un «schéma de pouvoir» monstrueux.
De la simulation hystérique, la gauche tricolore a glissé vers la mythomanie délirante.
Qu’est-ce que la distorsion dans la manière dont la pensée s’articule avec le réel ? Et comment cette distorsion aussi appelée dissonance cognitive constitue une rupture philosophique dans l’histoire de la pensée ?

La dissonance cognitive, ce malaise intellectuel né du décalage entre la construction théorique et l’expérience vécue, constitue un fil conducteur pour comprendre l’évolution de la pensée occidentale.
Ce phénomène n’est pas du tout anodin car il révèle une fracture progressive entre l’homme et le cosmos, entre le penseur et la réalité dont il est partie intégrante.
Nous explorerons ci-dessous les origines et les implications de cette dissonance, en retraçant son émergence dans l’histoire de la philosophie et ses conséquences sur la manière dont l’humanité conçoit le réel.
À travers une analyse des grandes étapes de cette rupture – de l’Antiquité à la Modernité – nous chercherons à comprendre comment le philosophe, d’observateur humble du cosmos, s’est mué en un prétendu «fiscal de la science universelle», et ce que cela implique pour notre rapport à la vérité.
I. La dissonance cognitive : une définition.
La dissonance cognitive, dans le contexte philosophique que nous abordons ici, peut être définie comme l’écart entre le cadre théorique élaboré par un individu et la réalité vécue dans laquelle il est immergé.
Cet écart ne résulte pas d’une simple erreur ou d’une malhonnêteté intellectuelle, mais d’une distorsion structurelle dans la manière dont la pensée s’articule avec le réel. Autrement dit, la dissonance cognitive survient lorsque le penseur croit pouvoir se placer en dehors de la réalité pour l’observer de manière objective, comme un spectateur détaché, alors qu’il demeure inéluctablement inséré dans le cosmos qu’il prétend juger.
Dans l’Antiquité et au Moyen Âge, les philosophes, d’Aristote à Saint Thomas d’Aquin, entretenaient une relation d’humilité vis-à-vis du réel.
Ils se savaient partie prenante d’un ordre cosmique plus vaste, un tout dont ils ne pouvaient s’extraire.
Leur réflexion s’inscrivait dans une tradition de savoirs cumulatifs, où chaque penseur contribue modestement à une chaîne de connaissances, conscient de ses limites. Aristote, par exemple, affirmait que tout savoir dérive d’un savoir antérieur, formant une continuité où l’individu n’est qu’un maillon.
Cette posture, empreinte de docilité face à la complexité du réel, contrastait avec l’attitude qui allait émerger à l’aube de la modernité.
II. Les premiers signes de la rupture : Guillaume d’Ockham et l’empirisme.
L’un des premiers indices de cette rupture apparaît avec Guillaume d’Ockham, au XIVe siècle.
Ockham postule que la réalité accessible à notre expérience – ce que nous pouvons observer et vérifier – constitue la mesure de ce qui est vrai.
Cette idée, séduisante par sa simplicité, repose pourtant sur une illusion : l’empirisme, bien qu’il prétende s’en tenir aux faits, ne peut appréhender qu’une fraction infime de la réalité.
Le réel, dans sa profondeur et sa complexité, excède largement les limites de l’observation humaine.
En proclamant l’universalité de l’empirisme, Ockham introduit un scotome qui désigne une tache aveugle dans le champ visuel ou, métaphoriquement, une lacune dans la perception ou la compréhension.
C’est une tâche dans le champ visuel qui l’empêche de reconnaître les biais inhérents à sa méthode.
En ignorant la richesse du cosmos, dont l’homme n’est qu’une partie, il ouvre la voie à une approche réductrice, où la vérité se limite à ce qui peut être mesuré ou testé.
Cette attitude, bien que non dépourvue de rigueur, marque le début d’une distorsion : le penseur commence à se percevoir comme un observateur extérieur, capable de juger la réalité dans son ensemble, oubliant qu’il est lui-même immergé dans cette réalité.
III. Descartes et l’illusion du doute universel.
La dissonance cognitive s’intensifie avec l’avènement de la modernité, et particulièrement avec René Descartes au XVIIe siècle.
Dans ses “Méditations sur la philosophie première”, Descartes propose une méthode radicale : douter de tout, suspendre toute certitude pour reconstruire le savoir sur des bases prétendument inébranlables.
Ce «doute méthodique» vise à placer le philosophe en dehors du réel, comme s’il pouvait observer l’univers depuis une position divine, détachée de toute contingence.
En réalité, cette entreprise est vouée à l’échec.
Descartes, tout en proclamant douter de tout, se repose sur des certitudes implicites qu’il ne remet jamais en question.
Sa méthode, loin d’être neutre, est imprégnée de présupposés culturels, historiques et personnels.
Ce décalage entre ce que Descartes prétend faire – une remise en question universelle – et ce qu’il fait réellement – une reconstruction du savoir à partir de prémisses non examinées – illustre parfaitement la dissonance cognitive.
Le philosophe croit s’extraire du réel, mais il reste prisonnier de ses propres cadres mentaux, incapable de les reconnaître comme tels.
Cette posture, qui devient caractéristique de la modernité, accentue la fracture entre le penseur et le cosmos.
Là où les anciens philosophes acceptaient la primauté du réel sur leurs théories, les modernes s’arrogent le droit de soumettre la réalité à leurs propres critères de vérité. Cette attitude, bien que motivée par une quête sincère de certitude, engendre une forme d’arrogance intellectuelle qui prétend réduire l’infinitude du réel à des modèles théoriques simplifiés.
IV. Les conséquences de la dissonance : une guerre contre le réel.
La dissonance cognitive, en s’enracinant dans la pensée occidentale, engendre une véritable guerre contre la complexité du réel.
Les théories modernes, qu’il s’agisse des grands systèmes philosophiques ou des modèles scientifiques réductionnistes, tendent à isoler une partie de la réalité pour en faire un tout explicatif.
Cette approche, bien que productive dans certains domaines, mène à des dérives intellectuelles lorsque le penseur croit que son modèle englobant représente la vérité ultime.
Un exemple frappant est celui des théories qui prétendent saisir le «sens global» de l’histoire humaine.
Que ce soit à travers des visions hégéliennes, marxistes ou évolutionnistes, ces théories affirment que l’histoire suit une trajectoire linéaire, orientée vers un but ultime.
Pourtant, comme le souligne l’expérience empirique elle-même, nous sommes immergés dans le flux du temps, sans accès à son commencement ni à sa fin.
Prétendre déterminer le «sens final» de l’histoire revient à créer un monde à l’image de nos propres présupposés, un délire intellectuel qui ignore la complexité du réel.
Cette attitude reflète une perte de l’humilité qui caractérisait les penseurs anciens. Aristote, par exemple, reconnaissait que le réel avait une autorité sur la pensée : le philosophe doit se soumettre à la réalité, et non l’inverse.
Saint Thomas d’Aquin, de même, abordait le cosmos avec une docilité intellectuelle, conscient que la vérité dépasse les capacités de l’esprit humain.
À l’inverse, la modernité, en s’appuyant sur l’empirisme ou la rationalité autoproclamée, a souvent succombé à la tentation de réduire le réel à des schémas simplificateurs, au détriment de sa richesse infinie.
V. Une arrogance intellectuelle et ses limites.
Cette dissonance cognitive, loin d’être un simple accident historique, révèle une forme d’arrogance intellectuelle qui se manifeste dans l’idée que certaines vérités sont indignes d’être considérées parce qu’elles ne répondent pas aux critères modernes de scientificité ou de rationalité.
Cette attitude, incarnée par exemple dans le positivisme du XIXe siècle, rejette toute forme de savoir qui ne peut être validée par l’expérience empirique ou la logique formelle.
Pourtant, comme le soulignait déjà Aristote, le savoir humain repose sur une tradition, un héritage de connaissances qui ne peut être entièrement soumis à l’épreuve empirique.
L’empirisme, bien qu’il se présente comme une méthode rigoureuse, est en réalité limité par les contraintes de l’expérience humaine.
Nous ne pouvons observer qu’une infime partie du réel, et le reste repose sur des traditions, des consensus ou, pire encore, des modes intellectuelles passagères.
En ignorant cette réalité, le penseur moderne s’enferme dans une illusion de maîtrise, croyant pouvoir juger l’univers depuis une position extérieure.
Comme le disait Saint Paul, «c’est en Lui que nous vivons, nous nous mouvons et nous sommes» : nous sommes immergés dans le cosmos, et toute tentative de s’en extraire pour le juger est vouée à l’échec.
VI. Vers une réconciliation avec le réel.
Face à cette dissonance cognitive, la question se pose : comment renouer avec une pensée qui respecte la complexité du réel ?
La réponse réside peut-être dans un retour à l’humilité des anciens.
Cela ne signifie pas un rejet des acquis de la modernité, mais une reconnaissance des limites de nos outils intellectuels.
La philosophie, pour redevenir féconde, doit accepter que le réel est plus vaste que nos théories, et que la vérité ne se réduit pas à ce que nous pouvons mesurer ou démontrer.
Une telle démarche implique de réhabiliter la notion de tradition comme une chaîne vivante de savoirs qui relie le passé au présent.
Cela exige également une vigilance constante face aux biais qui nous poussent à simplifier le réel, que ce soit par l’empirisme, le rationalisme ou toute autre idéologie. Enfin, cette démarche invite à une forme de docilité intellectuelle, une disposition à apprendre du cosmos plutôt qu’à le soumettre à nos cadres préétablis.
Conclusion.
La dissonance cognitive, telle qu’elle s’est manifestée dans l’histoire de la pensée occidentale, est le symptôme d’une rupture profonde entre l’homme et le réel.
De Guillaume d’Ockham à Descartes, en passant par les grandes théories modernes, le philosophe a progressivement perdu de vue sa condition de créature immergée dans le cosmos.
Cette illusion d’extériorité, bien qu’elle ait permis des avancées indéniables, a également engendré une forme d’arrogance intellectuelle, où le penseur prétend réduire l’infinitude du réel à ses propres catégories.
Pour surmonter cette dissonance, il nous faut retrouver l’humilité des anciens, non pas pour rejeter la modernité, mais pour enrichir notre rapport à la vérité.
En reconnaissant que nous sommes partie prenante d’un cosmos qui nous dépasse, nous pouvons espérer renouer avec une pensée plus fidèle à la réalité, une pensée qui accepte ses limites tout en s’ouvrant à l’infinie complexité du réel.
Livre «Chroniques des ombres de la modernité.»

Le livre est disponible ici : https://amzn.eu/d/iGfHb9U

«Chroniques des ombres de la modernité» est une plongée poétique dans les paradoxes de notre époque, un manifeste vibrant pour réenchanter notre existence face aux défis d’un monde en crise.
À travers une mosaïque de réflexions philosophiques, historiques et sociologiques, ce recueil dresse un portrait percutant des aliénations contemporaines dont l’accélération du temps, la dissolution de l’identité dans le virtuel, l’effacement des récits collectifs et la servitude masquée de l’esclavage moderne.
Portée par une plume incisive et des références riches – d’Hannah Arendt à Byung-Chul Han, de Platon à Nietzsche –, cette œuvre mêle critique lucide et méditation profonde pour résister à la subversion idéologique et raviver la voix du cœur.
Loin d’un simple constat, l’auteur propose des voies de résistance : ralentir, rêver, reconquérir le sacré et le corps, raviver la mémoire collective.
De la démocratie transformée en «supermarché de l’illusion», à la dictature du relativisme, chaque chronique invite à questionner, douter et agir pour retrouver une humanité vivante et libre.
Destiné aux épuisés, aux désenchantés, aux rêveurs en quête de sens, ainsi qu’aux amateurs de philosophie, de spiritualité et de réflexion sur notre temps, ce livre est une ode à l’immortalité de l’âme sous un ciel d’acier.
Ouvrez le livre et reprenez votre souffle : l’avenir commence par un retour à l’essentiel.
Le livre est disponible ici :
La tension entre le fini et l’infini ainsi que les distinctions de la science.

Introduction.
La science, dans sa quête de compréhension du monde, repose sur des distinctions fondamentales qui structurent son approche et délimitent ses objets d’étude.
Mais au-delà de ces cadres logiques, l’intelligence humaine se trouve confrontée à une tension profonde : celle entre le fini, qui caractérise notre expérience quotidienne, et l’infini, qui évoque une vérité plus vaste, métaphysique, voire spirituelle.
Dans cet article, Antoine Bachelin Sena explore ces deux dimensions – les distinctions scientifiques et la quête d’un sens ultime – en les rendant accessibles à tous, avec des exemples concrets et des réflexions tirées de la philosophie, de la religion et de l’expérience humaine.
Les distinctions au cœur de la science.
Pour comprendre comment la science construit ses objets d’étude, il faut d’abord saisir les distinctions qu’elle opère.
Ces distinctions ne sont pas seulement des outils abstraits : elles façonnent la manière dont nous pensons le monde.
Trois types de distinctions sont particulièrement importantes : la distinction réelle, la distinction mentale et la distinction formelle.
- La distinction réelle sépare des entités totalement indépendantes.
Par exemple, un embryon étudié en biologie n’a rien à voir avec un triangle analysé en géométrie. Ces disciplines opèrent sur des réalités distinctes, sans lien direct.
- La distinction mentale, en revanche, concerne des aspects d’une même réalité qui ne peuvent exister séparément.
Prenons une pomme : sa couleur rouge est une propriété que nous pouvons isoler mentalement, mais elle n’existe pas indépendamment de la pomme elle-même. Cette distinction est essentielle pour analyser les attributs d’un objet sans les détacher de leur support.
- La distinction formelle, enfin, est purement conceptuelle.
Par exemple, appeler une personne par son nom, comme “Marie”, ou par son surnom, comme “Mimi”, ne change rien à sa réalité.
Cette distinction n’a de sens que dans notre esprit.
Ces distinctions permettent à la science de découper la réalité pour mieux l’étudier.
Mais elles ont leurs limites. En mathématiques, par exemple, tout repose sur des constructions mentales. Les nombres, les figures géométriques ou les équations n’existent pas dans la nature : ce sont des abstractions, parfois inspirées par l’observation, mais détachées de l’expérience concrète.
Prenez la notion de mesure : un mètre ou un kilogramme n’existe pas en soi.
Mesurer, c’est toujours comparer un objet à une référence arbitraire.
Imaginez une chaise flottant seule dans l’espace infini : parler de sa “taille” n’aurait aucun sens sans un autre objet pour la comparer.
Cette idée peut sembler abstraite, mais elle a des implications concrètes.
Par exemple, dans la vie quotidienne, nous utilisons des mesures pour organiser le monde – la distance entre deux villes, le poids d’un sac de pommes de terre – mais ces mesures ne disent rien de la réalité profonde des choses.
Ce sont des outils, pas des vérités absolues.
La science, en se concentrant sur ces abstractions, risque parfois d’oublier la richesse de l’expérience vécue.
Le Triangle de Peirce et la quête métaphysique.
Au-delà des distinctions logiques, la science et la pensée humaine s’inscrivent dans une réalité plus vaste, où les objets ne se réduisent pas à leur matérialité.
Le philosophe Charles Sanders Peirce propose un modèle éclairant pour comprendre cette complexité : le Triangle de Peirce, qui articule trois éléments dont le signe, le sens et le référent.
Prenons un exemple simple : le mot “eau”.
- Le signe, c’est le mot lui-même, “eau”, que nous prononçons ou écrivons.
- Le sens, c’est ce que nous associons à ce mot – une substance liquide, transparente, essentielle à la vie.
- Le référent, c’est ce à quoi nous faisons référence dans un contexte précis : l’eau potable que nous buvons, l’eau de pluie qui tombe du ciel, ou l’eau baptismale utilisée dans un rituel religieux.
Chaque fois, le mot “eau” prend une signification différente selon le contexte.
Cette articulation, selon le philosophe Jean Borella dans “La crise du symbolisme religieux”, dépasse la simple analyse linguistique : elle touche à une dimension métaphysique.
L’eau baptismale, par exemple, n’est pas seulement une substance chimique (H₂O).
Dans le contexte religieux, elle devient un symbole de purification, de renaissance, voire de la “matière première” universelle, une idée métaphysique qui évoque la possibilité infinie de toute création.
Ce lien entre le symbole et son référent n’est pas arbitraire, comme une métaphore littéraire. Il est ancré dans une réalité profonde, où les objets du monde sensible renvoient à des vérités spirituelles.
Cette perspective change tout.
L’eau, vue sous l’angle scientifique, est une substance – quelque chose qui existe par soi, sans être une partie ou un attribut d’autre chose.
Mais à l’échelle métaphysique, elle devient un symbole, un reflet de la “possibilité universelle”, cette réalité ultime dont tout découle.
Nous-mêmes, en tant qu’êtres humains, pouvons être vus comme des “attributs” de cette possibilité infinie, sans existence autonome.
La tension entre le fini et l’infini.
Cette double lecture – l’eau comme substance et comme symbole – illustre une tension fondamentale de l’intelligence humaine : celle entre le fini et l’infini.
- D’un côté, nous vivons dans un monde concret, limité, mesurable.
- De l’autre, nous aspirons à une vérité plus grande, à une beauté ou à une bonté qui transcende notre expérience.
Cette tension se manifeste dans des expériences quotidiennes.
Imaginez que vous contemplez un coucher de soleil sur la mer.
La beauté de ce moment vous transporte, mais elle vous laisse aussi un sentiment d’incomplétude, comme si ce spectacle n’était qu’un aperçu d’une beauté plus grande, éternelle.
Ce désir de beauté peut prendre différentes formes : pour certains, il s’exprime dans l’amour ou l’art ; pour d’autres, il évoque une quête spirituelle, une aspiration à la “béatitude” ou à la vérité ultime.
Le philosophe médiéval Duns Scot affirmait que la beauté, la vérité et l’être sont trois aspects d’une même réalité.
Quand nous percevons quelque chose de beau, nous entrevoyons une vérité plus profonde, qui ne peut exister sans un infini sous-jacent.
Sans cet infini, les réalités finies – un coucher de soleil, une œuvre d’art, une équation mathématique – n’auraient pas de sens.
L’infini, en ce sens, n’est pas une abstraction lointaine : il est la condition de tout ce qui existe.
Cette idée peut sembler éloignée de la vie quotidienne, mais elle résonne dans des expériences humaines universelles.
Prenez l’exemple de Nicolae Steinhardt, un écrivain roumain emprisonné sous le régime communiste. Dans son livre “Le Journal du bonheur”, il raconte comment, affamé et torturé, il a vécu un moment de contemplation où il a perçu la “beauté éternelle”.
Malgré les horreurs de sa condition, il a entrevu une vérité transcendante, qui donnait un sens à son existence.
Cette expérience illustre la capacité de l’intelligence humaine à s’ouvrir à l’infini, même dans les circonstances les plus finies et douloureuses.
La science et ses limites.
La science, dans sa rigueur, tend à privilégier le fini : elle mesure, classe, analyse.
Mais en se limitant à ces abstractions, elle risque de perdre de vue la richesse de l’expérience humaine.
Comme le souligne Hugues de Saint Victor, la connaissance véritable passe par trois étapes : penser, méditer et contempler.
- Penser, c’est analyser un objet ou une idée.
- Méditer, c’est remonter à l’expérience qui a donné naissance à cette pensée.
- Contempler, c’est articuler plusieurs méditations pour percevoir une vérité plus vaste.
Par exemple, un scientifique peut analyser la composition chimique de l’eau (penser), réfléchir à son rôle dans les écosystèmes (méditer), et finalement contempler sa place dans un ordre cosmique ou spirituel (contempler).
Cette contemplation ne rejette pas la science, mais la replace dans un cadre plus large, où l’expérience humaine – avec ses paradoxes et ses aspirations – retrouve sa place.
Malheureusement, la science moderne, souvent prisonnière d’un “consensus des sages”, tend à valoriser la spécialisation au détriment de la sagesse.
En se concentrant sur des questions de prestige ou de performance technique, elle oublie parfois l’ontologie – c’est-à-dire la question de l’être – qui sous-tend toute connaissance. Toute science repose sur des présupposés sur ce qui existe, mais elle ne les interroge pas toujours.
Par exemple, en définissant une substance comme “ce qui existe par soi” (selon Aristote), la logique risque de nous faire croire que les choses matérielles sont autonomes, alors qu’elles sont en réalité interdépendantes, reliées à une réalité plus vaste.
Vivre dans la tension.
L’intelligence humaine, dans sa grandeur, vit dans une tension qu’elle ne peut résoudre.
- D’un côté, nous sommes ancrés dans un monde fini, imparfait, mesurable.
- De l’autre, nous aspirons à l’infini – à la beauté, à la vérité, à l’être.
Cette tension peut être source de frustration : certains, pour l’apaiser, rejettent l’infini et se réfugient dans le mesurable, le concret.
Mais ce choix appauvrit notre expérience.
La vraie richesse de l’intelligence, c’est de tenir ensemble ces deux dimensions.
Quand nous étudions un objet – une molécule, une étoile, une œuvre d’art –, nous devons être conscients de son inscription dans le fini (ses propriétés mesurables) et dans l’infini (sa place dans un ordre plus vaste).
Cette approche dialectique, paradoxale, nous garde en contact avec la réalité profonde.
Dans la vie quotidienne, cela signifie prêter attention aux moments où le fini nous renvoie à l’infini.
Un sourire d’enfant, une mélodie qui nous émeut, un problème mathématique résolu avec élégance : tous ces instants sont des fenêtres sur une vérité plus grande.
Ils nous rappellent que nous ne sommes pas seulement des êtres de mesure, mais aussi des êtres de contemplation du divin.
Conclusion.
La science, avec ses distinctions rigoureuses, nous aide à comprendre le monde.
Mais elle ne peut à elle seule répondre à la quête de sens qui anime l’humanité.
En articulant le fini et l’infini, l’intelligence humaine trouve sa véritable mesure.
Comme le psalmiste qui refusait d’oublier Sion, nous sommes appelés à ne pas nous perdre dans le concret, mais à nous souvenir de notre “patrie céleste” – cette vérité éternelle qui donne sens à tout.
Que ce soit dans l’analyse d’une goutte d’eau ou dans la contemplation d’un coucher de soleil, la connaissance véritable naît de cette tension entre le mesurable et l’incommensurable.
En cultivant cette double vision, nous ne faisons pas seulement progresser la science : nous retrouvons la sagesse qui nous rend pleinement humains.
Les penseurs traditionnels ne sont pas contre la modernité.

La tradition et la modernité sont souvent présentées comme des notions antagonistes.
Pourtant, leur opposition ne doit pas être réduite à une simple rivalité.
Ce sont des concepts vastes, englobant des réalités qui s’étendent sur des siècles et touchent des phénomènes d’ampleur presque planétaire.
La tradition puise ses racines dans un passé immémorial, tandis que la modernité marque une rupture plus récente mais tout aussi significative.
Explorer leurs détails exhaustifs serait une tâche écrasante ; je propose donc de me concentrer sur leur essence : l’élan fondamental qui anime la tradition et l’idée centrale qui porte la modernité.
Derrière la diversité de leurs manifestations, chacune semble animée par une aspiration unique, un esprit qui les définit et les éclaire.
Qu’est-ce que la modernité ? Une rupture philosophique.
La modernité au sens commun : le progrès technique.
Dans le langage courant, être « moderne » évoque spontanément une notion positive liée au progrès, surtout technique.
Une voiture moderne consomme moins, va plus vite ; un réfrigérateur moderne conserve mieux les aliments.
Cette perception associe la modernité à une amélioration pratique, à une efficacité accrue.
En ce sens, on pourrait dire que chaque époque a eu ses « modernes » : des individus cherchant à surpasser leurs prédécesseurs en ingéniosité ou en confort.
Mais cette définition reste superficielle et ne saisit pas l’essence du concept.
Une nouvelle ère pour l’humanité.
La modernité, dans son acception philosophique, va bien au-delà.
Elle émerge à la fin du XVIe siècle, s’affirme pleinement au XVIIIe avec les Lumières, et marque une rupture radicale avec le passé.
À cette époque, des penseurs commencent à concevoir leur temps non pas comme une simple suite d’avancées techniques, mais comme l’entrée dans une ère nouvelle.
Être moderne, ce n’est plus seulement être meilleur que ses ancêtres ; c’est être fondamentalement différent. En France, la « Querelle des Anciens et des Modernes » (fin XVIIe – début XVIIIe siècle) cristallise ce basculement : les « modernes » revendiquent une supériorité non seulement technique, mais aussi intellectuelle et morale sur les Anciens.
La raison comme pilier.
Au cœur de cette modernité se trouve une idée maîtresse : la raison.
Le XVIIIe siècle la célèbre comme « l’âge de raison » de l’humanité, un moment où les hommes deviennent pleinement maîtres de cette faculté.
Mais cette raison moderne se distingue de celle des Anciens.
Elle n’est plus seulement un outil de contemplation ou une norme universelle liant le vrai, le bien et le beau, comme dans la pensée classique ou chrétienne.
Elle devient une rationalité pragmatique, tournée vers l’action et la maîtrise du réel.
Une vision nouvelle de l’humanité.
Avec la modernité apparaît une conception inédite de l’histoire : l’humanité est vue comme un tout en évolution, comparable à un individu passant de l’enfance à la maturité.
La modernité représente cet « âge adulte », où l’homme s’émancipe des superstitions et des limites du passé pour réaliser pleinement son potentiel.
La philosophie de l’histoire, née au XVIIIe siècle, illustre cette ambition : comprendre le devenir collectif de l’humanité comme une marche vers le progrès.
Une raison déliée de la norme.
Contrairement à la raison classique, qui unissait science, morale et foi, la raison moderne sépare ces domaines.
Découvrir une vérité scientifique – une loi physique, par exemple – ne dit plus rien sur ce que l’homme doit faire.
La nature devient neutre, un champ de régularités à analyser et à exploiter, sans valeur morale intrinsèque.
Ainsi, la raison passe de la « raisonnabilité » (une quête du bien et de l’harmonie) à la « rationalité » (une capacité d’analyse et d’action).
Une puissance pragmatique.
Cette rationalité transforme la raison en outil de pouvoir.
Elle n’invite plus à contempler l’ordre des étoiles, comme le sage antique, mais à calculer, prévoir, agir.
La science moderne ne cherche pas le sens profond des choses, mais leur utilité pour l’homme.
Elle devient relative aux besoins humains, un levier pour façonner le monde selon nos désirs.
Les promesses de la modernité.
Un avenir radieux.
La modernité repose sur une foi inébranlable dans cette nouvelle raison. Elle promet de libérer l’humanité de ses maux ancestraux et de la transformer profondément.
Ces espoirs se déclinent en trois ambitions principales :
La fin de la misère :
Grâce à la science, l’homme dominerait la nature, surmonterait la pénurie et, dans les rêves les plus audacieux – comme chez Rabelais au XVIe siècle –, vaincrait même la mort.
Cette aspiration à transcender la condition humaine traduit une rupture métaphysique majeure.
Liberté, égalité, paix :
La raison rendrait les hommes plus libres (par leur pouvoir accru), plus égaux (par la diffusion du savoir) et plus pacifiques (par une rationalité supposée apaiser les conflits).
Ce mythe d’une société industrielle pacifiée, né il y a deux siècles, perdure malgré les contre-exemples historiques.
Une humanité moralement meilleure :
Les Lumières affirment que le progrès technique et économique améliore l’homme.
Le mal viendrait du malheur ; en le supprimant, la science rendrait les hommes bons.
Cette idée – « plus de savoir, plus de vertu » – est au cœur de la modernité initiale.
Une modernité en crise.
Ces promesses, intactes jusqu’au début du XXe siècle, ont été ébranlées par les guerres mondiales, le communisme et les excès de la rationalité technique (bombe atomique, déshumanisation).
Aujourd’hui, certains critiquent la modernité sans pour autant la rejeter : écologistes ou penseurs « new age » déplorent ses dérives – robotisation, aliénation consumériste – tout en restant dans son cadre.
Le soir disant salut par les droits de l’homme (quel homme?).
Face à ces désillusions, un courant récent tente de « sauver » la modernité en la dépassant. La science seule ne suffit pas ; il faut y ajouter une nouvelle valeur : les droits de l’homme.
Inspirée par Kant, cette philosophie postule que l’homme, imparfait mais perfectible, mérite un respect inconditionnel pour son potentiel.
La modernité devient alors l’ère de la tolérance, du dialogue et de l’autonomie, combinant rationalité scientifique et dignité humaine.
La tradition face à la modernité.
Une pensée vivante et critique.
Loin d’être un vestige dépassé, la tradition reste une philosophie vivante, riche de vingt-quatre siècles de réflexion, de Platon à nos jours.
Elle ne s’oppose pas à la modernité par réaction, mais propose une vision alternative, ancrée dans une intuition radicalement différente.
Examinons d’abord ses critiques, avant d’en dégager l’esprit profond.
1. Le progrès scientifique : une fausse évidence.
Les modernes raillent la tradition pour son « primitivisme » technique : Platon n’aurait pas construit d’avion, saint Thomas pas même une bicyclette.
Mais ce retard n’est pas une faiblesse. La tradition ne nie pas la science ; elle questionne sa finalité.
Dominer la nature est-il toujours souhaitable ?
Manipuler les gènes ou défier la mort risque-t-il de créer des monstres ?
Loin d’être rétrograde, elle invite à contempler un ordre caché dans les choses – une harmonie qu’il vaut mieux respecter que détruire.
2. La société économique : une guerre masquée.
Les modernes vantent le développement économique comme source de paix et de confort. La tradition y voit une illusion.
Plus on satisfait de besoins, plus on en crée, jusqu’à perdre le sens du nécessaire et du superflu.
L’économie moderne légitime cette spirale en déclarant tout désir naturel.
De plus, elle repose sur la concurrence – une guerre déguisée où l’objectif est d’écraser l’autre.
Les sociétés industrielles ne sont pas pacifiques ; elles canalisent le conflit sous des formes subtiles.
3. La démocratie : un idéal imparfait.
La démocratie, fierté des modernes, promet la souveraineté de tous. Mais, comme le note Rousseau, elle exige « un peuple de dieux » pour fonctionner.
Sinon, elle devient une lutte d’intérêts individuels, chacun revendiquant ses droits au détriment des autres.
La tradition ne rejette pas cet idéal – elle le pratique dans des communautés restreintes, comme les monastères – mais doute qu’il s’applique à des millions d’individus sans une vertu exceptionnelle.
L’esprit de la tradition : l’imperfection humaine.
Une intuition fondamentale.
Derrière ces critiques se dessine le cœur de la tradition : l’homme n’est pas parfait.
La modernité le voit comme un être autosuffisant, capable de devenir son propre dieu par la science et la raison.
La tradition, au contraire, insiste sur sa fragilité et sa liberté imparfaite.
Le christianisme l’exprime avec force : l’homme est une créature pécheresse, perfectible mais dépendante d’une aide extérieure – la grâce – pour s’élever.
Progrès moderne vs progrès traditionnel.
Les modernes rétorquent que leur idée de progrès rejoint cette imperfection : l’homme s’améliore par ses propres moyens.
Mais la tradition distingue les deux : dans la modernité, le progrès est une conquête humaine, un pouvoir illimité ; dans la tradition, il est limité par la condition humaine et nécessite une transcendance.
Là où la modernité proclame l’athéisme et fait de l’humanité son propre salut, la tradition rappelle que l’homme n’est pas Dieu, même collectivement.
Conclusion : une opposition irréductible ?
En 1804, Pie IX affirmait qu’aucun pont ne relie tradition et modernité.
La première voit dans la seconde une hubris dangereuse ; la seconde considère la première comme un frein au progrès.
Pourtant, les penseurs traditionnels ne rejettent pas la modernité par principe. Ils l’interrogent avec sagesse, proposant une voie où l’homme, conscient de ses limites, cherche l’harmonie plutôt que la domination.
La modernité, elle, mise sur une rationalité sans bornes pour réinventer l’humanité.
Ce sont deux visions irréconciliables, mais complémentaires dans leur tension.
Un mot coquille, un mot magique : DÉMOCRATIE, Un mot capable de déclencher des guerres.

Article publié sur France Soir : https://www.francesoir.fr/opinions-tribunes/un-mot-coquille-un-mot-magique-democratie-un-mot-capable-de-declencher-desCitant à tout bout de champ LA DÉMOCRATIE, nous, hommes modernes, sommes à l’opposé de la vision philosophique de la démocratie athénienne. Connaissons-nous en fait sa véritable histoire ?
Ce sujet devenu un véritable dogme, un mot coquille : la démocratie.
C’est une notion souvent extrêmement floue et que personne n’ose remettre en question, car il s’agit d’un mot magique capable de déclencher des guerres. Ce concept a bouleversé un système de pensée et a été présenté comme l’aboutissement de l’histoire humaine – rien de moins !
Pouvons-nous parler de vraie démocratie sans biais et sans un imaginaire collectif faussé et fantasmé tant dans sa forme antique que dans sa version moderne ?
Faisons ensemble durant cet article une réflexion tranquille et sincère : une enquête ou une tentative modeste de recoller les morceaux pour comprendre cette référence devenue incontournable en matière de gouvernance.
À tel point de revêtir une dimension quasi religieuse que critiquer la démocratie semble interdit ou blasphématoire ou un attentat verbal au soi-disant fragile et jeune État démocratique de droit : celui qui s’y risque s’expose à une sorte de « mort civique ». Personne ne se hasarde à suggérer que la démocratie pourrait comporter des erreurs ou qu’elle a besoin d’autres ingrédients.
La démocratie est vénérée comme une norme universelle avec même des États historiquement non démocratiques qui s’y sont convertis récemment.
Prenons l’exemple du Bhoutan, ce petit royaume himalayen de 600 000 habitants, dirigé par une dynastie héréditaire depuis des siècles, qui a en 2008, a adopté une constitution démocratique. Avec le roi qui a nommé son principal collaborateur comme Premier ministre.
En se dotant de cette constitution, le Bhoutan a fait allégeance à un système planétaire. Aujourd’hui, il reste probablement moins de quatre États au monde qui ne se réclament pas de faire partie du club démocratique.
La démocratie est partout, et pourtant, elle n’est nulle part
En vérité, les grands penseurs de la démocratie eux-mêmes– Machiavel, Montesquieu, Rousseau, Kant, Tocqueville – ne croyaient pas que le peuple soit capable de gouverner.
- Montesquieu, par exemple, estimait que le peuple pouvait au mieux choisir de bons gouvernants – une idée qu’il théorise à une époque où la démocratie moderne n’existait pas encore, s’inspirant de l’Antiquité.
- Tocqueville, qui a étudié la démocratie américaine, une des premières démocraties modernes, va plus loin : selon lui, le peuple n’est même pas capable de sélectionner correctement ses dirigeants.
La conception courante de la démocratie – le pouvoir exercé par le peuple – ne correspond pas à la réalité, car il existe en fait une forme de « mensonge démocratique ». Le peuple gouverne-t-il, s’il ne prend pas au final factuellement les décisions politiques ?
Dans nos sociétés modernes, vastes, complexes et techniques, les choix – qu’il s’agisse de fiscalité, d’investissements industriels ou de stratégies militaires (comme choisir entre sous-marins nucléaires ou missiles) – échappent totalement au peuple.
Prenons l’exemple de la Corée du Sud : au sortir de la guerre, ce pays sous-développé est devenu une puissance mondiale grâce à une décision politique forte, celle de miser sur la construction navale.
Une telle orientation, qui a mobilisé toute une nation, n’a pas été décidée par le peuple, mais par ses gouvernants, et ni vous ni moi ne serions capables de définir une stratégie aussi pointue. Alors, dire que « laa démocratie, c’est le peuple qui gouverne » est une illusion et un paradoxe.
Et de plus, ceux qui admettent intimement que le peuple ne gouverne pas – des démocrates convaincus, pour la plupart – restent attachés à l’idée de démocratie. Aujourd’hui, nos élites récitent leur « crédo démocratique » tout en étant intimement persuadées que le peuple est inapte à diriger et elles se considèrent comme les seules à savoir ce qu’il faut faire. Qu’est-ce que cette souveraineté signifie vraiment ?
La question du régime politique est, au départ, philosophique et relative au bien commun
Nous pouvons commencer un raisonnement en utilisant une règle de discernement définie ainsi : « ne fais pas d’une petite règle une vérité éternelle, et ne prends pas une grande vérité pour quelque chose d’intouchable. »
Le gouvernement est un moyen, pas une fin.
Jean Rousset, dans « Les Fondements de la cité », compare les abeilles, soumises aveuglément à leur organisation, aux hommes qui sont différents, car capables de modifier les lois et aussi les structures sociales.
L’homme, par son libre arbitre, doit réaliser sa vocation politique.
Comparons philosophiquement les principes des systèmes politiques : la démocratie athénienne versus la moderne car leurs bases anthropologiques et métaphysiques diffèrent profondément.
À Athènes, seuls les citoyens – environ 5 % de la population – formaient le « peuple », excluant esclaves et étrangers (les métèques, comme Aristote lui-même).
Grâce à différentes sources (Platon, Aristote, mais également des recensements comme celui de Démétrius de Phalère), nous savons qu’au IVe siècle avant J.-C., 20 000 citoyens sur 100 000 habitants se réunissaient sur la colline de la Pnyx pour décider.
Aujourd’hui, réunir 60 millions de Français est physiquement impossible : la différence d’échelle est évidente.
L’autre distinction est morale : la démocratie moderne se veut laïque (concept que nous allons questionner dans d’autres articles), fondée sur le droit et le contrat social (que nous allons questionner plus loin dans cet article).
À Athènes, la morale est liée à une éthique et à une vision sacrée : Périclès, par exemple, a utilisé le trésor de Delos pour rebâtir les temples de l’Acropole.
- Chez Aristote, l’homme, « animal politique », se réalisait dans le fait d’être actif, de participer et de débattre,
- Dans la société moderne, le citoyen est passif, isolé et otage d’une convention artificielle au-dessus de lui s’incarnant comme une toute puissance.
Ce qu’ont en commun la démocratie athénienne et la démocratie moderne, c’est que la démocratie reste le pouvoir d’une élite.
Platon la définissait comme « le gouvernement de l’élite sous la pression de la foule ».
À Athènes, les grandes familles (Alcmaéonides, Cimonides) dominaient et manipulaient le peuple, tout comme aujourd’hui, nos élites, souvent technocrates, échappent au contrôle populaire. Mais si le peuple ne peut trancher des questions techniques, les dirigeants et experts devraient rendre des comptes, ce qui n’est pas le cas.
Les origines épicuriennes de la souveraineté populaire
Épicure, redécouvert au début du XVe siècle grâce à des manuscrits comme ceux de Lucrèce, propose une vision où le cosmos n’est pas régi par une loi divine ou une finalité naturelle imposée de l’extérieur. Pour lui, tout découle d’un chaos originel : des atomes s’entrechoquent au hasard dans le vide et ce hasard engendre des formes de vie qui se combinent en monstres et évoluent. Cette théorie, préfigure Darwin par son caractère évolutif et le monde, selon Épicure, s’explique par lui-même, sans transcendance ni créateur.
Ce rejet d’une loi surnaturelle éclaire la notion de souveraineté populaire avec le peuple qui ne reçoit aucune règle d’une instance extérieure ou divine.
Les penseurs démocratiques, influencés par cette idée, refusent l’existence d’une loi universelle inscrite dans l’ordre du monde et Épicure est le pionnier de cette rupture.
Il affirme que la réalité n’a pas d’étiquette ou de catégorie prédéfinie, ni même de finalité imposée, puisque le monde est un flux, un assemblage d’atomes, et que l’homme est libre dans ce chaos.
Dans cette vision, le monde évolue constamment, et la stabilité ne vient pas d’un ordre éternel, mais d’une décision humaine temporaire. C’est une rupture radicale avec la philosophie classique – Platon, Aristote, ou plus tard les scolastiques comme Saint Thomas d’Aquin – qui postule un ordre naturel ou divin préexistant.
Pour ces derniers, Dieu a créé un monde structuré regroupant des espèces définies et une hiérarchie finalisée, et le rôle du roi ou du gouvernant est de respecter cet ordre.
Il s’agit d’être un « bon jardinier » de la nature humaine, veillant à ce que les lois humaines s’alignent sur l’harmonie cosmique et le droit, dans cette optique, a une profondeur métaphysique qui reflète une vérité objective et claire.
De l’individualisme au contrat social
Cette pensée alimente la démocratie moderne à travers une autre distinction fondamentale qu’est la conception de l’homme.
Chez Aristote, l’homme s’épanouit dans la cité – couple, famille, rue, village, nation étant des étapes de cette réalisation. Mais chez les modernes, l’homme est d’abord un individu isolé, ou si vous voulez une autre image, « un atome social ».
Hobbes, dans son Léviathan, décrit l’homme comme étant un « loup pour l’homme » et l’état de nature pour lui étant celui où règne la guerre de tous contre tous.
On a l’impression certaines fois que notre immense et froide société moderne est devenue une construction artificielle avec un contrat inconsciemment signé pour garantir la sécurité.
Rousseau nuance cette idée avec la « volonté générale » selon laquelle l’individu, individualiste par nature, devient social en adhérant à ce pacte, qui le transforme.
Mais ce contrat reste hautement paradoxal et c’est pourquoi je disais plus haut dans cet article que ce contrat est inconsciemment signé ou autrement dit : personne ne signe librement !
Naître en démocratie, c’est être soumis sans choix à ce contrat social – et devoir payer des impôts, par exemple, même sans jamais aller voter. On ne peut en sortir, contrairement à l’accord classique et les révolutionnaires ont même exploité cette logique pour exclure ceux qui rejettent le contrat, les privant d’humanité au nom du progrès.
Le Léviathan et la violence démocratique
Hobbes incarne cette vision froide et qui nous rend passifs avec sa description du Léviathan, inspiré d’un monstre biblique – un serpent symbolisant le chaos ou le diable –, ce qui n’est pas anodin.
Hobbes défend quand même cet État absolu, plus fort que les individus, et Cromwell, autre figure de cette pensée, montre la brutalité de ce système monstrueux en Irlande, en massacrant et asservissant au nom d’une République naissante.
Cromwell préfigure ainsi une violence inhérente à l’idéologie démocratique.
Cette logique de société atomisée et d’un État fort naît d’une philosophie sans lois naturelles et affaiblissant les communautés organiques (couples, familles, rues, villes, nations). Il ne reste que des individus qui ne sont plus que des grains de sable malléables.
La démocratie moderne, via la loi, tente de forcer les individus grains de sable à se fédérer. Mais plus elle s’étend, intégrant de diverses populations, plus elle devient rigide et trébuchante.
L’état d’urgence en France en 2016 illustre parfaitement ce mécanisme où l’État devient policier pour prévenir la guerre civile, sous couvert du « pacte républicain » – un avatar du contrat social.
Cette force brutale, démocratique, loin d’être une dérive, est dans son ADN : pour unifier des atomes sociaux, elle exige un pouvoir centralisé et oppressif.
Cette dynamique détruit les structures naturelles en formant un chaos sans socles où les familles, les rues, les villages et les nations s’effritent, remplacées par une masse informe d’individus grains de sable.
C’est ainsi que la matière sociale se disloque, engendrant un chaos inédit.
Dans le même temps, l’idéologie aveuglante du progrès démocratique non questionnable nie toute hiérarchie objective des valeurs et fait de l’homme (quel homme ?), le seul arbitre du bien et du mal. Comme dans la promesse du serpent au jardin d’Éden (« vous serez comme des dieux »), il dessine ses propres lois, mais sans ancrage, s’égare.
Les communautés naturelles – couples, familles, quartiers, villes, nations, sont aujourd’hui attaquées et doivent être démantelées pour laisser place à un monde plus « ouvert et plus universel ».
C’est le discours dominant des médias mainstream globalistes : les communautés seraient un obstacle à une société rationnelle.
Les droits de l’homme (quel homme ?), deviennent notre nouvelle métaphysique
Mais, cette nouvelle métaphysique n’est pas enracinée dans une réalité singulière.
L’être humain n’existe qu’à travers des appartenances concrètes – un couple, une famille, un quartier, une patrie, une histoire, des héritages.
Or, aujourd’hui, cette incarnation est sacrifiée au profit d’un cosmopolitisme abstrait, s’appuyant sur cette idéologie de l’individualisme née à la Renaissance : en réduisant l’homme à un individu détaché, on aboutit fatalement à un universalisme qui nie les différences.
La démocratie moderne, en s’alliant au mondialisme, rejette par principe toutes frontières, singularités et histoires nationales et ce projet ne date pas d’aujourd’hui.
Dès le Moyen Âge, des penseurs, souvent en conflit avec la papauté, imaginent une gouvernance supranationale.
Pierre Dubois, légiste de Philippe le Bel, propose au XIIIe siècle une confédération des royaumes contre Boniface VIII et plus tard, en Hongrie, un projet similaire avec Marsile de Padoue se revendique comme le pionnier de la souveraineté populaire tout comme au XVIIe siècle, Sully, sous Henri IV, rêve d’un « État des nations ».
Ces idées culminent avec les Lumières, puis la Société des Nations au XXe siècle.
Chaque fois, il s’agit de dépasser les pouvoirs locaux et celui de l’Église, au profit d’une autorité universelle !
Le cosmopolitisme, incarné par Érasme
L’adage « Je suis citoyen du monde, de tous les pays et d’aucun » –, va de pair avec cette ambition universelle proclamée et le cosmopolite, indifférent aux nations, se voit comme une élite détachée, profitant d’un monde uniformisé.
Cette vision s’oppose à la métaphysique biblique de la dualité de Dieu et de l’homme, pour adopter un monisme où tout se fond dans un cosmos unique.
Nous soulignons donc que ce débat de la démocratie est non seulement politique, mais religieux et métaphysique.
Rousseau a dit qu’on ne peut déléguer la souveraineté populaire et a critiqué l’utopie démocratique. Pour lui, la souveraineté populaire, indivisible et non délégable, ne fonctionne que dans une démocratie directe à petite échelle.
Dès l’origine, Rousseau perçoit les contradictions internes de la démocratie : elle promet un pouvoir au peuple, mais finit par le confisquer.
Certains, attachés à la nation face au mondialisme, s’inspirent de lui pour prôner des « petites patries », mais philosophiquement, le contrat social nous arrache déjà à l’histoire et aux communautés enracinées, projetant l’homme dans une abstraction hors-sol.
Peut-on être démocrate et chrétien ?
Historiquement, la souveraineté populaire naît chez des théologiens dissidents, comme Marsile de Padoue, un franciscain exilé au XIVe siècle à la cour de Louis de Bavière, en conflit avec Jean XXII. Dans un débat sur l’élection de l’empereur du Saint-Empire, il soutient que le pouvoir vient du peuple, non du pape, une idée reprise par le Jésuite Suárez contre l’Église anglicane.
Après 1789, des chrétiens cherchent à réconcilier foi et République avec Félicité de Lamennais qui plaide pour cette union et Grégoire XVI, dans l’encyclique Mirari Vos (1832), la rejette.
Dès 1791, Pie VI, dans le « Quod Aliquantum », avait critiqué la Révolution pour son rejet de l’ordre naturel, et cette opposition domine le XIXe siècle : « Liberté et égalité sont absurdes ; les enfants naissent soumis, et tous doivent obéir à Dieu. »
Léon XIII marque un tournant et dans « Au milieu des sollicitudes » (1892) et « Rerum Novarum » (1891), il reconnaît les régimes établis, y compris la République, sous réserve qu’ils ne contreviennent pas à la loi divine.
Il affirme que la légitimité des régimes dépend de leur conformité à l’ordre naturel. Inspiré d’Aristote, il admet une forme de démocratie enracinée dans une métaphysique transcendante, distincte de la version moderne issue des Lumières.
Mais le mouvement démocrate-chrétien, né de ces textes, dérive vite avec Marc Sangnier et le Sillon qui prônent une égalité évangélique, même si Pie X, en 1910, condamne cette assimilation, réaffirmant que la souveraineté populaire contredit la doctrine catholique.
Après la Seconde Guerre mondiale, Jacques Maritain, financé par les Américains et soutenu par de Gaulle, publie « Christianisme et démocratie » en 1942.
Il soutient que les Lumières prolongent la chrétienté, une thèse en fait diffusée pour rallier l’opinion contre Pétain. Ambassadeur à Rome, ami de Paul VI, Maritain influence Vatican II, qui entérine la liberté religieuse et un rapprochement avec la démocratie moderne. Ce compromis dilue le christianisme et aujourd’hui, la « démocratie chrétienne » est en perte d’identité.
Une démocratie chrétienne peut exister, mais en dehors du contrat social.
Cela implique une société organique, fondée sur le couple, la famille et les corps intermédiaires, comme la subsidiarité, et non un face-à-face entre l’individu et l’État.
Et la Révolution de 1789, avec son jacobinisme, a écrasé ces structures organiques et naturellement ancrées au profit d’une abstraction centralisatrice.
Concluons en poussant à différentes réflexions
Une démocratie à grande échelle, avec des millions d’individus, est-elle viable ? Rousseau a dit que la souveraineté ne se délègue pas sans se perdre.
À l’échelle étatique moderne, nous avons tous observé les dérives de la bureaucratie, de l’excès de régulations, du totalitarisme, du despotisme mondialiste – plutôt qu’à une liberté nationale alignée à celle du citoyen.
La démocratie moderne est devenue un « monstre tyrannique froid », qui en plus de cela a le pouvoir de redéfinir la morale via ses institutions, qui deviennent ensuite sacrées et inamovibles.
Voici donc la question clé de l’enfermement idéologique démocratique et les plus grands des despotes à renverser sont nos idées.
« La lutte des membres de cette bureaucratie virtuelle pour le pouvoir » expliquée par Olavo de Carvalho nous fait penser au scandale récent de l’USAID.

Chapitres 249 & 250 du « Cours de Philosophie » d’Olavo de Caravalho.
Chapitre 249 : Les principaux enjeux des sciences sociales.
Chapitre 250. Phénoménologie du pouvoir.
249) Les principaux enjeux des sciences sociales.
Les commentateurs et les politologues ont l’habitude d’échouer lamentablement dans leurs prédictions. En effet, ils ont affaire à un ensemble d’outils qui n’est pas adapté à la situation actuelle, même s’il aurait pu fonctionner à d’autres moments.
Il faut donc aborder le problème du fondement des sciences sociales et essayer de savoir quelle est la connaissance de la société humaine et quels doivent être les instruments perceptifs et conceptuels qui permettent d’appréhender ce qui s’y passe.
Durkheim définit le fait sociologique, dans le livre “Les règles de la méthode sociologique”, de telle manière que les intentions subjectives des êtres humains ne comptent pour rien, comme si tout se résumait à des structures qui agissent sur les personnes sans aucune intentionnalité de leur part.
Karl Marx traite l’histoire en termes de structures impersonnelles, et au moment où vous arrivez à Braudel, il n’y a plus de personnages, juste des concepts généraux, des statistiques, etc. Les forces historiques apparaissent comme des divinités avec une volonté propre au-delà des intentions des individus concrets impliqués.
En réalité, personne n’a jamais observé une force impersonnelle agir, nous ne pouvons identifier certaines constantes que lorsque nous voyons des personnes agir, et alors un concept général peut être créé.
Ce qu’il faut faire, c’est chercher une action réelle et concrète, dans la lignée du nominalisme portugais, qui a également influencé Gilberto Freyre.
La première question qui se pose est de savoir qui est le véritable personnage de l’Histoire. Quand on parle «d’Histoire du Brésil», en réalité le Brésil n’est pas un personnage mais le décor où se déroule l’Histoire. Même si nous pensons au Brésil en termes d’identité politico-juridique, cela a déjà changé plusieurs fois, sans continuité.
Si l’on admet que c’est l’Histoire des classes sociales, comme chez Marx, en réalité celles-ci ne se rencontrent ni ne se coordonnent pour agir, même si certains dirigeants disent qu’ils agissent au nom des classes. Pire encore, si l’on parle de l’intérêt de la classe, par exemple, quel serait l’intérêt de la bourgeoisie ?
Chaque bourgeois a son intérêt propre, qui peut être opposé à celui des autres bourgeois, mais il est possible de créer un artifice et de définir l’intérêt de la bourgeoisie non pas en termes de besoins matériels réels de la bourgeoisie mais en termes de besoins supposés avec l’antagonisme qu’il aurait par rapport aux intérêts du prolétariat.
À son tour, l’intérêt du prolétariat n’est pas non plus défini substantiellement, mais comme une opposition logique aux intérêts de la bourgeoisie.
Les communistes pensaient que le prolétariat voulait prendre le contrôle des entreprises, mais quand, au XIXe siècle, il y a eu une montée du prolétariat, il s’est détourné du communisme et ne voulait que de meilleurs salaires, la sécurité sociale, etc.
Si les prédictions historiques fondées sur des entités anonymes échouent lamentablement, on ne peut pas non plus dire que l’Histoire n’est composée que d’actions individuelles, car une action n’est historique que lorsqu’elle transcende la durée de la vie humaine.
Ainsi, le mystère de cette première question s’approfondit, car le sujet agent de l’Histoire ne peut être ni une entité fantomatique (nations, classes, groupes) ni l’individu humain.
La deuxième question consiste à essayer de savoir ce qu’est l’action historique.
Une action purement personnelle, comme prendre une douche, n’a pas la même portée qu’une action comme aller travailler, qui implique plus de personnes.
Et cela, à son tour, n’a pas la portée d’une action historique, qui peut changer le destin de sociétés entières.
Une troisième question concerne la nature du pouvoir.
Toute action efficace suppose le phénomène du pouvoir, il faut donc partir ici d’une phénoménologie du pouvoir, et aborder les questions qui se présentaient à nous dans l’ordre inverse.
250) Phénoménologie du pouvoir.
La façon la plus simple de définir le pouvoir est comme possibilité concrète d’action.
Dire que c’est une possibilité concrète signifie que nous avons déjà les moyens d’action nécessaires ou que nous pouvons facilement les avoir, donc ce n’est pas une simple possibilité hypothétique (absence d’empêchements).
Par exemple, nous avons le pouvoir de déplacer une table. Mais le pouvoir politique n’est pas seulement une possibilité d’action individuelle, il requiert un transfert du sujet d’action. Le pouvoir politique est donc la possibilité concrète de déterminer les actions d’autrui.
Il existe trois manières d’agir sur les tiers.
La forme la plus évidente est la menace d’agression ou de punition, qui s’exerce naturellement contre un animal domestique ou un enfant, et à laquelle on ne peut jamais vraiment renoncer. Le second moyen d’influence est la promesse d’un bénéfice.
Le premier moyen est assez efficace et immédiat, mais nous devons avoir un pouvoir coercitif suffisant pour l’exercer.
La seconde dépend des intérêts et de la libre décision du subordonné.
Un troisième moyen d’agir sur les tiers repose sur la persuasion et la fascination, plus précisément sur l’utilisation du langage pour modeler la vision du monde de l’autre afin qu’il agisse dans les limites que nous lui avons prescrites, étant donné qu’ils ne peuvent en concevoir d’autres.
Au premier moyen d’influence (menace) correspond le pouvoir politico-militaire, au second (promesse de bénéfice) correspond le pouvoir économique financier et au troisième (convaincre) correspond le pouvoir intellectuel-spirituel.
À ces trois modalités de pouvoir correspondent trois couches ou classes sociales aux incarnations historiques différentes et aux degrés d’influence différents.
En Occident, la classe militaire a été décisive après le démembrement de l’Empire romain, créant des poches de résistance aux évasions barbares et donnant plus tard naissance à la féodalité, d’où émerge la figure du roi, vue comme primus inter pares.
Plus tard, une partie de la noblesse a commencé à avoir une activité distincte de l’armée, s’engageant dans des activités commerciales, financières (renforcées par la découverte par les banques de la possibilité d’effet de levier) et immobilières.
Puis, au Moyen Âge, commence l’influence du pouvoir économique et financier, normalement attribué à la bourgeoisie mais qui commence réellement comme une activité des nobles.
Ce pouvoir a fini par supplanter le pouvoir féodal, mais ce fut une évolution qui a duré plusieurs siècles.
Le pouvoir du roi augmentait également, ce qui entraînait la nécessité d’une organisation centrale et cela provoqua une dispute entre le roi et l’aristocratie.
C’est à partir de là qu’est née la bureaucratie professionnelle, qui était un moyen d’ascension pour la petite bureaucratie urbaine qui possédait quelques compétences administratives ou comptables. L’aristocratie resta sans activité car, surtout en France, le roi avait sa bureaucratie professionnelle et son armée.
Mais comme l’aristocratie avait toujours le droit de percevoir des impôts dans ses domaines, elle pouvait devenir une classe de loisir.
Un phénomène particulier lié à la bureaucratie s’est produit, dérivé du fait qu’il y avait trop de candidats pour le nombre de places disponibles.
Ainsi, une bande de plébéiens a fait des études pour entrer dans la bureaucratie mais n’a pas pu trouver de place, et ce sont ces individus relativement alphabétisés qui formeront la classe révolutionnaire par excellence.
La formation d’armées professionnelles signifie que les militaires sont devenus des fonctionnaires, c’est-à-dire que le pouvoir militaire a cessé d’être un pouvoir en soi et est devenu un instrument de la bureaucratie d’État, qui est à son tour soutenu par les capitalistes. Ensuite, l’apothéose du pouvoir financier se crée lorsqu’il subalterne le pouvoir militaire. Le pouvoir financier est un pouvoir d’attraction mais n’intimide ni ne détruit personne. L’argent n’est pas un pouvoir en soi, il n’a pas le potentiel de tuer, il n’a le pouvoir d’attirer que par la promesse de bénéfices, agissant indirectement à travers un processus compliqué plein d’ambiguïtés psychologiques.
L’une de ces ambiguïtés, étudiée par Aleksandr Zinoviev dans le livre “La réalité du communisme”, se retrouve dans l’exemple d’une entreprise.
Elle doit maîtriser une technologie correspondant au produit qu’elle propose, elle doit connaître les marchés, etc.
Mais, à l’intérieur, les gens essaient de monter dans la hiérarchie, et pour cela il faut aussi une technologie – on peut dire une technique politique –, qui entre facilement en conflit avec d’autres technologies s’il n’y a pas de facteur fédérateur.
Avec la montée du pouvoir financier, toute une ligne d’action a gagné en pertinence visant à monter en bureaucratie, qu’elle soit privée ou étatique ou même virtuelle (ceux qui sont là et qui n’ont pas encore réussi à entrer).
Cet élément de tension qui existe dans la société capitaliste atteint son apothéose dans la société socialiste, où il y a une lutte entre la technique politique et la technique économique.
Ce n’est qu’au sein du Parti qu’il est possible de gravir l’échelle sociale.
Cela n’a aucun sens de voir le processus d’accession au pouvoir comme un dérivé du processus économique, qui est le processus d’efficacité capitaliste, car le processus d’accession au pouvoir est complètement différent.
Beaucoup de gens croient qu’une économie faible fait tomber la classe politique, ce qui peut arriver dans une démocratie, mais dans un système fortement socialiste, la structure du pouvoir est très robuste, car elle découle d’un jeu politique perfectionné, qui peut coexister avec une économie défaillante.
La bureaucratie virtuelle est composée de journalistes, d’écrivains, d’orateurs, de propagandistes, d’enseignants, de prêtres, etc. C’est de cette classe que sortent les intellectuels modernes. C’est une immense classe sans pouvoir direct, avec les compétences nécessaires pour gravir les échelons de la bureaucratie mais sans les compétences nécessaires pour accomplir une fonction économique productive.
Ainsi, ses membres ne peuvent s’élever dans la vie que par l’activité politique.
À partir du XVIIIe siècle, cette classe a commencé à créer une littérature pour légitimer sa propre ascension, prétendant généralement agir au nom de l’humanité ou au nom des pauvres et des opprimés.
Évidemment, lorsque ces personnes domineront la société, les activités économiques, industrielles, commerciales vont décliner et la conséquence est une baisse du niveau de vie. Avec la création des universités modernes, au XIXe siècle, la bureaucratie virtuelle s’est encore accrue, et on considère aujourd’hui que le progrès consiste à augmenter de plus en plus cette classe, qui ne produit rien mais est qualifiée pour l’activité politique, quoique sans avoir encore le pouvoir.
La lutte des membres de cette bureaucratie virtuelle pour le pouvoir devient de plus en plus constante, chacun parlant au nom de la population en général ou comme s’il était un représentant de l’humanité, mais ce qu’ils font, c’est marcher sur tout le monde.
251) Le sujet de l’Histoire.
Procurez-vous le livre « Cours de philosophie d’Olavo de Caravalho« .
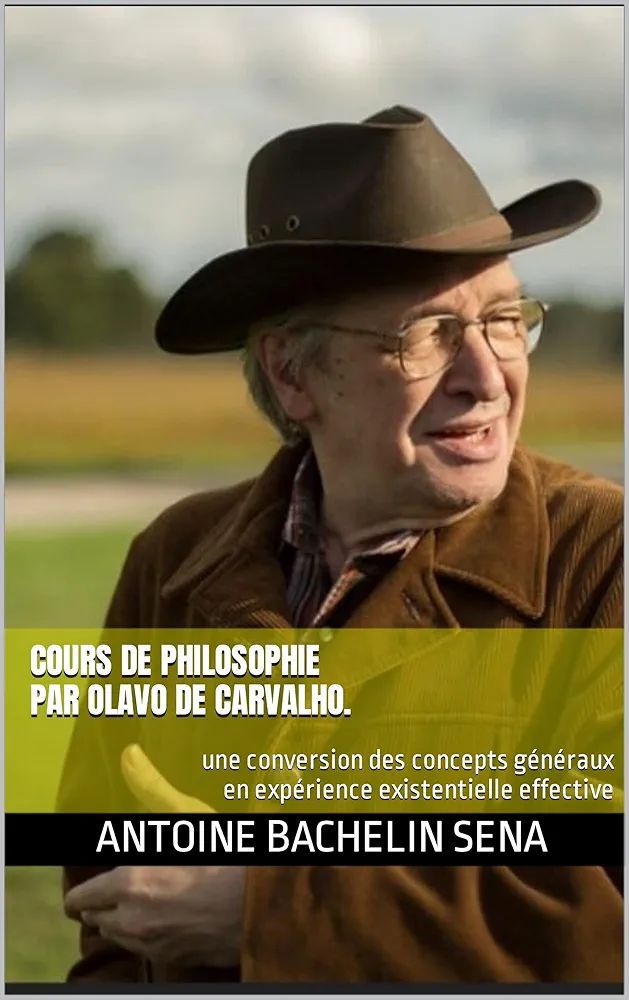
Le message résumé d’Olavo de Carvalho. Philosophe et écrivain brésilien.


Olavo de Carvalho (1947-2022) était un philosophe, écrivain et auteur à succès brésilien.
Procurez-vous le livre «Cours de Philosophie d’Olavo de Carvalho.»
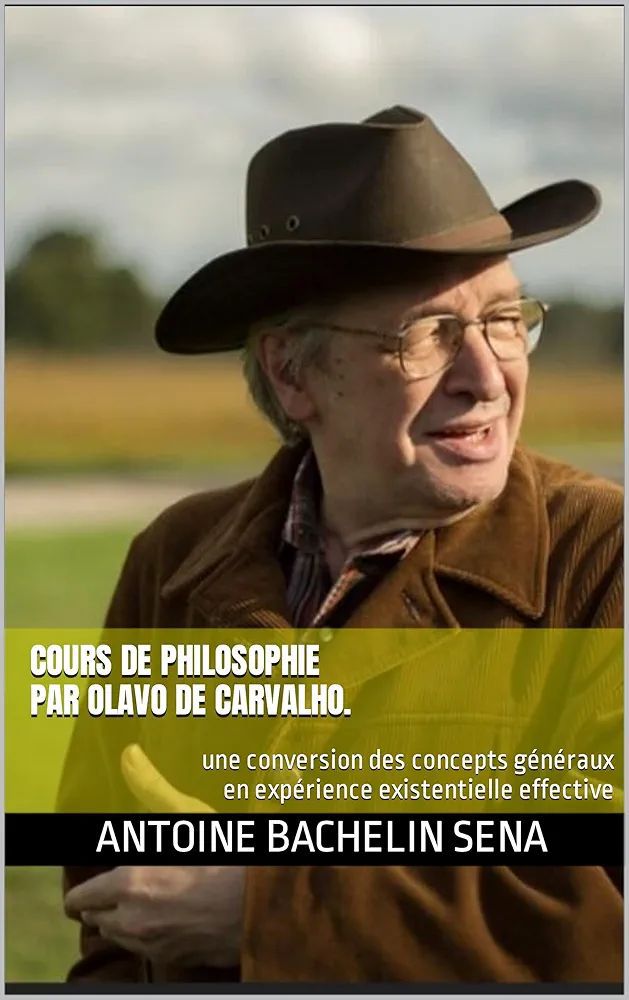
Olavo démontre la fausseté des icônes culturelles.
On se retrouve dans le vide car toutes les sécurités idéologiques sont cassées sans violence, de façon lucide et naturelle.
Les répétitions mécaniques que les gens font sont cassées.
C’est une cassure existentielle avec nos sécurités intellectuelles.
Olavo m’a vacciné contre l’hédonisme, le matérialisme, le scepticisme qui règnent dans les médias, les universités et l’imaginaire collectif.
Il a mis en lumière l’incompatibilité des discours des soi-disant intellectuels face à leur pratique quotidienne cynique et vide de toute pratique éthique autrement dit hypocrite.
Il crée un bouleversement dans la structure de notre pensée pour assumer un moi qu’on ne peut corrompre pour que notre vie prenne de la cohérence et une direction personnelle.
Cela détruit tout relativisme autrement dit le scepticisme comme attitude de vie très répandue et promue par certains intérêts à notre époque.
Et le scepticisme absolu entraîne le doute permanent sur tout, ce qui est un suicide de l’esprit et un aveuglément permanent.
L’engagement éthique nous libère, nous émancipe et nous donne du courage.
Aller contre la majorité et ne pas être prisonnier d’un amas de mensonges et de superficialités, c’est l’authenticité.
Répéter des formules et protocoles à l’école avec un chantage émotionnel de suivre le groupe, un dressage collectif est une folie suicidaire alors qu’il faut émotionnellement et socialement être prêt à questionner notre situation sociale.
Ceux qui ne peuvent décrire la réalité montrent juste leur carte du club autrement leur appartenance ou auto identification au groupe. Ils partagent juste les lieux communs avec un sens de concordance, acquis dans un dressage de protocoles.
Cela renforce des manques émotionnels.
Le système d’éducation sociale corrompt notre liberté de penser.
Carvalho a publié ses premiers livres dans les années 1990, qui restent aujourd’hui en circulation avec 30 autres titres publiés.
– (1994). Une ère nouvelle et une révolution culturelle : Fritjof Capra & Antonio Gramsci [Le nouvel âge et la révolution culturelle] ;
– (1995). O jardim das aflições: de Epicuro à ressurreição de César – ensaio sobre o Materialismo e a religião civil [Le jardin des afflictions : de l’épicure à la résurrection de César – une étude sur le matérialisme et la religion civile] ;
– (1996). Aristote em nova perspectiva : Introdução à Teoria dos Quatro Discursos [Aristote dans une nouvelle perspective : Introduction à la théorie des quatre discours] ;
– (1996). O imbecil coletivo: atualidades inculturais brasileiras [L’imbécile collectif : l’actualité inculturelle brésilienne] ;
– (1997). O futuro do pensamento brasileiro : Estudos sobre o nosso lugar no mundo [L’avenir de la pensée brésilienne : Études sur notre place dans le monde].
De 2009 à 2022, année de son décès, il a donné des cours en ligne à des milliers d’étudiants.
Carvalho a laissé des contributions indélébiles dans les domaines de la philosophie, de la littérature et des sciences politiques.
Après sa mort, ses enseignements continuent d’inspirer et de façonner le paysage intellectuel, laissant une marque durable sur le discours entourant la philosophie et l’environnement culturel.
Procurez-vous le livre«Cours de Philosophie d’Olavo de Carvalho.»
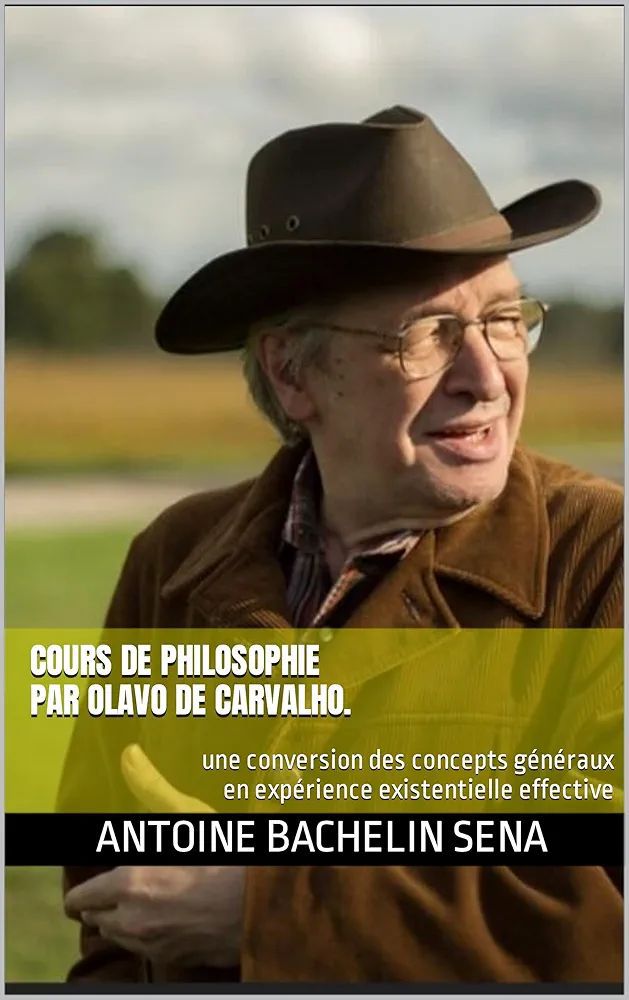
La recherche de l’unité de la connaissance dans l’unité de la conscience de soi. Chapitre 49 du cours de philosophie par Olavo de Carvalho.

Voici tout d’abord les autres chapitres de ce cours 5 pour situer un peu :
- 43. La dialectique de la compréhension.
- 44. La logique est utilisée certaines fois pour camoufler l’expérience réelle.
- 45. Science moderne et camouflage.
- 46. Validation de l’expérience commune.
- 47. Universaux abstraits.
- 48. Le contenu dramatique de la thèse philosophique.
- 49. La recherche de l’unité du savoir dans l’unité de la conscience de soi.
- 50. Les différentes conceptions de la foi.
- 51. Exclusion et dépassement.
- 52. Évocation des expériences du philosophe.
- 53. Exercice de Présence dans l’Univers.
Voici le chapitre 49 du Cours 5 qui débute à la page 32 du livre «Cours de philosophie par Olavo de Carvalho» puis nous exposerons au final différents points.
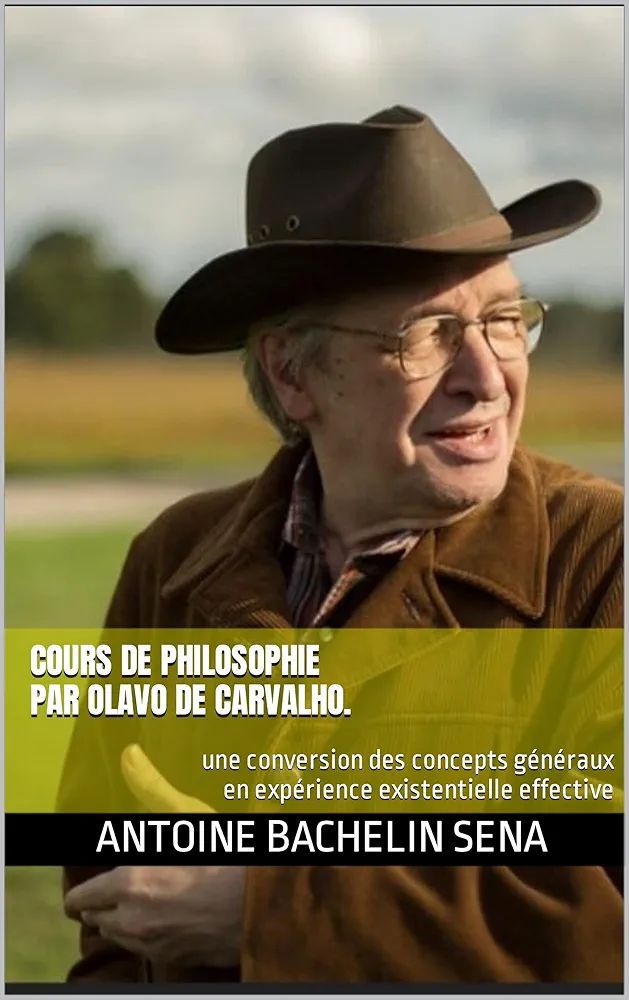
« Il n’y a d’unité de connaissance que dans l’unité de conscience de soi en Dieu, et la philosophie cherche à en acquérir et à en conserver une partie.
L’oubli nous hantera toujours et un sillon doit être creusé dans notre personnalité qui est celui du sens du rôle de l’ignorance dans notre investigation philosophique.
De nombreux scientifiques célèbres parlent comme si les connaissances qu’ils possèdent dans un domaine spécialisé leur donnaient autorité pour se prononcer sur n’importe quel sujet.
Et c’est pourquoi ils ignorent même la situation réelle à partir de laquelle ils écrivent, montrant qu’ils se sont laissés capturer par la capacité d’abstraction et sont entrés dans l’aliénation, c’est-à-dire qu’ils ont commencé à ignorer la structure de la réalité et se sont lancés dans une action cognitivement irresponsable – hypnotique et auto-hypnotique – dans un théâtre mental créé par eux.
Chesterton disait que la différence entre le poète et le fou est que le poète met sa tête dans le monde et le fou met le monde dans sa tête.
Nous n’avons pas inventé le monde, nous ne l’embrasserons jamais, nous ne pouvons que nous ouvrir à lui et laisser la réalité nous enseigner.
Mais la précipitation à tirer des conclusions et à vouloir boucler la boucle amène à la folie et c’est aussi pourquoi le vote d’abstinence en matière d’opinion est important.«
Pour développer ce chapitre du cours de philosophie d’Olavo de Carvalho, nous allons explorer plusieurs dimensions clés de la recherche de l’unité de la connaissance dans l’unité de la conscience de soi.
– L’Unité de la Connaissance dans l’Unité de la Conscience de Soi en Dieu.
- Unité dans la Conscience de Soi : Olavo de Carvalho pose que la véritable unité de la connaissance ne peut être atteinte que dans une conscience de soi qui se reconnaît dans une relation avec le Divin. Cette unité n’est pas simplement intellectuelle mais existentielle, où la connaissance est vue comme une partie d’une totalité plus vaste, un reflet de l’unité divine.
- Philosophie comme Partie de la Connaissance Divine : La philosophie, dans cette perspective, est une tentative humaine de comprendre et de conserver une fraction de cette connaissance unifiée. Elle est un voyage de l’âme cherchant à se reconnecter avec cette unité originelle, une quête pour la sagesse qui transcende les connaissances fragmentées de notre expérience quotidienne.
– L’Oubli et le Rôle de l’Ignorance.
- L’Oubli comme Partie de l’Investigation : L’oubli est vu comme une constante dans la vie humaine, un rappel que notre connaissance est toujours incomplète. Carvalho suggère que nous devons creuser un sillon dans notre personnalité pour reconnaître l’importance de l’ignorance dans notre quête philosophique. C’est cette reconnaissance de notre ignorance qui nous pousse à une investigation plus profonde et authentique.
– La Critique des Scientifiques et l’Aliénation Cognitive.
- Fausse Autorité des Spécialistes : De nombreux scientifiques, selon Carvalho, se trompent en croyant que leur expertise dans un domaine leur donne une autorité universelle. Cette arrogance mène à une forme d’aliénation où l’individu perd de vue la réalité globale, capturé par sa propre capacité d’abstraction.
- Aliénation et Hypnose Cognitive : Cette aliénation est décrite comme une sorte d’hypnose, où l’esprit se perd dans un théâtre mental de sa propre création, ignorant la structure fondamentale de la réalité. C’est une action cognitivement irresponsable, où on se coupe de l’expérience directe du monde.
– La Métaphore de Chesterton.
- Poète vs. Fou : G.K. Chesterton offre une image puissante avec la comparaison entre le poète qui met sa tête dans le monde pour le comprendre et le fou qui met le monde dans sa tête, le remodelant selon ses propres illusions. Carvalho utilise cette métaphore pour montrer que le philosophe doit chercher à comprendre le monde tel qu’il est, non pas comme il le voudrait ou le projette.
– L’Importance de l’Ouverture et de l’Abstinence d’Opinion.
- Ouverture à la Réalité : Nous ne sommes pas les créateurs du monde, et notre compréhension de celui-ci est toujours partielle. L’ouverture est donc essentielle, permettant à la réalité de nous enseigner plutôt que d’imposer nos propres schémas de pensée.
- Vote d’Abstinence : La précipitation à conclure et à systématiser peut nous mener à la folie. Ainsi, il est crucial de parfois s’abstenir de donner des opinions définitives, reconnaissant les limites de notre connaissance actuelle. Cette abstinence est une forme de sagesse, une reconnaissance humble de l’immensité de ce qui reste à apprendre et à comprendre.
En conclusion, ce chapitre de Carvalho met en lumière une philosophie qui cherche l’unité de la connaissance à travers une conscience de soi profondément enracinée dans une réalité plus vaste, reconnaissant l’importance de l’ignorance, critiquant l’aliénation cognitive et prônant une approche humble et ouverte à la vérité du monde.
Plus dans le livre «Cours de philosophie d’Olavo de Carvalho».
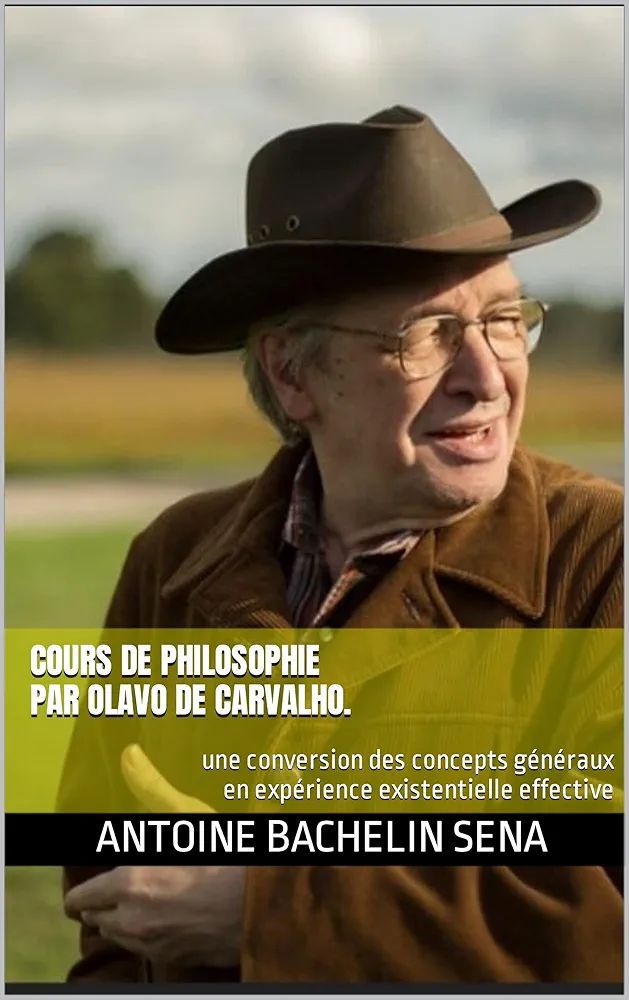
Résumé de la critique d’Olavo de Carvalho à Descartes.

Un résumé de la critique d’Olavo de Carvalho sur Descartes de quelques chapitres du «Cours de philosophie par Olavo de Carvalho : une conversion des concepts généraux en expérience existentielle effective.»
🤔Le doute méthodique de Descartes est un faux semblant, quelque chose d’impossible à mettre en œuvre en fait.
🤔Depuis Descartes l’argumentation a pris le pas sur la perception.
Olavo dénonce cela et montre avec Étienne Couvert que c’était un des objectifs cachés de Descartes.
🤔Le cartésianisme est devenu tellement important des siècles après dans notre société que la preuve est désormais considérée comme plus importante que la connaissance dans notre culture !
Et on voit les ravages causés !
Alors que normalement, moralement nous n’avons pas au nom de la recherche de certitude, le droit de nier une vérité incertaine (comme la présence de l’être qui est la première chose qui vient et que nous ne pouvons pas nier, même si cette présence de l’être n’est pas claire et distincte).
🤔Descartes a aussi créé une rupture avec Dieu en exprimant que la volonté humaine définit elle-même l’échelle du bien et du mal car pour Descartes le monde n’a pas de sens moral étranger à l’homme.
On voit les ravages que cela a aussi créé !
🤔Le cartésianisme met erronément la puissance du libre arbitre au même niveau que Dieu avec une confiance excessive dans le «je».
🤔Avec ce cartésianisme, Dieu devient un pseudonyme pour la raison et cela est devenu la base de tout matérialisme et athéisme par la suite.
Procurez vous le livre
«Cours de philosophie par Olavo de Carvalho : une conversion des concepts généraux en expérience existentielle effective.»
https://amzn.eu/d/6HhlTRd
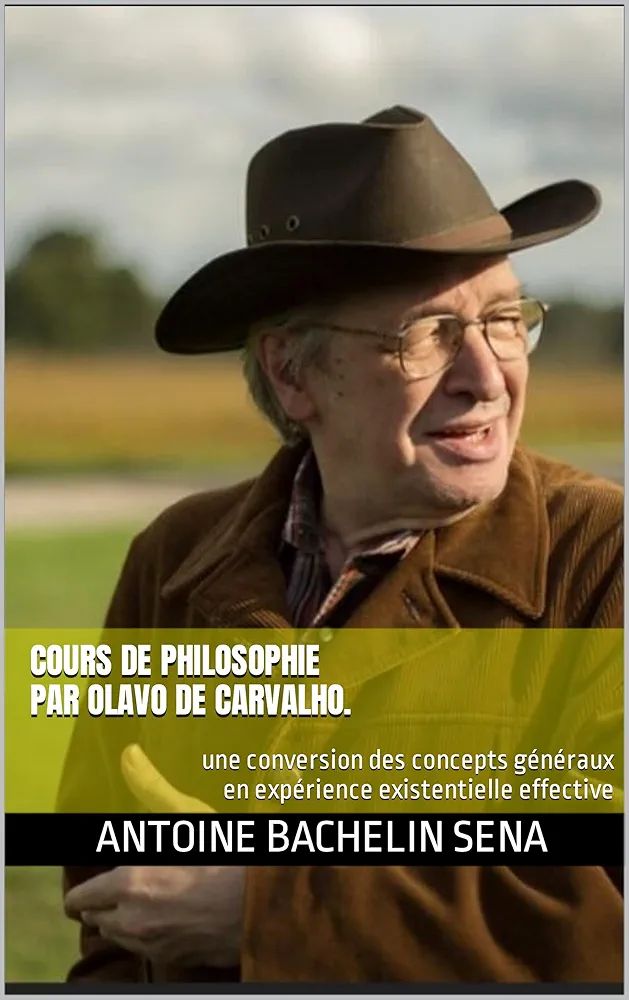
Le philosophe qui défie l’Establishment Intellectuel : Olavo de Carvalho.

**🌟 Découvrez la Pensée Rebelle et Indépendante d’Olavo de Carvalho 🌟**
Plongez dans l’univers fascinant et controversé d’Olavo de Carvalho, un philosophe brésilien dont les idées résonnent bien au-delà des frontières de son pays natal.
Dans cette vidéo, nous vous offrons une introduction à cet intellectuel provocateur qui a défié le statu quo avec une audace sans précédent.
**Ce Que Vous Allez Apprendre :**
– **Qui est Olavo de Carvalho ?** Une biographie concise de l’homme qui est devenu une figure centrale du débat intellectuel au Brésil et à l’international.
– **Sa Philosophie Unique :** Explorez les fondements de sa pensée, de sa critique acerbe du marxisme à ses réflexions sur la culture, la religion, et la société.
– **L’Impact de Ses Idées :** Comment ses enseignements ont influencé la politique, la philosophie, et le mouvement conservateur au Brésil.
– **Les Controverses :** Un regard sur les débats enflammés et les polémiques que ses opinions ont suscités.
– **Pourquoi il Divise :** Analyse de pourquoi Olavo est autant aimé par certains que critiqué par d’autres.
**Pourquoi Regarder ?**
– **Comprendre le Monde Actuel :** Gagnez une perspective différente sur les dynamiques politiques et sociales actuelles.
– **Pensée Critique :** Soyez challengé par des idées qui encouragent à questionner les narratifs dominants.
– **Culture et Philosophie :** Enrichissez votre savoir avec une discussion philosophique profonde et engageante.
**Ne ratez pas l’occasion de découvrir pourquoi Olavo de Carvalho est décrit comme un « intellectuel hors normes », un « provocateur de génie » ou encore « un penseur à contre-courant ».**
👉 **Abonnez-vous** pour ne rien manquer des prochaines analyses de figures influentes et de mouvements intellectuels qui façonnent notre monde.
📌 **N’oubliez pas de liker et de partager** cette vidéo si vous trouvez que la pensée d’Olavo de Carvalho mérite d’être discutée et entendue.
#OlavoDeCarvalho #Philosophie #PenséeRebelle #Conservatisme #DébatIntellectuel #CultureBrésilienne
Le minimum à savoir pour ne pas être un idiot : tutoriel basique d’indépendance par Olavo de Carvalho.

1) 🌱🤔L’introspection sociale & politique,
2) 🗣💡L’authenticité en paroles ou en écrits face à Dieu nous apporte en retour de nouvelles idées,
3) 🧠🌌 Rechercher l’unité de la connaissance dans l’unité de la conscience de soi.
———————————
1) 🌱🤔L’introspection sociale & politique.
Le cours de philosophie d’Olavo de Carvalho s’inspire de ce que Socrate a décrit comme exemple fondamental :
Nous ne poursuivons pas la philosophie en tant que profession, car cela nous lierait aux exigences bureaucratiques, tout comme nous serions liés par la vanité d’appartenir à un club restreint, ce qui exigerait beaucoup d’efforts de notre part.
Socrate insistait sur une vie examinée : ses interlocuteurs étaient constamment sommés de regarder leur véritable situation sociale et politique, et c’est le point de départ des méditations.
🚨⚠️L’universitaire moderne n’examine malheureusement jamais sa situation sociologique et ne verra pas comment elle le limite ou lui profite.
C’est quelque chose qui ne fait pas partie de son théâtre ; c’est comme s’il supposait que le milieu universitaire est le lieu naturel où se produisent les connaissances et que tout le reste n’est que dilettantisme.
Socrate a montré comment la société peut prendre conscience d’elle-même.
La connaissance objective et universelle des choses y est confondue avec la connaissance de soi, qui requiert une personne réelle, et non une simple exécution de rôles sociaux.
Cela indique déjà ce que doit être la technique philosophique : une conversion des concepts généraux en expérience existentielle effective et vice versa.
De nombreux scientifiques célèbres parlent comme si les connaissances qu’ils possèdent dans un domaine spécialisé leur donnaient autorité pour se prononcer sur n’importe quel sujet.
Et c’est pourquoi ils ignorent même la situation réelle à partir de laquelle ils écrivent, montrant qu’ils se sont laissés capturer par la capacité d’abstraction et sont entrés dans l’aliénation, c’est-à-dire qu’ils ont commencé à ignorer la structure de la réalité et se sont lancés dans une action cognitivement irresponsable – hypnotique et auto-hypnotique – dans une sorte de théâtre mental créé par eux.
Chesterton disait que “la différence entre le poète et le fou est que le poète met sa tête dans le monde alors le fou met le monde dans sa tête.”
Nous n’avons pas inventé le monde et nous ne pouvons que nous ouvrir à lui et laisser la réalité nous enseigner.
Mais la précipitation à tirer des conclusions et à vouloir boucler la boucle amène à la folie et c’est pourquoi ⚠️ le vote d’abstinence en matière d’opinion est important.
2) 🗣💡L’authenticité en paroles ou en écrits face à Dieu nous apporte en retour de nouvelles idées.
Saint Augustin dans sa méthode de confession expose la sincérité la plus profonde qui nous est possible à ce moment-là.
Ici s’articulent la connaissance désirée, l’individualité concrète – avec sa misère, son ignorance, son oubli et son aveuglement – et le récit qui nous place devant l’observateur omniscient.
La 🗝️ c’est que nous racontons à Dieu notre vie, mais il en sait plus que nous, donc notre sincérité est récompensée et nous obtenons en retour un peu plus de connaissances.
Cela ressemble à une description d’une pratique mystique à laquelle peu de gens peuvent accéder, mais en réalité, il est presque impossible de ne pas reproduire cette situation.
Lorsque nous parlons ou écrivons sur quelque chose, en toute sincérité, alors quelque chose nous vient à l’esprit que nous ne connaissions pas auparavant, des points sont clarifiés, des chemins s’ouvrent.
Beaucoup vivent cachés, même s’ils s’affichent publiquement, n’ayant pas de lieu où ils puissent s’exposer sans restrictions et sans conditions, c’est pourquoi ils n’ont pas cette expérience aussi simple que profonde, toujours nouvelle, vivifiante.
3) 🧠🌌 Rechercher l’unité de la connaissance dans l’unité de la conscience de soi.
Qu’est-ce que ce dialogue dans la solitude ? En lisant les discours de beaucoup de religieux, il semble qu’ils parlent avec Dieu avec la plus grande facilité, comme s’ils étaient très proches.
Quel est cet ancrage qui les habitent ?
Antonio Machado dit ceci : « Celui qui parle seul avec soi-même s’attend à parler avec Dieu un jour ». Le dialogue avec soi dans la solitude doit précéder une vraie conversation avec Dieu.
👉 Il n’y a d’unité de connaissance que dans l’unité de conscience de soi en Dieu.
Plus dans cet article sur «La recherche de l’unité de la connaissance dans l’unité de la conscience de soi. Chapitre 49 du cours de philosophie par Olavo de Carvalho.»
Plus dans le livre «Cours de Philosophie par Olavo de Carvalho.»
Les erreurs idéologiques de la vision eurasienne d’Aleksandr Dugin par Olavo de Carvalho.

Les critiques d’Olavo à Dugin sont profondes et multidimensionnelles, couvrant des aspects philosophiques, religieux et géopolitiques.
Dugin est critiqué pour adhérer à des notions incohérentes et manipuler des symboles à des fins de propagande.
Il faut défendre une vision de la conscience humaine et de la liberté profondément enracinée dans la philosophie et la tradition biblique, contrastant avec les conceptions géopolitiques et holistiques de Dugin.
Cette analyse met en lumière les divergences fondamentales entre les deux penseurs, soulignant l’importance de la quête de vérité et de la liberté individuelle dans la perspective de Carvalho.
Thread 🧵 sur les erreurs idéologiques de la vision eurasienne de Dugin puis vidéo à la fin pour ceux qui préfèrent le format vidéo.
1) Dugin se trompe en pensant que les États sont des agents historiques.
Ils sont plutôt des résultats de processus complexes.
2) Les véritables agents historiques sont ceux qui maintiennent une continuité d’action à travers le temps, comme les religions, les dynasties familliales et les sociétés ésotériques.
3) Dugin ne réalise pas qu’il est lui-même un instrument de l’Église orthodoxe, pas de l’empire eurasien.
4) La séparation entre l’Église et l’État en Occident montre que les empires ne sont pas les agents, mais les terrains de jeu des religions.
5) L’Église orthodoxe a survécu à plusieurs empires, prouvant qu’elle est un agent historique plus durable.
6) L’empire eurasien de Dugin est une métaphore trop élastique, couvrant des idéologies incompatibles.
7) Les empires maritimes vs les empires terrestres de Dugin ne tiennent pas compte de la diversité des holismes que Dugin cherche à unifier.
8) Un supra-holisme serait nécessaire pour unifier les idéologies contradictoires de Dugin, ce qu’il n’a pas envisagé.
9) Les dynasties et les mouvements révolutionnaires montrent que l’agent historique est plus complexe que ce que Dugin pense.
10) En conclusion, Dugin fait des erreurs en ne comprenant pas que les véritables agents historiques sont ceux qui transcendent les empires et les nations.
Développement ci-dessous :
Le mouvement révolutionnaire marxiste taillé en pièces par l’examen philosophique via Olavo de Carvalho.

La révolution est un processus d’auto-transformation de la totalité de la réalité et, par définition, n’a pas de limite.
La révolution n’est pas un projet défini à réaliser par certains moyens, elle ne peut exister que comme promesse d’avenir.
Le processus révolutionnaire ressemble à une création artistique et non à l’exécution d’un projet technique ou politique de changement social.
L’idée de révolution est imprégnée d’éléments gnostiques, qui expriment une révolte générale contre la structure de la réalité, vue comme quelque chose de mal.
Le mouvement révolutionnaire ne se conçoit que comme un mouvement qui ne peut pas s’arrêter, c’est pourquoi il n’a pas non plus de point d’arrivée.
Il n’y aura jamais de paramètres de normalité car dans leur vision l’existence est anormale.
Ainsi, cela n’a aucun sens de s’attendre à une quelconque cohérence dans les propositions révolutionnaires, par exemple, les révolutionnaires peuvent être des fois en faveur de lois racistes, et d’autres fois en faveur de lois antiracistes.
Le seul véritable objectif pour les révolutionnaires c’est de provoquer l’inspiration pour que d’autres continuent le mouvement et au final qu’augmente l’élan de la révolution.
Tout rentre dans la révolution, par exemple, Lénine était anti-nationaliste et Staline a utilisé le nationalisme comme la grande arme de la révolution.
Pour être contre révolutionnaire il ne faut pas être bloqué sur des visions technico-scientifiques mais s’aligner à partir du même horizon intemporel.
Et c’est justement à cause de LA PERTE GÉNÉRALISÉE DU SENS DE L’IMMORTALITÉ que la logique révolutionnaire a prévalue en Occident.
C’est ainsi que dans le travail intellectuel, le grand risque que nous courons est celui d’inverser la hiérarchie des valeurs, ce n’est pas celui d’être attaqué par des révolutionnaires.
Comme le mouvement révolutionnaire n’a pas une fin :
- soit il s’éteint par auto-destruction de l’humanité,
- soit la mentalité révolutionnaire est détruite à sa base en écartant tous les révolutionnaires de la vie publique quels que soient leurs propositions.
Le mouvement révolutionnaire doit être rejeté dans son intégralité en comprenant les 3 inversions révolutionnaires :
- a) l’inversion du sens du temps,
- b) l’inversion de la relation sujet/objet et
- c) l’inversion de la responsabilité morale.
Nous ne pouvons parler qu’à partir de notre propre immortalité et une fois que nous en avons acquis le sens.
Plus de détails dans le «Cours de Philosophie d’Olavo de Carvalho.»
Qui est Antoine Bachelin Sena ?

Antoine Bachelin Sena est un ecrivain qui démonte les narratifs et dynamiques de pouvoir.
Retrouvez ses différents livres ici.
Retrouvez Antoine Bachelin Sena sur Twitter et Youtube.
Antoine mentionne souvent des concepts dans le domaine de l’information comme la “guerre de cinquième génération”, où la guerre numérique et la désinformation jouent un rôle crucial.
Ses écrits et ses vidéos sont une invitation à se détacher des narratifs imposés, à retrouver une forme de liberté intérieure où l’individu n’est plus un pion dans le jeu de la tyrannie collective. Antoine Bachelin Sena prône une forme de souveraineté personnelle, où l’écoute de soi devient un acte de rébellion contre les forces qui cherchent à uniformiser les pensées et les comportements.
Sa présence en ligne, ses articles, et ses livres montrent un homme engagé dans la réinformation, cherchant à éduquer et réveiller les consciences.
Antoine ne se contente pas de critiquer; il propose une vision iconoclaste, une invitation à la rébellion intellectuelle et à l’authenticité personnelle dans un monde où la pression sociale et les médias tentent de modeler nos pensées et nos actions.
En 5 minutes : «La stratégie socialiste d’hégémonie» appliquée dans le monde et expliquée par Olavo.

En 5 minutes : «La stratégie socialiste d’hégémonie» appliquée dans le monde et expliquée par Olavo.
Le passage du marxisme «pur et dur» de lutte des classes vers le marxisme culturel a été expliqué en 1985 dans une théorie.
Cette théorie de Laclau & Mouffe a été mise en place dans le monde entier.
Olavo de Carvalho revient dans le chapitre 239 de son cours de philosophie sur cette théorie et ses applications.
Le cours de philosophie d’Olavo de Carvalho est disponible ici : https://shorturl.at/gyAN7
Le pouvoir intellectuel est le plus efficace des pouvoirs, notamment parce qu’il domine le reste.

La formation de la guerre culturelle :
Nous vivons dans un environnement de guerre culturelle, il est donc important de savoir comment se déroule le processus par lequel certaines idées deviennent dominantes dans une société.
L’hégémonie culturelle est le processus par lequel certaines idées sont imprégnées dans la société presque jusqu’à un niveau subconscient, et chacun finit par penser en consonances même sans s’en rendre compte (Antonio Gramsci donne à l’hégémonie un autre sens, celui de la domination d’une classe par une autre, fondant ce qui a été appelé ensuite le marxisme culturel).
Le pouvoir intellectuel délimite les possibilités de concevoir et de percevoir les choses, travaillant sur le long terme, c’est pourquoi il est rarement exercé personnellement (et beaucoup ne le reconnaissent même pas comme un pouvoir) mais il s’avère être le plus efficace des pouvoirs, notamment parce qu’il délimite le reste.
L’usage courant du mot «révolution» est un exemple d’action de pouvoir intellectuel, qui a non seulement vulgarisé l’usage du terme mais lui a aussi automatiquement ajouté tout un imaginaire et y a associé des réactions de base presque inconscientes.
De l’avis général, à partir de 1650, avec les Lumières, il y a eu une sécularisation et une rationalisation de la société.
La culture traditionnelle comprenait l’Église et les universités, mais plus tard une nouvelle intellectualité a émergé qui a conquis l’hégémonie, et l’interprétation que nous faisons de cette période de transition correspond à la vision des nouveaux penseurs.
Suite dans le chapitre 146 du Cours de Philosophie par Olavo de Carvalho disponible ici : https://antoinebachelinsena.com/2023/09/04/mon-nouveau-livre-est-en-prevente-cours-de-philosophie-par-olavo-de-carvalho-une-conversion-des-concepts-generaux-en-experience-existentielle-effective/
Mener le combat des idées aujourd’hui. Philosophie, Édition et Éducation avec Olavo de Carvalho.
Nouvelle vidéo
«Mener le combat des idées aujourd’hui. Philosophie, édition & éducation avec Olavo de Carvalho».
En une minute sur Olavo.
Le livre est disponible à la vente en version papier !
Ce livre d’études pratiques et personnelles permet de revivre des expériences cognitives.
Lien ici : https://shorturl.at/imyET
«Les promesses “bibliques” de la science moderne». Extrait du chapitre 111 du livre «Cours de Philosophie d’Olavo de Carvalho».

L’idéologie scientifique et le marxisme ont vécu côte à côte pendant un certain temps, collaborant parfois, parfois en opposition mutuelle, jusqu’à ce qu’ils fusionnent dans les années 1920 ou 1930, en particulier chez des scientifiques comme John Halden, John D. Bernal, CH Waddington, John D. Barrel, Frank Tipler, Freeman Dyson, Paul Davis, Fred Hoyle.
Le travail conjoint entre la science et le marxisme a ensuite été mis à profit par l’élite mondialiste. L’ambition des scientifiques révolutionnaires est d’étendre la présence humaine à l’univers entier, y compris même tous les univers logiquement possibles, et aussi de prolonger l’existence de l’univers ou même d’empêcher sa fin, peut-être même de changer la forme fermée de l’univers et de modifier sa topologie, de créer des univers artificiels et, cerise sur le gâteau, dans un avenir très lointain peut-être se développera une forme de vie étrangère à la chair et au sang et qui pourra être incorporée dans un bloc nuageux interstellaire ou un ordinateur sensible.
Mary Midgley a rassemblé nombre de ces prétentions dans le livre “Science as Salvation”, où le désir de ces personnes d’accomplir les promesses bibliques de manière inversée est clair, c’est-à-dire que l’homme est une créature purement matérielle mais que la science peut le spiritualiser, peut-être même fabriquer une immortalité pour lui, à incorporer dans une entité, comme une poussière d’étoiles intelligente.
Ils croient vraiment à la possibilité que ces choses se produisent, ce n’est pas comme le font les auteurs de science-fiction, qui mettent en place des situations fictives comme une manière de méditer sur la société dans laquelle ils vivent.
Ils pensent que la fin de l’univers est la fin de tout, alors que c’est un « moment » qui ne représente rien dans l’ordre de l’être.
L’être ne peut être compris que dans la dimension de l’infini et de l’éternité : rien de ce qui s’est passé n’arrivera. Mais ces scientifiques prennent l’existence de l’univers en termes spatio-temporels et le rendent absolu, pensant qu’il n’y a rien d’autre.
Dans le christianisme, la vie plus courte a déjà un sens éternel car elle est déjà dans l’éternité, elle ne dépend pas de ce que l’humanité fera dans le futur, comme le pensent certains scientifiques modernes, qui croient que le futur peut créer une imitation de l’éternité.
L’univers a un ordre total, qui englobe un élément de chaos (le langage a donc besoin d’ambiguïtés, de métaphores, de figures de style) mais englobe également le fait que l’homme comprend des aspects de cet ordre, comme le fait qu’il a plusieurs niveaux.
Ainsi, l’univers n’est pas entièrement gérable mais il n’est pas non plus compréhensible, et nous pouvons être sûrs que nos esprits sont ordonnés par le propre ordre de l’univers.
Si nous nous adaptons à cet ordre, de nouvelles parties se révéleront à nous, selon nos besoins, mais si nous suivons la prétention de la science moderne (ou de Stephen Hawking) à faire une description complète de l’univers existant (ce qui suppose que nous aurions déjà des concepts rigoureux de tout, alors que nous n’avons même pas un concept rigoureux de la matière), nous entrons déjà dans un univers psychotique.
De là viennent les prétentions de contrôle total, toutes incompatibles avec la structure de l’existence humaine mais c’est une idée qui peut être vendue comme quelque chose à atteindre.
La vraie relation avec l’ordre universel doit être celle de la confiance, de la patience et de la modestie, et en dehors de cela nous nous aliénons dans les pseudo-ordres de la culture contemporaine.
Le livre «Cours de Philosophie par Olavo de Carvalho : une conversion des concepts généraux en expérience existentielle effective.» est disponible ici : https://www.amazon.fr/Cours-Philosophie-Olavo-Carvalho-existentielle/dp/B0BVT3J6JV?ref_=ast_author_mpb
Revivre des expériences cognitives avec Olavo de Carvalho, extraits audios du livre Cours de Philosophie.

Extraits du livre Cours de philosophie d’Olavo de Carvalho.
«Un jour nous découvrons que l’infini est encore plus confortable que le fini» Olavo de Carvalho.
Le livre est disponible à la vente en version papier !
Ce livre d’études pratiques et personnelles permet de revivre des expériences cognitives.
Le livre est disponible ici :
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B0BVT3J6JV/ref=tmm_pap_swatch_0?ie=UTF8&qid=1676462900&sr=8-5
Livre «Cours de philosophie par Olavo de Carvalho: une conversion des concepts généraux en expérience existentielle effective.»

C’est un livre d’études pratiques et personnelles pour revivre des expériences cognitives.
«Un jour, nous découvrons que l’infini est encore plus confortable que le fini. (…)
Ouvrir son esprit à la transcendance est ce qui permet la rationalité.»
Olavo de Carvalho.

Lien ici pour acheter le livre : https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B0BVT3J6JV/ref=tmm_pap_swatch_0?ie=UTF8&qid=1676462900&sr=8-5
Ce cours de philosophie est le seul qui puisse vous aider à pratiquer la philosophie au lieu de simplement répéter ce que d’autres personnes, illustres et que vous aimez, en ont dit.
Mais, de par sa nature même, la philosophie n’est pas un savoir spécialisé sur une certaine classe d’objets : c’est une activité intégrale de l’intelligence qui se tourne vers tous les champs du savoir et de l’expérience à la recherche de son unité, de son fondement et de ce qu’elle signifie ultimement pour la conscience humaine.
Il n’y a donc pas de limites aux connaissances spécialisées qui peuvent devenir nécessaires, comme subsides auxiliaires, à l’apprentissage et à l’exercice de la philosophie.
La formation philosophique est aussi, et indissociablement, l’ouverture de l’intelligence à la totalité systémique des connaissances humaines.
Pour cette raison, ce cours est également un système éducatif complet, ouvert aux domaines d’études suivants, en plus de la philosophie stricto sensu :
🔹Religion comparée,
🔹Lettres et arts,
🔹Sciences humaines,
🔹Sciences naturelles,
🔹Communication et expression.
Cette portée fait de ce cours une sorte d’introduction générale aux études supérieures dans leur globalité.
Mais ce n’est pas tout.
Comme la philosophie consiste avant tout dans l’unité du savoir et de la conscience, les différents domaines abordés dans le cours ne constituent pas une somme d’éléments sans liens, mais plutôt la vision synthétique de l’unité organique du savoir humain.
Grâce à cette approche, le cours devient une pratique des savoirs interdisciplinaires.
Cependant, la philosophie ne peut jamais constituer une simple activité professionnelle et universitaire, déconnectée de l’intimité personnelle de celui qui l’exerce.
C’est, par définition, un exercice de conscience de soi, qui recherche systématiquement les liens entre savoir, être et agir, dans l’unité de la conscience individuelle du philosophe.
👉 L’unité du savoir, de l’être et de l’agir est le but de toute philosophie : c’est la conquête de la sagesse.
Cherchant constamment le lien entre connaissance et conscience de soi, le philosophe (ou, ce qui revient exactement au même : l’étudiant) se soumet à la discipline de la sincérité, qui devient lentement, progressivement et sûrement une voie d’ascèse spirituelle : le développement du sens personnel de la vérité.
Comme, d’ailleurs, l’intelligence humaine ne se développe pas plus ou moins selon les taux fictifs de certains QI innés ou selon certaines déterminations induites, mais seulement selon la détermination plus ou moins grande de chaque homme à rechercher la vérité et à l’intégrer dans les structures de sa personnalité et les lignes de sa manière d’agir, le cours devient aussi une méthode de développement de l’intelligence personnelle.
Voici ce qu’est le cours de Philosophie :
🔹Un cours de philosophie,
🔹Un système éducatif complet,
🔹Une introduction générale aux études supérieures,
🔹Une théorie et une pratique de l’interdisciplinarité,
🔹Un chemin d’ascétisme spirituel,
🔹Une méthode de développement de l’intelligence personnelle.
Si ces objectifs vous paraissent trop grands pour être atteints d’un coup, le cours vous montrera qu’il n’est pas possible d’en atteindre un seul séparément : la philosophie, l’éducation intégrale, l’élargissement de l’horizon cognitif, l’unité du savoir, l’ascèse spirituelle basée sur la conscience de soi-même et le développement de l’intelligence humaine ne sont que six noms pour une seule et même chose.
Le cours ne promet pas de vous les donner, car aucun d’entre eux n’est quelque chose que vous pouvez recevoir en cadeau.
Il promet seulement de vous montrer le chemin pour les conquérir et les faire vôtres pour toujours.
Le cours de Philosophie ne vous demandera que deux choses : la sincérité et l’effort tranquille.

Olavo démonte Descartes

La société moderne a créé une confiance excessive au «je» et ce fut l’influence de Descartes.
On continue notre série de vidéos concernant le livre «cours de philosophie d’Olavo de Carvalho», en collaboration avec François.
Livre disponible en prévente ici : http://shorturl.at/AHP25
«Cours de philosophie par Olavo de Carvalho: une conversion des concepts généraux en expérience existentielle effective.»
Extrait du chapitre 126 intitulé «L’unité du réel» du livre «Cours de philosophie d’Olavo de Carvalho.»

Aristote dit dans la Métaphysique :
«Toutes ces choses les plus universelles sont, dans leur ensemble, les plus difficiles à connaître pour les hommes, puisqu’elles sont les plus éloignées des sens».
D’autre part, nous savons aussi par Aristote qu’avec la forme sensible vient la forme intelligible, le quid, qui donnera, à son tour, le concept universel.
Voilà un problème qu’Aristote n’a pas résolu et qui peut s’énoncer ainsi :
Tout ce qui existe, existe en tant qu’individualité & non en tant qu’existence collective, par contre, il n’y a de connaissance qu’au niveau de l’universel.
Il n’y a pas tant ici contradiction qu’une tension entre la manière d’être toujours individuelle et la manière de connaître, toujours générale.
La perception de la forme intelligible est faite par l’intelligence mais suit immédiatement les sens.
Cependant, en termes de validité des connaissances, la simple perception ne peut, à elle seule, servir de prémisse à un raisonnement logique.
Il faut la convertir en une forme verbale affirmative qui suit la forme sensible.
Et il n’est pas facile de montrer comment quelque chose d’aussi discontinu que les sens peut conduire à des concepts universels.
Les concepts universels ont une continuité, mais nous ne percevons que des choses discontinues, quelque chose où il y a un contraste.
Le «monde matériel» n’est pas du tout un monde, car si l’on ampute tous les liens invisibles et non sensibles qui l’articulent, il ne reste qu’une série de perceptions instantanées, séparées et incommunicables entre elles.
L’œil cligne et on sait qu’on n’a pas besoin de «refaire» toute l’image, malgré le fait qu’il y a un gouffre sensible entre les deux instants.
De plus, nous percevons le lien de continuité lorsque l’objet transite entre les sens lorsque quelque chose est visible devant nous et se cache ensuite dans la poche avec la main.
Entre la perception visuelle et la perception tactile, il y a une troisième chose qui nous fait savoir que l’objet reste le même et quelque chose d’autre n’est donné par aucune des deux précédentes.
Nous savons que chaque nouvelle perception provient de la même réalité et qu’il y a unité entre nous et l’objet, sinon nous ne pourrions entrer en relation avec lui.
L’unité du réel est présente dans tout ce que nous faisons, mais rien de tout cela ne peut être donné par la somme des données de tous les sens.
Nous ne pouvons joindre les données qu’en termes d’une unité précédente qui est supposée dans tout.
Ils supposent tous l’unité du réel mais leur fondement est problématique, ce qui introduit l’opportunité pour les sceptiques d’intervenir.
David Hume pensait qu’il était impossible de connaître l’unité du réel –ainsi que l’unité de notre personne– ni même de savoir si elle existe ou non. Nous croirions à cette unité seulement par habitude. Mais alors comment un «je» sans unité peut-il acquérir une habitude?
Pour Kant nous ne percevons pas l’unité du réel, ce qui existe est un schéma préexistant dans l’esprit humain (les formes à priori fonctionnant inconsciemment) qui opère sur les données fragmentaires du monde sensible et donne une forme unitaire, ce qu’eux-mêmes ne font pas.
Si tel est le cas, nous ne saurions jamais si cette unité est réelle ou non.
Kant dit que tous les hommes font cela, ce qui confèrerait au procédé une certaine validité mais non une véracité : nous pouvons tous nous tromper ensemble, comme disent les sceptiques.
L’académie a assumé cette hypothèse kantienne et a échangé la véracité contre le consensus et, ainsi, le monde objectif réel a été laissé entre parenthèses.
D’autres ont essayé de se réfugier dans la science disant qu’on ne peut admettre comme connaissance que ce qui est décrit par les sciences, mais ils ajoutent que l’être humain ne peut rien dire d’objectif, tout ce qu’il dit n’exprime que le fonctionnement de son propre cerveau.
C’est-à-dire qu’il est prévu que les hommes qui sont seuls capables de jeux intersubjectifs ont développé une science capable de connaissances objectivement valables, alors que, par l’hypothèse de départ, la science ne pouvait être qu’un autre jeu.
Rorty en a tiré la conclusion logique : si on ne peut rien prouver, on ne peut qu’essayer d’amener les autres à parler comme nous et + encore, il faut vraiment fabriquer le consensus.
La science consiste à émettre l’hypothèse qu’un certain champ de phénomènes obéit à une constante puis partir à la recherche de faits qui prouvent l’hypothèse.
Toute rigueur scientifique n’élimine pas les limites initiales qui dessinent non seulement l’univers observable mais aussi le type de constante à observer.
Kant avait raison lorsqu’il disait qu’en science la méthode invente l’objet, mais, de cette façon, rien de ce qui est étudié en science ne peut être dit réel, ce n’est qu’un simulacre d’objectivité projeté par la méthode, qui finalement est déjà une application technique.
On ne peut confondre l’unité de la réalité concrète, là où nous existons, avec l’unité abstraite d’un «tout» pris comme objet de théorie.
Livre : «Cours de philosophie par Olavo de Carvalho: une conversion des concepts généraux en expérience existentielle effective.»
Disponible en prévente ici et bientôt en version papier bien sûr : shorturl.at/cegZ8
Partie 2 sur «La science se croit indépendante de la philosophie» dénonce Olavo de Carvalho.

Deuxième partie de notre série du cours de philosophie d’Olavo de Carvalho en collaboration avec François de Perspective Politique et nous discutons ici le présupposé que la science se croit indépendante de la philosophie.
Mon nouveau livre sur Olavo de Carvalho est disponible en prévente ici : shorturl.at/cegZ8
«Cours de philosophie par Olavo de Carvalho: une conversion des concepts généraux en expérience existentielle effective.»
«La science se croit indépendante de la philosophie» dénonce Olavo de Carvalho. Vidéo avec François de Perspective Politique.

Vidéo 2 de notre série du cours de philosophie d’Olavo de Carvalho en collaboration avec François de Perspective Politique et nous discutons ici le présupposé que la science se croit indépendante de la philosophie.
Livre : «Cours de philosophie par Olavo de Carvalho: une conversion des concepts généraux en expérience existentielle effective.»
Disponible en prévente ici : shorturl.at/cegZ8
On décortique le marxisme culturel avec Olavo de Carvalho. Collaboration avec François de Perspective Politique.

Nouvelle série de vidéos en collaboration avec François de Perspective Politique.
🔸Introduction, parcours et culture personnelle d’Olavo de Carvalho.
🔸Critique du marxisme et post marxisme selon Olavo.
Mon nouveau livre sur Olavo de Carvalho est disponible en prévente ici : shorturl.at/cegZ8
«Cours de philosophie par Olavo de Carvalho: une conversion des concepts généraux en expérience existentielle effective.»
Le livre sur Bolsonaro est disponible ici :
«Bolsonaro, mythe et mensonges. La force des valeurs millénaires de la majorité contre la tyrannie d’une minorité corrompue & décadente.»
https://amzn.to/3p9UwEy
Visitez aussi pour plus d’articles et d’informations :
http://www.antoinebachelinsena.com
Olavo de Carvalho, un des philosophes modernes les plus originaux et les plus audacieux.

Introduction aux travaux du grand professeur et philosophe Olavo de Carvalho et qui n’est malheureusement pas connu en francophonie.
C’est pourtant un des philosophes modernes les plus originaux et les plus audacieux.
La note dominante de son œuvre est la défense de l’intériorité humaine contre la tyrannie de l’autorité collective.
Ses questions posées nous orientent vers la conquête de la maturité et l’émancipation du dressage social collectif.
Olavo explique comment le système d’éducation sociale corrompt notre liberté de questionner et entraîne :
🔹L’entrainement à la lâcheté induite,
🔹Le manque affectif induit,
🔹La haine de la connaissance,
🔹La jalousie destructive,
🔹Le mimétisme neurotique.
Pour Olavo de Carvalho, il existe un lien indissoluble entre l’objectivité du savoir et l’autonomie de la conscience individuelle, lien qui se perd de vue lorsque le critère de validité du savoir est réduit à une forme impersonnelle et uniforme d’usage par la classe académique.
Olavo démontre comment la gauche a dominé la presse et les universités brésiliennes pendant plusieurs décennies dans une stratégie qui a suivi l’idéologie du marxiste italien. L’objectif, dit-il, était de créer une «atmosphère mentale» dans laquelle la population deviendrait socialiste sans s’en rendre compte.
👉 Finalement, le message essentiel d’Olavo de Carvalho je crois c’est que c’est l’ouverture de la transcendance qui permet la rationalité (et comme le disait Saint Thomas d’Aquin).
Car sinon on se ferme sur une petite réalité parce qu’on ne veut pas poser la question sur laquelle on a pas de réponse.
On la laisse de côté cette question essentielle qui nous embête mais de cette façon on se ferme, on enferme notre esprit.
Se fermer dans un système prétendument connu lorsque la conception de la totalité est limitée.
Pourquoi j’existe ?
Non réponse de dire je pèse tant et je mesure tant, ou je suis entrepreneur ou autre.
La stature de l’âme adulte c’est de voir la transcendance, s’ouvrir et capter, même si confus bien sûr.
Lisez aussi l’article «De Bobbio à Bernanos. Texte de 1999 restant éternel avec les innombrables leçons du professeur Olavo de Carvalho» sur le lien suivant :
https://antoinebachelinsena.com/2023/01/10/de-bobbio-a-bernanos-texte-de-1999-restant-eternel-avec-les-innombrables-lecons-du-professeur-olavo-de-carvalho/
De Bobbio à Bernanos. Texte de 1999 restant éternel avec les innombrables leçons du professeur Olavo de Carvalho.

Le 6 de juin 1999 par Olavo de Carvalho à Sao Paulo.São Paulo).
(Traduit par Henri Carrières et Armand Grabois)
Le XXe siècle a commencé avec la proclamation presque universelle, après une succesion d’expériences totalitaires dont le bilan se monte à presque 200 millions de morts, que nous ferions mieux d’apprendre définitivement à nous intéresser à la démocratie.
Pour la première fois dans les temps modernes, l’Humanité semble être arrivée à un accord. Quoiqu’il y ait encore des dictatures un peu partout, l’idée de dictature a perdu toute crédibilité intelectuelle, et l’on croit, avec un optimisme assez platonique, que ce qui disparaît du ciel des idées devrait tôt ou tard disparaître de ce bas monde.
Et, quoique personne n’attribue aux démocraties actuelles la vertu de la perfection, il y a un consensus général que Norberto Bobbio a résumé en une sentence lapidaire: “La seule solution pour les malheurs de la démocratie, c’est un surplus de démocratie”.
Mais cette formule est-elle celle d’un consensus ou celle d’un problème?
🔹En premier lieu, que signifie “plus de démocratie”? Un libéral croit que c’est moins d’intervention de l’État dans l’économie; un social-démocrate croit que c’est plus de secours de l’État aux pauvres ou défavorisés. Ainsi, non seulement on réédite la vieille confrontation entre capitalisme et socialisme, tous les deux sous le nom de démocratie, mais on arrive finalement à un cul-de-sac, puisque pour réaliser la première alternative il faudrait accroître le contrôle étatique sur la vie privée (pour le moins afin que l’État, dépourvu de son fardeau économique, acquière de nouvelles fonctions qui légitiment son existence), et pour réaliser la seconde il faudrait augmenter les impôts et gonfler la bureaucratie étatique jusqu’à paralyser l’économie et paupériser encore plus le pauvres.
🔹En deuxième lieu, il y a de bonnes raisons de douter que “plus de démocratie” soit encore de la démocratie. La démocratie n’est pas comme un pain, qui croît sans perdre l’homogénéité: à mesure qu’elle s’étend, sa nature change jusqu’à se convertir en son contraire. L’exemple le plus caractéristique — mais, certes, pas unique — est ce qui se passe avec la “démocratisation de la culture”. En un premier moment, démocratiser la culture c’est distribuer généreusement aux masses les soi-disant “biens culturels”, autrefois réservés, dit-on, à une élite. En un deuxième moment, on exige que les masses aient aussi le droit de décider ce qui est et ce qui n’est pas un bien culturel. Alors, la situation se renverse: offrir aux masses les biens de l’élite n’est plus pratiquer la démocratie: c’est insulter le peuple. Les couches populaires, affirme-t-on, ont droit à “leur propre culture”, dans laquelle la musique rap peut être préférable à Bach. L’intellectualité se livre alors à toute sorte de théorisations afin de prouver que les biens supérieurs autrefois convoités par la masse n’ont pas, en fin de compte, plus de valeur que tout ce que la masse possédait déjà avant de les conquérir. Et, quand l’ancienne différence entre culture d’élite et culture de masses semble finalement rétablie sous le nouveau et réconfortant prétexte de la relativité, les intellectuels se révoltent encore plus, car il découvrent que tous les biens, égalisés par l’universel rélativisme, sont devenus de pures marchandises sans valeur propre: Bach est devenu fond sonore pour les campagnes publicitaires de culottes et le rap, grâce au marché du disque, a créé une nouvelle élite de millionaires, cyniques et arrogants comme ne l’aurait osé être l’ancienne élite. Un processus identique se répète dans les domaines de l’éducation, de la morale et même de l’économie, où chaque nouvelle fournée de bénéficiaires du progrès s’accroche à ses nouveaux privilèges avec une avarice et une violence inconnue des élites plus anciennes: le fascisme a surgi parmi les nouvelles classes moyennes créés par la démocratie capitaliste, et la “Nomenklature” soviétique, la plus jalouse des classes dominantes qui n’ait jamais existé dans ce monde, est née de l’ascension de soldats et d’ouvriers dans la hiérarchie du Parti.
🔹En troisième lieu, on a peut-être le danger le plus grave: un consensus en faveur de la démocratie n’est constructif qu’en apparence, car la démocratie, par définition, consiste à se passer de tout consensus. Démocratie n’est pas concorde: c’est une manière intelligente d’administrer la discorde. Et la clameur universelle pour “plus de démocratie”, dans la mesure même où elle s’affirme comme un consensus, donne des signes de ne plus pouvoir supporter aucune voix discordante.
Ainsi, il y a des raisons pour craindre que, si le XXe siècle a commencé par demander des dictatures et s’est terminé par exiger la démocratie, le nouveau siècle finisse par suivre le parcours dans le sens précisément inverse.
Car, comme disait Bernanos, la démocratie n’est pas l’opposé de la dictature: elle en est la cause.
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.